. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)
[Partie I : Les dispositifs éditoriaux]
Chapitre III. L’image populaire, le cas de la Maison Quantin
Il est un support qui mêle depuis ses origines ancestrales du texte et de l’image : l’estampe populaire. Elle se développe au XVIIe siècle, dans les centres d’imagerie installés à Paris, rue Saint-Jacques, et adopte des caractéristiques et des fonctions qui évoluent assez peu jusqu’au XIXe siècle. Le critère immuable est celui de la forme, l’image populaire consistant en une feuille volante imprimée uniquement sur le recto. La technique de la gravure sur bois est une autre composante attachée à l’image dans sa forme traditionnelle et artisanale. Son peu de valeur marchande en fait également un support de communication accessible aux populations les moins aisées, rurales comme urbaines, qu’il convient de divertir mais aussi de moraliser. Ce medium de transmission par l’image est donc l’une des premières méthodes de communication de masse. Qu’advient-il au moment où les transformations économiques et sociales (industrialisation, alphabétisation, migration urbaine) génèrent de nouveaux produits culturels fortement concurrentiels ? L’image populaire voit son renouvellement passer par un changement de public, essentiellement enfantin à partir du Second Empire. Le centre d’imagerie d’Épinal, dirigé par la famille Pellerin, domine alors le marché avec des feuilles qui adoptent un multicadre d’images placées au-dessus de petits textes racontant une histoire. Au même moment a lieu l’essor du livre scolaire et de la littérature enfantine, secteur éditorial prometteur où tente de se faire une place un grand nombre de maisons d’édition. Celle dirigée par Albert Quantin est la seule à miser sur la feuille d’images et à concurrencer la production spinalienne. Elle propose en 1886 une collection intitulée Imagerie artistique, qui prend place dans une plus vaste collection nommée Encyclopédie enfantine :
Le format de notre imagerie (28-38) est à peu près le même que celui de l’imagerie d’Épinal. Inutile de dire que c’est le seul point de ressemblance qui existe entre ces deux imageries (1).
Des premières estampes populaires à la feuille d’Épinal puis à l’Imagerie Quantin, quels changements peut-on observer au niveau d’un langage scripto-graphique restreint au format de la page ? La question de l’intégration de ce support pluriséculaire au marché de l’édition industrialisé mènera notre réflexion jusqu’à l’incidence sur la bande dessinée de cette culture enfantine, objet de surveillance de la part des institutions. C’est à travers l’Imagerie artistique (et principalement le fonds du Musée de la bande dessinée (2)), collection peu connue mais emblématique de l’évolution de la feuille volante, que nous observerons le dispositif, de sa fabrication technique et de la manière dont est partagé l’espace entre textes et images, aux procédés de communication mis en œuvre et aux valeurs attachées au message véhiculé. Il s’agira de comprendre en quoi les choix audacieux faits par Albert Quantin à l’égard du fond et de la forme des images procèdent des contraintes et des conditions de la situation historique.
A. La feuille volante
1. De l’image unique à la bande dessinée
L’Imagerie artistique de la Maison Quantin est une collection promue pour la nouveauté qu’elle apporte, sous la Troisième République, à l’ancestrale image populaire. Composée de quatre-cent-vingt titres, elle offre une grande diversité d’images qui regardent vers le passé comme vers le futur.
La Maison Quantin organise la vente de ses feuilles de façon régulière, autour de séries de vingt titres chacune. De 1886 à 1904, vingt séries sont mises sur le marché, soit à peu près une série par an. Une ultime série est produite en 1917, publiée uniquement en album (3). En plus de fidéliser l’acheteur, le principe sériel permet à l’éditeur de réunir les planches sous un titre générique spécifiant leur contenu. Quatre catégories distinguent ainsi la thématique des images : « Militaires » ou « Époque de Napoléon » pour les feuilles traitant de faits d’armes (deux séries), « Fables de la Fontaine » (deux), « Contes de fées » (une) et « Histoires » ou « Historiettes » pour le reste des planches comiques ou didactiques (quinze). Pour une part, l’Imagerie artistique s’inscrit donc par ses sujets dans la continuité des traditionnelles images populaires. Les mises en page vont, d’autre part, nous servir à préciser quels degrés d’observance et d’innovation caractérisent cette collection. Si ce point anticipe sur le chapitre consacré à la mise en page et au traitement de la case, c’est qu’il permet de distinguer plus précisément, dans le cadre d’un format invariable, entre différents traitements accordés à la succession des images.
La forme la plus ancienne de l’estampe populaire est celle qui présente une image unique, pleine page, souvent consacrée au registre religieux, gravée sur bois, accompagnée d’un titre et parfois d’un court paragraphe écrit. Le modèle perdure jusqu’au XXe siècle malgré la diversification des sujets. Les séries 6 et 8 présentent, respectivement en 1888 et 1890, de telles feuilles avec une image synthétique déclinée autour du thème des « Fables de la Fontaine ». Hermann Vogel, Gustave Fraipont, Firmin Bouisset et Gaston Gélibert sont les principaux signataires de ces « compositions où les personnages portent les costumes contemporains de l’époque du grand fabuliste » (Supplément littéraire du Figaro, 19.12.1891). Le rapport quantitatif texte / image y penche en faveur du second terme, la fable étant placée dans un petit coin de la feuille, avec ou sans cadre. Se manifeste souvent un effort d’intégration de l’espace écrit à l’environnement dessiné : l’encart textuel est rarement situé en surface de la page mais traité comme un élément visuel, doté d’une consistance « matérielle », inscrit dans la profondeur et l’ordre spatial de la composition : un lièvre « passe devant » l’encadré du texte (Le lièvre et la tortue, G. Gélibert, s6-n3) et l’ombre d’un renard s’y projette (Le renard et les raisins, G. Fraipont, s6-n15). Dans Les grenouilles qui demandent un roi (G. Gélibert, s6-n13), le rectangle blanc accueillant la fable est dévoilé par un jeu de drapé qui théâtralise le texte comme une scène à voir.
Un autre type d’images populaires qui apparaît au début du XIXe siècle consiste en la planche de soldats : il s’agit de soldats multiples à découper et à coller sur un carton pour le jeu des enfants, ou de la présentation des différents corps de l’armée. Intitulée « Militaires », la deuxième série de l’Imagerie artistique (4) est ainsi composée de feuilles thématiques, qui décrivent la composition de l’Infanterie de ligne et chasseurs à pied, des Zouaves, de la Garde républicaine, de l’Artillerie, etc. Elle résume également en une image des évènements comme la Bataille de Solferino, le Combat du Bourget ou la Conquête de l’Algérie. Il n’y a pas de séquence ici encore, le titre de la série le laisse d’ailleurs entendre. Consacrée aux faits de guerre mis cette fois en récits, la série 12 porte, quant à elle, les noms « Historiettes » et « Époque de Napoléon » (5). Contrairement aux journaux où rien ne distingue de prime abord série et séquence, l’Imagerie artistique marque la nuance. La première planche n’est toutefois narrative qu’en pointillé puisqu’elle propose une mosaïque d’images représentant des moments choisis de la vie de l’empereur (Napoléon Bonaparte : 1769-1821). Les dix-neuf autres sont bien de petites histoires temporellement situées dans la période de son règne.
La division en tableaux de l’image unique s’effectue à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, dans les planches de l’Imagerie Saint-Jacques à Paris. Une Histoire de Robinson Crusoé (imprimée chez Basset, entre 1750 et 1805) (6) fait ainsi l’objet de sept feuilles comportant chacune deux bandes de trois images. Même si « le texte qui accompagne l’image est très sommaire et sert seulement à l’expliciter », comme l’écrit Henri George qui ajoute que « tout est dans le dessin » (7), les moments représentés ne sont pas articulés entre eux mais constituent des fragments extraits d’un continuum narratif. Comme les récits « abrégés » pour l’enfance, ils évoquent des épisodes, des moments représentatifs d’une histoire connue et servent probablement de support à un récit oral. Au conteur ou au lecteur de combler l’intervalle entre les images pour les replacer dans un processus temporel, dans une logique actantielle – « Naufrage et abordage de Robinson Crusoé dans une Isle déserte de l’Amérique à l’embouchure de l’Orénoque », « Robinson abat des noix de Coco pour sa nourriture », « Robinson entoure sa demeure d’une haie de branchage et d’arbrisseaux ». Cette segmentation en images procède d’une mise en spectacle par le biais d’un espace illusionniste :
(Au sujet de la planche Le Petit Poucet publiée chez Basset) On remarque que le passage du registre littéraire au système de l’image s’opère par une théâtralisation du conte, dont les différentes séquences sont ici mises en scènes : les décors sont dressés, la perspective limitée à deux plans ; le conte est segmenté en huit « actes » qui sont aussi les nœuds de l’action, et celle-ci est elle-même ponctuée par une gestuelle dramatique très conventionnelle. Dans cette représentation d’une représentation théâtrale, le récit de Perrault se mue en une forme spectaculaire qui parle aux yeux comme à l’esprit. (8)
Cette formule, fonctionnelle et décorative (9), est ensuite remplacée par celle des « compartiments » : « Dans sa ténuité et sa rigueur, le filet d’encadrement dispense l’imagier d’un encombrant dispositif théâtral, et libère l’image des conventions scéniques » (10). Généralisée sous l’impulsion de Nicolas Pellerin et de Pierre-Germain Vadet (directeurs de la fabrique d’Épinal de 1822 à 1854), elle s’impose pour la mise en page des contes et des récits à destination des enfants. Les images sont alors distribuées de manière régulière, en une succession de douze, seize ou vingt images strictement encadrées, organisées en trois, quatre ou cinq rangées. Cet ordonnancement est couramment utilisé en bande dessinée, du XIXe siècle à nos jours, il est appelé le « gaufrier » par André Franquin. En même temps que le texte s’allonge, résumant les épisodes du récit, il y a glissement de l’image pensée sur le modèle de l’espace scénique à l’image figurative qui s’offre ainsi l’opportunité de développer un système de représentation tant analogique que conventionnel. De l’écran théâtral, l’image accède à un espace d’expression autonome où le cloisonnement circonscrit un langage propre. Pour décrire ces images, nous relevons dans les ouvrages ou articles spécialisés les termes « panneaux », « vignettes », « scènes », mais aussi « tableaux » ou « tableautins ». Le mot case n’y étant jamais employé, il y aurait donc un usage différent du dessin dans l’image enfantine typiquement spinalienne et dans la bande dessinée : « Dans les images d’Épinal, le dessin est encore beaucoup plus illustratif que narratif. Statique et déconnecté de ses voisins – sans vrais enchaînements –, il vient en accompagnement d’une légende de quelques lignes » (11). À la différence des feuilles de l’Imagerie Basset, les légendes s’enchaînent avec cohésion, elles lient entre elles les principales articulations du scénario. L’appréciation se fonde donc sur les seules ellipses entre les images des planches d’Épinal. Comme nous l’avons dit au sujet des séquences muettes, moins il y a d’écart temporel, spatial, causal, plus l’on s’éloigne du tableau pour aller vers la case : le « statique » est distingué du « dynamique ». Au sujet des images Quantin, Thierry Smolderen observe qu’elles « ne brillent certes pas sur le plan de la vitalité et du dynamisme : souvent très élégantes, elles sont aussi très statiques » (12). L’ensemble des planches de l’Imagerie artistique s’apparente-t-il dans son mode d’articulation des images aux traditionnelles feuilles d’Épinal ? Une part fonctionne sur le même principe et développe de petits récits, souvent des contes ou des légendes. La discontinuité dans l’enchaînement des images se rencontre dans ces histoires dont le récit suppose un long déroulement dans le temps et dont les images ne peuvent, en raison du support, représenter toutes les étapes. Un autre paramètre ayant trait à la mise en page, ou plus précisément à la mise en case, renforce le sentiment d’hiatus entre les images. Il y a lieu de parler de « vignettes », comme à l’égard des images des Albums Stahl, à partir du moment où chaque dessin est « enfermé » dans son propre espace décoratif. Beaucoup des titres de l’Imagerie artistique répondent à cet esthétisme.
Signée par Joseph Beuzon, L’idée de Corentin (s3-n1, 1886) présente trois rangées de trois images rectangulaires, chacune dotée d’une sorte de passe-partout. L’effet de fenêtre est renforcé par la diversité de leurs formes géométriques (losange, hexagone, polygone et rectangle à angles cassés ou arrondis) tandis qu’une symétrie partant de l’image centrale est créée dans la distribution des couleurs. Une autre logique, un second cheminement de l’œil est dès lors proposé en amont de celui, linéaire, de la narration proprement dite. L’esthétique l’emporte sur le récit a priori. Typiquement dans cette planche, l’habillage triplement individualisé de la case – par la forme, la couleur de fond et les motifs décoratifs – opère un cloisonnement visuel qui peut donner cette impression d’unités séparées dans leur signification. Comme dans les images des manuscrits médiévaux, cet effet de mise en case peut être lu comme la matérialisation d’un éloignement, et l’ambition décorative, par la répartition des figures dans des espaces différents, prendre une valeur de signification (13). Figures géométriques et éléments décoratifs produisent, dans la sensation visuelle de l’ensemble de la feuille, un effet d’exclusion. D’autant que la distribution des formes et des couleurs à partir de la case située au milieu de la feuille rappelle le procédé de l’enluminure à médaillon central où la « lecture thématique » ne s’opère pas, comme dans la « lecture narrative », de gauche à droite mais à gauche de, à droite de (14). D’autres planches donnent cette même impression bien qu’une similitude de forme ou de couleur vienne relier l’ensemble. Dans L’œuf à surprise (M. Radiguet, s3-n3, 1886), Les deux bossus (M. Radiguet, s3-n5) ou La boule de neige (Rip, s4-n12, 1887) seuls les motifs végétaux et floraux, placés autour de la case ou dans le blanc intericonique, varient et contribuent à autonomiser les vignettes. Dans L’œuf à surprise, Maurice Radiguet diminue l’effet d’isolement du cadre esthétisé en faisant participer la décoration au décor de l’histoire : les touffes de plantes et de fleurs qui habillent le cercle du dessin prennent racine dans le jardin que visite, en rêve, la petite Jeannette.
Dans ces mises en page, le texte se voit comme un élément nettement distinct du dessin, séparé de son espace, il semble autonome. Félix Lacaille choisit de l’intégrer comme un élément plastique de la vignette dans L’enfant et le chat (s4-n19). Réduit à un nom ou à une proposition nominale, l’écrit se mue en titres de tableaux pour préciser la méthode d’approche du félin – « En embuscade », « Préparatif du combat », « Escarmouche », « L’attaque », etc. Chaque élément, écrit et dessiné, est placé dans un espace indépendant (rectangle et cercle), les deux composantes de l’histoire étant néanmoins réunies dans un unique cadre. La frise ornementale et les motifs de papier peint de ce cadre changent à chacune des phases de l’action – le soin porté à la réalisation de cette « toile de fond » se lit d’ailleurs dans la mise en couleur spécifique contenue dans le dossier d’impression. Si la concision des légendes, et c’est la seule planche du fonds à en présenter de telles, et la découpe serrée du jeu animal engagent le déplacement du regard, le traitement individuel des tableaux demande donc un bref arrêt sur les images. Dynamisme et statisme cohabitent ici. L’élégance l’emporte en revanche dans d’autres planches comme dans Rivalités (A. Bogino, s5-n16, 1888) où les titres placés sur des banderoles, des affichettes et autres phylactères – au sens que prend le mot dans l’art chrétien médiéval – résument, comme les images, les paragraphes du texte. Le tout fait véritablement office de tableau, avec son encadrement et son cartel, et paraît une illustration de l’histoire écrite sous-jacente.
Que la planche soit plus ou moins séquentielle, la mise en page esthétisée altère donc en termes de dispositif visuel l’enchaînement des dessins qui manifestent avec force leur instabilité. Benoît Peeters parle en effet de la case de bande dessinée comme d’une « image “en déséquilibre”, écartelée entre celle qui la précède et celle qui la suit, mais non moins entre son désir d’autonomie et son inscription dans le récit » (15). Le déséquilibre est ainsi marqué dans les nombreuses planches Quantin où l’originalité de la mise en page ne vaut parfois que pour son aspect décoratif : aucun lien sémantique avec la diégèse dans L’invalide à la tête de bois (P. Steck, s12-n14, 1894) notamment, où l’alternance entre cases rondes et cases rectangulaires produit une construction globale harmonieuse. L’Imagerie d’Épinal et celle de Pont-à-Mousson (dont le Musée de la bande dessinée possède quelques planches) comptent elles aussi des feuilles où l’appréhension globale et immédiate prime sur la lecture linéaire. Une série de l’époque de Marcel Vagné, intitulée Nouvelles images artistiques aux armes de France, présente en ce sens d’élégantes compositions, avec des détails rehaussés de dorure. Une plus nette distance entre l’écrit et le dessin s’installe encore dans des titres où l’organisation de la planche, misant sur un « effet tableau », replace le texte dans sa propre continuité. Rencontrée dans les compositions thématiques de la presse comme de l’imagerie, la mise en page « de type patchwork », où les morceaux iconiques de différentes formes se superposent les uns aux autres, relègue le texte en un paragraphe au bas de la feuille.

Fig. 32 – R. de la Nézière, Le perroquet, Imagerie artistique, série 12, numéro 20, 1894. Coll. numérisée Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
Réalisées par Raymond de la Nézière, les planches Le perroquet (fig. 32), La bonne pipe (s12-n9) ou Napoléon de neige (s12-n16) offrent au lecteur plusieurs modes de lecture : regarder l’assemblage d’images explicité ensuite par le parcours du texte, lire le texte et lui donner forme en observant les cases ou effectuer un va-et-vient entre l’écrit et les figures. Ce dispositif envisage donc les éléments textuel et graphique comme des unités indépendantes et disjointes : le texte apparaît dans sa forme traditionnelle de lignes continues déroulant un récit, tandis que les images, en formant une composition esthétiquement pensée, proclament leur pouvoir figuratif. Les notions de picturalité et de littérarité sont ainsi exhaussées dans ces feuilles qui tentent de les concilier autour d’une fiction commune. Elles sont une manière de raconter en images qui s’éloigne du dispositif propre à la bande dessinée. L’image y penche vers l’illustration, le rendu de l’atmosphère de l’histoire, même si en termes de place, de quantité, le dessin est nettement dominant. Cet agencement d’images gagne en fluidité et en séquentialité lorsque les légendes y sont scindées et placées à l’intérieur de la case. Dans Le peintre To-Kai (s9-n4, 1891), non seulement les images sont côte à côte, sans blanc transitionnel, mais un encadrement vient enserrer l’ensemble. Placé dans l’espace graphique, dans de petits cadres figurés en bambou, le texte fait partie intégrante du dessin. Coïncidant avec la fiction, cette disposition est donc unifiante et laisse le regard parcourir l’enchaînement des cases sans entrave. Immersive, la structure architecturale adoptée pour Le rajah (fig. 33) intervient elle aussi comme un élément manifestant avec force son principe à la fois unificateur et séparateur. Félix Lacaille construit la séquence sur le plan d’un bâtiment à coupole de style hispano-mauresque, centré autour d’un axe vertical, faisant correspondre l’armature décorative à l’exotisme du conte oriental. Comme les planches en patchwork, la composition monumentale se rencontre dans la presse, notamment dans La Caricature sous le crayon d’Alfred Rodiba lorsqu’il parodie, en un fourmillement de caricatures, les romans d’Émile Zola (13.05.1882 ou 31.03.1883). Bien avant cela, cette manière d’organiser les images s’emploie dans les enluminures médiévales, comme dans le frontispice du Livre de l’Ecclésiastique (Bible de Saint-Vaast, première moitié du XIe siècle), commenté par François Garnier (16). Les éléments construisant l’édifice y font office de véritables séparateurs puisqu’il s’agit là encore d’une image thématique et non pas narrative. Connue elle aussi depuis le XVe siècle, la technique dite de l’horizon continu – « qui consiste à donner la même ligne d’horizon, le même décor de paysage à toute une rangée de cases successives, malgré les césures effectuées par les lignes verticales » (17) – est utilisée par Félix Lacaille à l’étage central de la construction. L’effet est d’ailleurs plus appuyé dans le crayonné de la planche où une rangée d’une dizaine de palmiers souligne l’arrière-plan. La notion temporelle ou chronologique inhérente au procès narratif est dès lors mise à l’épreuve par la dimension spatiale : le tabulaire, l’organisation des unités iconiques sur l’espace de la feuille, prend le pas sur le linéaire du fait des deux espaces uniques, bâtiment à coupole et horizon permanent. Le principe de continuité de la narration est ostensiblement confronté au second principe qu’est l’évolution puisque du point de vue du deuxième plan et de la mise en page, la succession et la segmentation ne marquent plus l’avancée dans l’histoire.
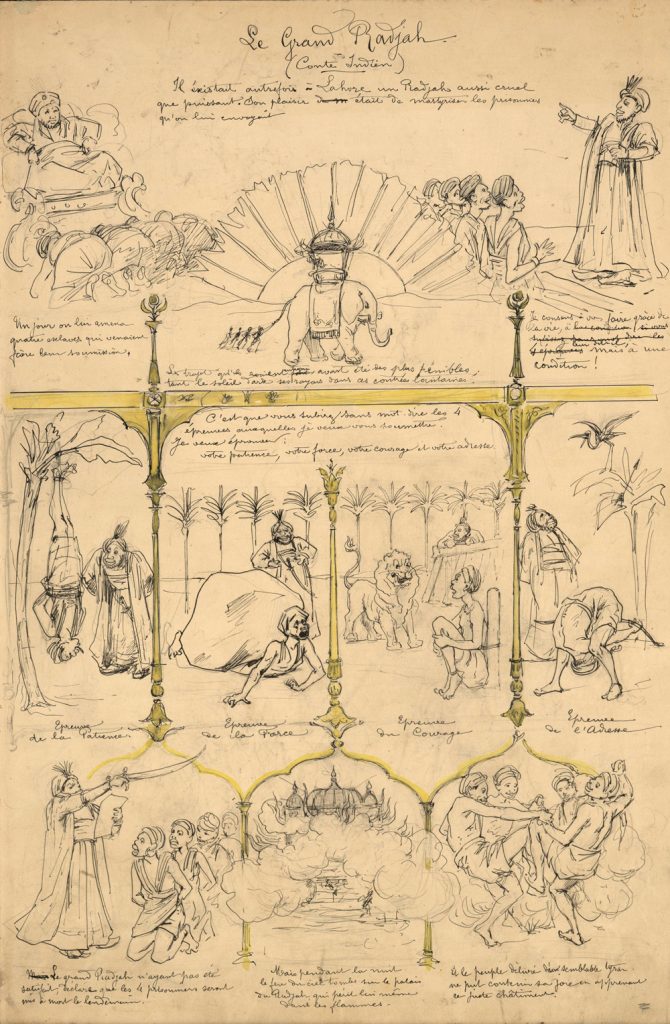

Fig. 33 – F. Lacaille, Le rajah, planche originale et imprimée, Imagerie artistique, série 11, numéro 9, 1893. Coll. numérisée Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
Finalement, par ce formalisme artistique, certaines planches Quantin confrontent les deux notions qui cohabitent dans l’histoire en images avec une inclination particulière pour la première : selon l’angle d’étude, on y verra statisme et dynamisme, tableau et récit, discontinuité et continuité, picturalité et littérarité. Une autre portion d’images s’attache cependant à donner plus fortement l’impression du mouvement et à renforcer la séquentialité. La mise en page vient encore aider les dessinateurs dans cet objectif, elle se rapproche de celle adoptée dans les autres supports de bande dessinée. La transparence du « gaufrier » est notamment mise à l’honneur dans des planches inspirées de la chronophotographie, à l’instar des séquences de presse (18). D’autres superposent plusieurs rangées d’images contiguës, ce qu’observe également Odile Frossard dans l’Imagerie Pellerin :
L’imagerie Pellerin, sans abandonner ses anciennes productions, s’engagea dans cette nouvelle forme d’illustration. Elle publia d’abord des histoires non plus en vignettes mais en bandes comme Le Pot-au-lait et Monsieur de la Pétaudière. (19)
Précision importante, elle note que le style de la mise en page est dûment précisé au registre du dépôt légal de l’Imagerie en 1884.

Fig. 34 – Monsieur de la Pétaudière, Imagerie Pellerin, n° 25, 1884. Coll. Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
Des vignettes aux « bandes » (20) dessinées, l’évolution de la mise en page s’accompagne d’une diminution du développement narratif grâce à quoi les histoires gagnent en fluidité. Sous l’influence de la presse (humoristique et enfantine), les histoires en feuilles proposent à côté de récits (comme ceux de la série 16 dédiée aux contes de fées) de très courtes anecdotes comme en donnent les journaux, aux sources d’inspiration variées et contemporaines. Des titres tels L’abeille (R. Maury, s5-n14, 1888), Histoire d’un parapluie (s18-n13, 1902-1904), Ouverture de pêche (Godefroy, s11-n6, 1893) ou Médor et le pêcheur (s5-n18) offrent des gags simples et visuels qu’il est aisé de comprendre sans lire les textes, lesquels s’allègent notablement. À la même période, l’Imagerie Pellerin observe une division identique des histoires entre courts récits et séquences élémentaires. Pour redorer le blason d’une imagerie populaire en déclin au mitant du XIXe siècle, les deux éditeurs spinalien et parisien vont ainsi chercher dans les succès du journal d’autres formes permettant de diversifier une production quelque peu démodée. Pour des collectionneurs comme Duchartre et Saulnier, ce fait est le signe d’une rupture dans la compréhension du medium : si l’imperméabilité, l’attachement aux influences anciennes et la répugnance à changer de mode d’expression sont des caractéristiques de l’art populaire (21), l’adaptation à la mode du moment transforme l’artisanat en industrie.
2. De l’artisanat à l’industrie
Les conditions de production de ces feuilles d’images sont un élément déterminant, non seulement de leur facture mais de la position qu’elles occupent dans le paysage éditorial du dernier quart du XIXe siècle. Permettons-nous ici d’ouvrir une parenthèse sur l’aspect technique du dispositif.
Lorsqu’il rachète, en 1876, l’imprimerie de Jules Claye (1806-1886) où il travaille depuis trois ans (située 7 rue Saint Benoît à Paris), Albert Quantin agrandit le bâtiment aux numéros 5, 9 et 11 de la même rue. Il dote ses ateliers d’un matériel moderne (une machine à vapeur de 100 CV et deux chaudières de 50 CV) pour le fonctionnement des machines à imprimer, à composer ou à retirer. Aussi, ses « ateliers de reproduction, de taille-douce, gravure, dessin, montage et galvanoplastie lui avaient conféré une supériorité réelle sur ses concurrents dans le domaine du livre d’art et celui des ouvrages illustrés de luxe » (22). La description des locaux donne l’idée de l’ampleur des équipements : au n° 5 – dont une partie est louée aux bureaux de la revue Le Monde moderne – rez-de-chaussée et premier étage sont occupés par un magasin, des ateliers, quelques appartements pour les employés et des bureaux ; au n° 7, des ateliers de presses manuelles et une imprimerie typographique, avec presses mécaniques, sont installés au rez-de-chaussée tandis que le premier étage sert d’atelier de brochage, de correction et de magasin de caractères ; le n° 9 est occupé par des ateliers de machines et de presses au rez-de-chaussée, par le magasin de la librairie au premier étage, des ateliers de composition au deuxième, des ateliers de presses à bras au troisième et au quatrième, et un atelier de photogravure au cinquième ; enfin, le n° 11 est réservé à la librairie (23).
Le procédé précisément employé pour l’impression des feuilles de l’Imagerie artistique est celui, récent à l’époque, de la chromotypographie. Elle permet à l’imprimeur-éditeur de concilier qualité et bon marché, un avantage sans cesse mis en avant dans les réclames. La mécanisation offre en effet une facilité de reproduction des images qui entraîne une réduction des coûts sans perte de qualité (24). À l’unité, une feuille Quantin est vendue « un sou », c’est-à-dire cinq centimes. Elle reste, tout comme l’image Pellerin, l’imprimé le plus accessible aux enfants, les journaux les moins chers de l’époque se vendant dix centimes. La Maison Quantin propose également des achats en lots où les prix dégressifs – deux francs cinquante pour cent images, neuf francs pour la rame de cinq-cents feuilles et seize francs pour mille – font descendre le prix de l’image à presque un centime. Cependant, au vu du lectorat enfantin visé, l’achat à la pièce reste sans doute le plus fréquent car direct, sans la médiation d’un adulte. Vendues au même prix, les images du centre d’Épinal sont également confectionnées, à compter des années 1850, non plus par gravure sur bois mais par le biais de la lithographie qui entraîne, selon Duchartre et Saulnier, la « disparition de la véritable imagerie populaire » (25) – en 1845, la fabrique emploie de quatre-vingts à cent ouvriers et les tirages montent à des centaines de milliers d’exemplaires. Si l’entreprise adopte en effet des techniques modernes d’impression et doit construire une véritable usine en 1897 (au quai de Dogneville, locaux classés Monuments historiques en 1986, transformés aujourd’hui en Ecomusée), qui abrite jusqu’à cent-quatre-vingts ouvriers, dix presses verticales et une presse lithographique, elle met un point d’honneur à conserver une manière artisanale pour la mise en couleur. Mais pour ces amateurs d’estampes xylographiques, « Pellerin avait industrialisé l’image et tué l’artisan » (26). Dans sa célèbre étude, Walter Benjamin pointe également le procédé lithographique qui, parmi d’autres, dévalue l’« aura » de l’œuvre d’art et conduit à la perte de sa fonction rituelle au profit d’une exposition en série (27) – on songe à la disparition des images dites de « préservation » ou religieuses, censées apporter protection à leurs propriétaires et à ses biens. Le principe de la sérialité, appliqué par Quantin et Pellerin, participe lui aussi à l’éphémère de l’image : caractéristique de la production de masse, il favorise une fabrication continue d’images sans cesse renouvelées.
En outre, contrairement au centre spinalien, entreprise familiale transmise de génération en génération, la Maison Quantin évolue au gré d’associations capitalistes. Porté par la reprise économique et l’intense activité boursière des années 1879-1881, l’éditeur choisit en 1886 de transformer son entreprise en Société Anonyme, comme l’explique Jean-Yves Mollier (28). La Maison Quantin devient la « Compagnie générale d’Impression et d’Édition, S.A. » en association avec le négociant Henry May, directeur commercial. Actionnaire majoritaire, Quantin demeure le président de l’entreprise. Un peu avant, en 1882, quatre imprimeurs parisiens dont Albert Quantin (accompagné d’Émile Martinez, De Mourges et Claude Motteroz) signent ensemble un traité qui donne naissance à la « S.A. des Imprimeries réunies ». Dotée d’un capital de six millions de francs, elle se donne comme mission « l’exploitation de fonds de commerce d’imprimeries et de journaux ». En 1890, l’assemblée générale des actionnaires de la société décide le principe de fusion avec l’ancienne Maison Quantin et se donne pour raison sociale « Librairies-Imprimeries réunies (anc. Maisons Quantin, Motteroz, Morel, Martinet) S.A. ». Henry May démissionne en 1896 et fonde un an après la « Société française d’éditions d’art » qui reprend le catalogue Quantin ainsi que le fonds de la librairie Morel.
Profitant en bonne intelligence de la situation économique, Albert Quantin use donc des nouvelles réglementations sur les sociétés et comprend que l’arrivée de capitaux, même étrangers au secteur du livre, peut favoriser son entreprise. C’est ainsi que le Comptoir d’escompte, établissement de crédits fondé à la suite de la Deuxième République, est l’une des premières banques à participer au capital d’une maison d’édition. Elle investit en effet dans le capital des Imprimeries réunies tandis que la société anonyme d’Albert Quantin compte parmi ses principaux actionnaires Charles Guasco, administrateur du Comptoir d’escompte. À noter également qu’Henry May est le frère d’Ernest May, un membre éminent de l’établissement financier. Rien d’étonnant donc à voir Albert Quantin poussé par le souci commercial d’être rentable, de produire et vendre toujours plus et au meilleur coût. Pour faire la promotion de son Imagerie artistique, il place des réclames dans des journaux comme Le Rire, Le Matin, le Supplément littéraire du Figaro, ainsi que dans les revues qu’il fonde ou dont la société reprend la diffusion : Le Livre, La Revue des deux mondes, L’Art pour tous, La Gazette des Beaux-Arts. Les « revues bibliographiques » de titres aussi divers que La Joie de la maison, Le Tintamarre, Le Correspondant, Le Temps, La Revue diplomatique, L’Univers illustré, Le Journal des chambres de commerce, Bulletin de la papeterie, La Revue mondaine illustrée, Supplément à la science française, Le Saint Nicolas, Le Monde artiste, Le Petit Parisien, etc. font également une bonne place à la critique louangeuse de l’Encyclopédie enfantine, sans jamais oublier de mentionner l’Imagerie artistique, dans les termes choisis par l’éditeur. Ces vitrines de papier s’ouvrent stratégiquement à la fin de l’année, en novembre ou décembre, pour alimenter le lecteur en idées de cadeaux pour les fêtes ou d’achats pour les vacances.

Fig. 35 – Bibliographie de la France, Cercle de la Librairie, n° 5, 01.02.1896. Source : Töpfferiana
La rationalisation du fonds passe également par la réunion de chacune des séries en un « album d’images », présenté par la même occasion comme « un original et pittoresque objet d’étrennes à l’usage des petits enfants ». Ces albums sont imprimés sur du papier fort (contrairement aux images en feuilles, très fragiles), dotés d’un « cartonnage élégant et solide » illustré en couleur, d’une page de garde listant le titre des planches réunies et sont vendus trois francs cinquante. Les histoires sont également imprimées en noir et blanc pour des albums « à colorier », vendus au même prix. Dans les deux cas, les feuilles ne portent plus les références à l’éditeur, le nom de la collection, ni le numéro de la série – mentions inscrites, comme pour les images d’Épinal, en haut à droite et à gauche de la feuille. Mises en livres, les planches sont donc dégagées de l’appareillage paratextuel caractéristique de la feuille volante et aspirent à plus de pérennité :
Les images qui composent cet album sont les vingt premières publiées dans la collection de l’Imagerie artistique ; elles sont tirées avec un grand soin sur du papier fort. Nous avons voulu donner une forme plus durable et plus élégante à ces vingt pages humoristiques, qui ont obtenu le plus grand succès : notre vente atteint le chiffre de 2 millions de feuilles dans un mois. Ces images méritent d’être conservées (29).
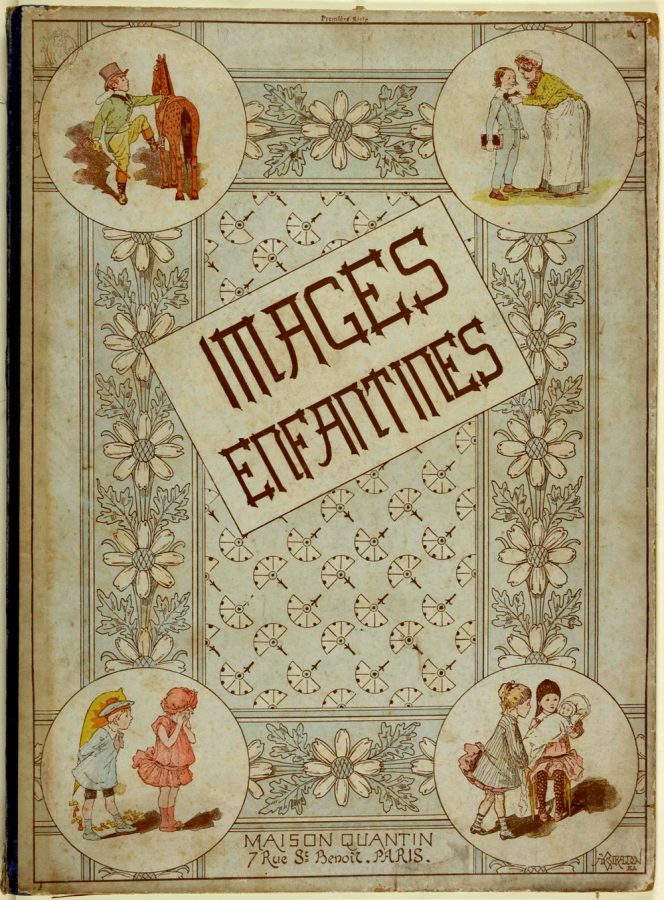
Fig. 36 – Album Images enfantines, Maison Quantin, série 1, 1886. Coll. Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse.
Elles entrent alors dans la variété parfaitement définie de la librairie, qui fait l’objet de catalogues spéciaux, « les livres d’étrennes ou de présent » (30), ici clairement destinés aux enfants contrairement aux albums précédemment évoqués, également objets à offrir. Préservées de leur fragilité, ces images vouées originellement à l’éphémère bénéficient de l’attention que porte la Maison Quantin, dans le prolongement des ambitions de la réputée Maison de Jules Claye, à la qualité formelle des ouvrages. John Grand-Carteret estime d’ailleurs que « dans le mouvement actuel de l’image, la maison Quantin tient la même place que les Hetzel autrefois » (31), spécialistes du beau livre d’étrennes.
Avec la Société Française d’éditions d’art, Henry May perpétue cet intérêt pour la distinction des ouvrages, les premiers plats des albums qu’il édite bénéficient notamment d’une typographie, de compositions florales, de lignes serpentines et de formes arabesques qui procèdent de l’Art Nouveau. L’un d’eux fait également office d’affiche de librairie (conservée au Musée national de l’Éducation de Rouen), il est spécialement réalisé par Arsène Herbinier (1869- ?), dessinateur et lithographe, élève d’Eugène Grasset (1845-1917), graveur, affichiste et décorateur tenu pour l’un des initiateurs de l’Art Nouveau – Herbinier réalise la même année, en 1898, l’affiche pour le Salon des Cent.
Après la faillite de la Société Française d’éditions d’art, le fonds de l’Imagerie Quantin est encore exploité par les Librairies-Imprimeries réunies (32). Louis Martinet, le fils du fondateur qui dirige seul l’entreprise à partir de 1908, édite à partir de cette date, et jusqu’aux années 1930 semble-t-il, ce qu’il convient d’appeler des recueils par comparaison avec les albums (33). La qualité est effectivement moindre, concernant non seulement la reliure (le dos de l’ouvrage est toilé) mais l’impression (découpe hasardeuse, couleurs de médiocre qualité et mal distribuées, papier fin) et la compilation (séries tronquées) (34). De nombreux recueils sont ainsi mis sur le marché, ils réunissent dix, vingt, quarante, cinquante, quatre-vingts ou cent planches et portent ces chiffres en intitulé suivis des mentions Histoires choisies, Contes choisis et/ou Images enfantines. Certains sont spécifiquement imprimés pour être distribués par les Grands Magasins qui révolutionnent le commerce à partir du Second Empire (fig. 37). Avec des diffuseurs comme Le Bon Marché (fondé en 1852), Le Grand Magasin du Louvre (1855) ou les Grands Magasins aux Galeries Lafayette (1893), les albums de l’Imagerie Quantin s’assurent une bonne exposition. La nouveauté de ces enseignes est, entre autres, d’autoriser une libre circulation du client parmi des marchandises exposées comme dans un musée (35) : après avoir feuilleté les journaux mis gratuitement à disposition de la clientèle, comment ne pas céder à l’attrait de ces albums richement colorés mais abordables, où se trouvent les mêmes séquences dessinées et se laisse entrevoir un savoureux imaginaire enfantin.
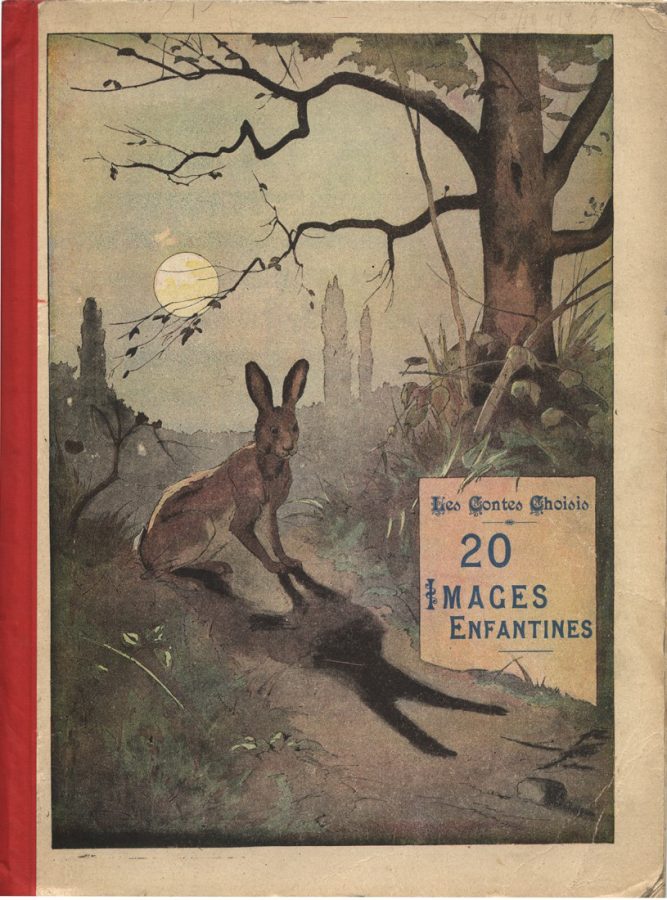
Fig. 37 – Recueil Les Contes Choisis : 20 Images enfantines, série 9, 1891, tampon au dos « Grands Magasins aux Galeries Lafayette ». Coll. Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
La naïveté et l’enjouement typiques de l’enfance, dont l’histoire en images se fait le relais privilégié, sont utilisés en ces débuts de consommation de masse. Les stratégies publicitaires s’affinent et vont chercher dans la bande dessinée le moyen de rendre le produit sympathique, populaire, avenant. Des planches des Imageries Quantin et Pellerin se voient ainsi estampillées (dans les marges ou au verso) de marques et de noms divers tels Sagot-Lelarge, Grande Cordonnerie, Goulet-Turpin (alimentation), Idéal-Boule (teinture idéale), Gustave Ouvière (photographe), etc. Des feuilles de la Série aux Armes d’Épinal sont aussi directement réalisées à partir de commandes passées par des entreprises, comme Le Supplice de la roue par O’Galop (Marius Rossillon, 1867-1946) pour les pneus Michelin (n° 265, 1898) – l’éditeur pouvait faire double usage de ces feuilles en les plaçant également dans son imagerie (36). Ceci n’est pas sans rappeler les « images réclames » issues de la collaboration de Pellerin et de l’éditeur publiciste parisien Gaston Lucq (dit Glucq) à partir de 1880. Pour une collection de planches réunies sous le titre Série encyclopédique Glucq des leçons de choses illustrées, ils avaient choisi de remplacer les héros des légendes et des contes par des produits de consommation courante, comme le papier, le journal, une pièce de vingt francs, le sel, une bougie, la photographie, la vapeur, un crayon, etc. Créées à des fins pédagogiques comme pour répondre à la fascination exercée par l’industrialisation, ces histoires se voient également confier la promotion, plus ou moins discrète, de marques associées aux produits : les « Crayons Conté » dans L’Histoire d’un crayon ou le chocolat Trebucien dans Le Chocolat. La renommée de l’image Pellerin est encore plus directement mise au service des intérêts commerciaux dans des planches entièrement dédiées à l’histoire ou à l’actualité d’une marque, comme Le Rayon d’Épargne du Printemps où se lit l’inscription, au bas de la feuille, « Publicité spéciale par l’Image populaire ».
Portant la mention du diffuseur – par un tampon sur le premier ou le second plat de l’ouvrage – les albums de la Maison Quantin font de même office de vitrine promotionnelle pour ces commerces à la recherche des dernières nouveautés. Pour assurer la concurrence des albums pour enfants, et peut-être pour rappeler le format originel de publication des histoires en images, Louis Martinet offre une alternative moins coûteuse aux grands formats par la commercialisation de petits albums oblongs, avec des planches en demi-format. Les histoires sont donc adaptées à ces nouvelles dimensions (21 x 30 cm au lieu de 28 x 38 cm) et ramenées à deux bandes d’images. Il n’y a pas réellement de remontage puisque l’éditeur se contente de conserver la partie supérieure ou inférieure de la planche. Lorsque cela est réellement nécessaire à la compréhension, les légendes sont rapidement réécrites en gommant parfois un effet de sens initial. L’Imagerie d’Épinal et celle de Marcel Vagné à Jarville-Nancy éditent, elles aussi, des albums au format à l’italienne (37), mais la difficulté à dater ces ouvrages ne permet pas de déterminer qui est l’initiateur de cette nouvelle formule.
C’est qu’une rude concurrence sévit dans le monde de l’édition désormais inséré dans les logiques des marchés financiers qui font de la gestion un élément décisif. D’après le Bulletin de la Maison Quantin, l’Imagerie artistique rencontre un succès public tout comme les albums et livres illustrés de l’Encyclopédie enfantine : « Encouragés par le succès de cette première Imagerie artistique, nous n’avons pas hésité à créer de nouvelles séries d’images », « notre vente a atteint le chiffre de 2 millions de feuilles dans un mois » (38). Aussi Georges Pellerin (qui succède à son père, Charles Pellerin, mort en 1887) décide-t-il de lancer une collection pensée en fonction de sa rivale parisienne :
Quand il s’est agi de lutter avec l’imagerie nouvelle et artistique de Quantin, nous avons décidé de le faire en créant une imagerie de tous points supérieure que nous avons appelée « série supérieure aux armes d’Épinal » et que vous connaissez […]. Ce qui a d’ailleurs dégoûté le créateur (39).
Elle est commercialisée en 1889, trois ans après le lancement de l’Imagerie artistique, et porte le titre distinctif Série aux Armes d’Épinal ou Série supérieure aux Armes d’Épinal. Elle est dite « supérieure » parce que les feuilles sont d’un format plus grand que les images traditionnelles (32 x 42,5 cm), imprimées sur un papier de meilleure qualité et plus finement coloriées. Le terme « supérieure » équivaut finalement à celui d’« artistique » employé par Quantin. Cette collection se compose de quatre sous-séries : « Histoires et scènes humoristiques, contes moraux et merveilleux » (cinq-cents feuilles), « Grands Animaux sauvages » (vingt), « Fables de la Fontaine » (vingt-cinq) et « Gloires Nationales » (vingt-cinq). Les « histoires et scènes humoristiques » sont analogues aux feuilles de l’Imagerie artistique, elles marquent un tournant dans la production de la Maison Pellerin :
La série d’images supérieures dite série aux armes d’Épinal est un événement d’importance dans l’histoire de l’imagerie spinalienne. En effet, ce qui était composition exceptionnelle dans les images ordinaires devint le but d’une série de cinq cents planches qui a pour sous-titre Histoires et scènes humoristiques – Contes moraux et merveilleux (40).
Déjà sérieusement concurrencé par les histoires de la presse à bon marché, l’éditeur Pellerin avait commencé à moderniser sa production avec quelques images isolées, comme Monsieur de la Pétaudière cité plus haut et publié en 1884. Mais ce groupe d’images illustre précisément le besoin du centre d’Épinal de s’adapter aux goûts du lectorat de l’époque et de moderniser sa production en conséquence. D’après Georges Sadoul et Jean Adhémar, cette imagerie renouvelée ne rencontre pourtant pas son public. Le premier estime que les « modèles que créent après cette date [1878, mort de Charles Pinot] Épinal et Pont-à-Mousson sont d’une extrême vulgarité et ils n’auront guère de succès auprès de l’enfance », quand le second avance que « c’est l’imagerie désuète et moralisante de 1860-1875 qui a le plus de succès » (41). L’Imagerie Pellerin reste néanmoins la seule à connaître au XIXe siècle une diffusion sur l’ensemble du territoire mais également internationale – en Allemagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Brésil, en Italie, en Espagne, et des images sont également traduites en russe, en arabe, en espéranto. L’Imagerie Quantin reste, quant à elle, de diffusion essentiellement parisienne – la collection est néanmoins traduite en néerlandais et distribuée en Belgique par Désiré Van Dantzig & Fils et par Em. Rossel. Antoine Sausverd évoque également des planches en allemand qui ont pu servir de support publicitaire pour les manufactures des biscuits Victoria, à Bruxelles et à Dordrecht (Pays-Bas) (42).
B. « populaire » comme catégorie éditoriale
La maison d’édition fondée par Albert Quantin se situe donc au cœur des bouleversements économiques qui touchent le secteur de l’imprimé au cours du XIXe siècle. De fait, l’éditeur se voit poussé par une logique de productivité et de concurrence accrue caractéristique de cet « âge du papier » (43). L’usage fait du langage de la bande dessinée, en plein essor dans la presse parisienne, participe de cette logique. Néanmoins, nous avons vu que ce n’est pas tant la vivacité narrative du langage, telle qu’elle s’illustre dans l’histoire muette des journaux humoristiques, que le versant esthétique attaché au medium graphique que cherche à exploiter l’Imagerie Quantin. De plus, l’aspect technique du dispositif de la feuille volante, désormais produite de manière industrielle, s’accorde mal avec l’un des sens que prend le mot populaire. À en lire les multiples études qui s’y intéressent, la notion de « populaire » paraît des plus floues et des plus ambiguës – dans son étude sur les littératures dessinées, Harry Morgan s’attache à montrer son imprécision, point par point (44). Au XIXe siècle pourtant, le mot correspond à un phénomène réel qui est celui de l’avènement de nouvelles formes et de nouveaux usages de l’imprimé. Nous l’avons déjà utilisé dans les deux précédents chapitres et plus largement dans celui consacré à la presse, où il se comprend aisément par recours à l’idée de public ou de consommation populaire : est populaire, l’objet qui revendique le peuple comme destinataire principal, mais non exclusif. En ce début de « culture de masse », toute littérature rendue accessible au lectorat émergent, déshérité ou peu cultivé (femme, enfant, ouvrier, artisan), est populaire et vient remplacer, après les différentes phases d’alphabétisation, la littérature orale :
Par « littérature populaire » on désigne alors essentiellement une littérature produite pour un vaste public (romans de grande diffusion, mélodrames) (45).
En même temps que se font moins précises les limites de ce que l’opposition lettrés / illettrés permettait de définir sous l’Ancien Régime comme « populaire », se manifeste au XIXe siècle une rapide et nette extension du partage social des pratiques de l’écrit : « Non seulement l’accès de couches de plus en plus “populaires” à l’imprimé est un phénomène patent, aisément vérifiable, mais il est, de plus, immédiatement désigné comme événement – attendu et redouté – par une grande variété de dispositifs ou de représentations qui entretiennent à son entour un discours incessant » (46). Dès lors, le « lire populaire » devient une problématique politique, sociale et éditoriale forte (47).
D’un côté, le mot désigne donc ce nouveau canal de l’édition. D’un autre côté, et par réaction, il renvoie à la branche folklorique, traditionnelle, rurale ou régionale des arts. À partir du Second Empire, l’image populaire traditionnelle, issue de l’artisanat, se voit devancée puis évincée par l’image populaire citadine, industrielle. Duchartre et Saulnier insistent particulièrement sur ce qu’ils perçoivent comme une dégénérescence de l’imagerie qui, selon eux, n’est plus à considérer comme populaire :
Les folkloristes ont parfois refusé à l’imagerie un caractère nettement populaire. À notre avis, c’est qu’ils ne connaissent bien que l’imagerie du Second Empire des Pellerin, Wentzel, Dembour et Gangel, qui, en effet, ont complètement fait dégénérer l’imagerie à cause de son succès même, en en faisant une véritable industrie, en appelant des dessinaillons et des graveurs « à l’instar de Paris », en employant parfois plus de cent ouvriers, des hommes-outils (48).
Cette référence aux « dessinaillons et [aux] graveurs “à l’instar de Paris” » suggère un autre sens communément attaché au mot populaire, ayant trait au succès, au plébiscite qu’une œuvre peut rencontrer. Si les imageries au milieu du XIXe siècle s’écartent du populaire folklorique, c’est en effet pour mieux se mettre en phase avec les goûts des acheteurs d’imprimés contemporains. Signalée par Duchartre et Saulnier, l’initiative des imagiers pour moderniser leur production se porte sur le recrutement des dessinateurs en vogue dans la presse, dont les caricatures, les portraits-charges, les gags en images sont particulièrement appréciés du nouveau lectorat. Des dessinateurs « populaires » sont employés pour séduire un public « populaire ». Nous avons parlé du populaire comme d’une notion regroupant les franges de la population ayant nouvellement accès à certains produits de l’édition. Elle concerne plus précisément deux catégories, aux limites perméables, associées dans cette notion de populaire : le peuple et l’enfant. Cette « idée-force qui traverse tout le XIXe siècle » se trouve sous la plume de Rodolphe Töpffer, dans les Réflexions à propos d’un programme, article en deux parties qui constitue « la première réflexion d’envergure sur l’imagerie » (49). Pour le maître de pensionnat, le peuple et l’enfant ont en partage la réceptivité aux images :
Les hommes du petit peuple, neufs aussi, ignorants, mais dont l’imagination a conservé sa vigueur, et l’esprit sa docilité, sont à ces divers égards accessibles comme l’enfance à de pareils impressions ; comme pour l’enfance, un spectacle a sur eux plus d’empire qu’un discours, une image qu’un prône […] (50).
Les albums comme les séquences de presse diffusent pour beaucoup un parfum d’enfance, de régression mais très peu sont clairement destinés aux enfants. L’Imagerie artistique leur est pour sa part spécifiquement adressée. Peut-on voir de ce fait des traits spécifiques à ces bandes dessinées pour la jeunesse ou n’y a-t-il pas phénomène de contamination, de dialogue avec les bandes dessinées popularisées (par la presse) du fait de ce rapprochement ?
1. Plaire et instruire
René Saulnier rappelle que « la vraie Image Populaire n’était pas faite pour les enfants » (51), en témoignent les sous-entendus scabreux ou les sujets qui frisent l’indécence. Au XIXe siècle, la technique lithographique puis l’essor du journal et la généralisation de l’instruction conduisent au passage de l’imagerie populaire à l’imagerie enfantine. Sous le Second Empire, peuple des villes et peuple des campagnes « commencent à dédaigner cette image qu’ils trouvent vraiment par trop puérile, et la laissent à l’enfant, qui va en devenir le seul acheteur » (52). Elle prend place dans la branche prometteuse de l’édition désormais entièrement consacrée aux jeunes lecteurs. En 1885, Albert Quantin fait son entrée dans ce secteur spécialisé avec une volonté affichée de modernisation :
Nous ne manquons pas en France d’ouvrages pour les enfants. Depuis l’imagerie jusqu’aux albums illustrés par les procédés de la lithographie, il semble que tout ait été créé et que le dernier venu ne puisse rien apporter de nouveau ni d’intéressant. Cependant, si l’on examine de près les publications destinées à distraire et à instruire les enfants, on peut constater d’une part l’aspect peu artistique des illustrations et d’autre part la faiblesse des récits.
Frappés comme tout le monde de ces imperfections et de ces défauts, nous avons voulu présenter au public une collection d’ouvrages faits dans le double but de plaire et d’instruire.
[…] Dans notre Encyclopédie enfantine, il ne s’agit pas de livres classiques ; nous nous sommes préoccupés de l’instruction et de l’éducation familiales (53).
À la suite de Louis Hachette et de Pierre-Jules Hetzel, il participe parmi d’autres (54) au renversement du monopole du marché de l’édition pour la jeunesse tenu par quatre ou cinq éditeurs provinciaux et catholiques, Alfred Mame en tête (55). Comme Hetzel (P.-J. Stahl), Mégard (Mme Dreamgs) ou Plon (L’oncle Eugène), Albert Quantin écrit lui-même des livres pour enfants, telle Histoire de Germaine publiée en 1885 dans l’Encyclopédie enfantine. Cette collection compte un nombre important « d’ouvrages de toute nature et à tous prix » – beaux livres illustrés, albums, alphabets – et se divise en « Bibliothèques suivant progressivement, de quatre à douze ans environ, le développement de l’éducation » : Bibliothèque maternelle, Bibliothèque enfantine et Bibliothèque de la famille. L’Imagerie artistique intègre cette Encyclopédie enfantine un an après sa création. Elle repose, comme le reste des ouvrages de la collection et la majorité des livres pour enfants, sur le principe de la pédagogie par l’image :
L’illustration, très abondante et variée, a été exécutée spécialement pour éclairer et mieux faire pénétrer les textes dans l’esprit des jeunes lecteurs (56).
Albert Quantin propose ainsi des bandes dessinées en feuilles puis en albums qui doivent servir l’acquisition d’un savoir encyclopédique en même temps que divertir. Comme les abécédaires (57), elles conjuguent le texte et l’image, aiguisant à la fois le raisonnement, l’imagination et fixant dans la mémoire des jeunes lecteurs des connaissances, des idées véhiculées à l’aide de stéréotypes. Au moment où sont épinglées dans les salles de classe de grandes cartes géographiques, une feuille comme Le rajah (fig. 30), par la monumentalisation de sa composition, permet de visualiser une représentation conventionnelle de l’Orient, et la qualité référentielle de l’image (au style graphique réaliste) offre l’illusion, comme dans la leçon de choses en images, de mettre l’enfant en présence du lieu ou de l’objet. L’ambition éducative de la collection s’affiche, d’ailleurs, dans l’image de couverture de l’un des recueils où est représentée une institutrice face à ses jeunes élèves, pointant de sa baguette les illustrations des planches montées en tableaux muraux.
Usant du credo de la littérature enfantine, « plaire et instruire », les éditions Quantin offrent des feuilles d’images qui sont aussi « à valeur morale » (58). Dans l’Imagerie artistique, un grand nombre de planches mettent en scène des défauts moraux dont les conséquences doivent être dissuasives. Les titres se chargent souvent de dénoncer le précepte enrobé dans la fiction ou le travers à corriger : Le menteur puni (s11-n8, 1893), Suites d’une mauvaise action (F. Lacaille, s9-n14, 1891), Henry le paresseux (L. Moulignié, s9-n9), Cupidité punie (J. Beuzon, s13-n19, 1895), Brutalité punie (H. Morin, s11-n13), Désobéissance (P. Carrey, s13-n10, 1895), etc. Ces feuilles s’inscrivent dans la veine de l’enfant terrible que contribue notamment à populariser l’Imagerie d’Épinal avec des titres comme Charles le petit désobéissant, Geneviève la capricieuse, Gustave le petit gourmand. À l’instar de ces planches, les historiettes les plus édifiantes de l’Imagerie artistique s’appuient sur le principe pédagogique fondé sur l’expérience enfantine dont les limites, ou le châtiment final, ont fonction d’avertissement. Ainsi du Premier cigare goûté par le petit Isidore (L. Malteste, s3-n6, 1886) qui, « se croyant un homme à douze ans », « fut malade pendant trois jours, mais redevint raisonnable ». Le schéma narratif est canonique : une première image d’exposition présente soit l’enfant et le défaut qu’il incarne – « M. Tom, gourmand comme il ne s’en voit point, passe et repasse depuis huit jours devant une boutique où de magnifiques oranges sont étalées » (La boule de neige, s4-n12) – soit une situation en attente d’une complication souvent prévisible – « Ludovic met pour la première fois son beau vêtement » (Rip, Les Mésaventures de Ludovic, s7-n2) –, puis vient la mise en acte du défaut ou la complication, avant que la dernière case ne donne à voir l’enfant punit par lui-même ou par un tiers. La promesse de s’améliorer vient souvent conclure l’histoire, appuyée par une image de l’enfant devenu raisonnable, en miroir par rapport à la première case : « Corentin comprit qu’il avait trouvé plus malin que lui, et, en considération de l’oreille droite, il prit la ferme résolution de rester tranquille en classe et de ne plus manquer de respect à maître Alain à l’avenir » (L’idée de Corentin, s3-n1). Tout au long de l’histoire, le narrateur ne cesse de proférer un « discours d’escorte évaluatif » (59) fondé sur les codes du savoir-vivre, selon une norme idéale globale dont les deux pôles, positif et négatif, sont ostensiblement soulignés – Robin ne reste pas longtemps « un charmant enfant », « bien gentil, bien sage » (J. Beuzon, Le jeu du repassage, s3-n4), quand Totor est d’emblée un « espiègle » jouant « un vilain tour » à un « pauvre aveugle », avant qu’un revirement ne lui rappelle « qu’une mauvaise action est toujours punie » (R. Lacker, Totor et l’aveugle, s7-n8). La morale, dans ce contexte, est à la fois évaluation des conduites socialisées, par le biais des légendes, et constat tiré de l’expérience. Quand l’enfant ne reconnaît pas lui-même le préjudice, une autorité se charge d’infliger la sanction finale. Elle est représentée par la famille, la mère le plus souvent, mais aussi par une personne extérieure au foyer – instituteur, médecin, gendarme, garde champêtre. Une manière de rappeler à l’enfant qu’aux membres du cercle familial s’ajoutent et se substitueront d’autres entités pour le maintenir dans le cadre de la loi ou du code moral. En contravention (J. Beuzon, s3-n8) montre ainsi comment trois collégiens en promenade sur leur vélocipède défient une interdiction publique, « défense de pénétrer dans cet enclos », se moquent du garde champêtre, abusent de l’alcool dans une auberge mais sont rattrapés et conduits chez M. le Maire avec le conseil « de respecter désormais l’autorité ».
Tels de grands enfants, les adultes ne sont pourtant pas à l’abri d’une mauvaise conduite, loin s’en faut. L’écart aux normes des pratiques sociales est le pivot de mésaventures qui mettent l’adulte et l’enfant sur le même plan. Avec Brutalité punie (s11-n13), Morin va jusqu’à faire de l’enfant, et de son esprit espiègle, le garant des bonnes mœurs. Léonard, « un gros usurier de la ville », se distingue par sa brutalité mais se trouve ridiculisé par un jeune mendiant ayant souffert de son penchant : il suspend un os à la ceinture de l’usurier, ce qui a pour effet d’ameuter rapidement des chiens affamés qui le font basculer dans un ruisseau. La morale est proverbiale : « À qui mal fait, mal arrive ». Tout en restant dans le même faisceau vertueux, cette histoire s’offre comme une parenthèse pour l’enfant qui défie l’adulte en mêlant farce et correction. Dans la première série, Caran d’Ache donne une histoire comme il peut en proposer au même moment dans la presse humoristique. Vieux habits (s1-n19, 1886) montre la manière astucieuse grâce à laquelle « deux hommes de mauvaise mine », ayant commis un vol, échappent à un duo de gendarmes : ils tirent sur leurs vieilles vestes dont les manches restent entre les mains des agents. Cette « fameuse affaire » trouve une suite plus correcte dans la planche suivante, Habits neufs (s1-n20) : les deux bandits, en fuite, atterrissent dans la salle à manger d’une famille bourgeoise après s’être introduits dans le conduit de la cheminée. Couverts de suie, ils effrayent tout le monde, profitent du repas et se servent dans les armoires des plus beaux habits. Ils sont arrêtés sur le pas de la porte par les deux gendarmes mais « ne peuvent user d’un moyen qui leur avait servi quand ils portaient de vieux habits faciles à déchirer » : « les deux bandits vont passer la nuit au poste, en attendant le jugement et la punition méritée ». Si la lecture successive des deux images ne laisse pas de doute quant à la continuité créée, rien dans le texte ne l’explicite réellement. Les deux protagonistes sont laconiquement désignés comme « deux bandits », idem des « deux gendarmes » que le dessin permet toutefois d’identifier comme étant ceux de l’histoire précédente, et l’astuce des voleurs est rappelée par un article indéfini, « un moyen ». Que l’enfant achète les feuilles à l’unité ou qu’il se procure l’album de la première série, il n’en tirera donc pas la même leçon. Ambiguïté de taille pour ces feuilles à valeur morale…
La brèche s’élargit dans les planches de l’Imagerie artistique où le méfait reste impuni. Une quantité non négligeable de titres mettent effectivement en scène des farces que les enfants destinent aux adultes, sans que celles-ci ne soient condamnées ou engagent une rédemption finale. Dans Le panier d’œufs (E. Zier, s3-n10), deux gamins font une farce au père Infolio, vieux bouquiniste, qui se répercute sur la marchande d’œufs et fait intervenir un gardien de la paix. Les deux coupables – le remboursement de trois douzaines d’œufs est en jeu – observent la scène en arrière-plan et la dernière image les donne à voir souriants et faisant un pied de nez : « Et les gamins riaient en trouvant leur farce bien réussie. Fi ! les sans-cœur et les mauvais sujets ! ». Édouard Zier condamne tout de même l’action des enfants par le texte, en évoquant « une farce qu’ils viennent d’imaginer dans leur méchanceté » ou en les qualifiant de « méchants gamins » (60). La dernière image leur est pourtant consacrée, qui les donne triomphants et défiant l’autorité, tandis que le père Infolio est injustement sommé de rembourser les œufs cassés. Dans d’autres cas – La farce du petit Alsacien (V. Poirson, s4-n16), C’était un chat (P. Tempestini, s11-n12), Une mauvaise farce (P. Steck, s14-n2), Il pleut des chats (R. de la Nézière, s14-n3) – la plaisanterie aux conséquences plus ou moins graves reste impunie et aucun jugement de valeur ne vient dans les légendes la désapprouver. Les dessinateurs semblent ainsi prendre plaisir à imaginer les enfants se jouer des adultes et des figures d’autorité sans aucune proscription. Les intentions édifiantes sont ainsi laissées en suspens dans la mesure où, comme le note Philippe Hamon, « le remords, c’est la désambiguïsation ultime du système de valeurs qui régit le personnage, c’est l’intrusion fracassante, à la fin d’un destin de personnage, de normes sociales, morales, qui triomphent à ce moment-là » (61). Faut-il voir dans ces quelques planches d’inspiration libre une résurgence de l’esprit de contre-culture, jouant sans cesse sur le couple norme / transgression, qui préside à la majorité des bandes dessinées au XIXe siècle ? Certains aspects des feuilletons de Christophe dans Le Petit Français illustré, comme d’autres séquences de ce journal, et plus nettement encore la contribution de Cham à l’Odyssée de Pataud dans le Magasin d’éducation et de récréation, introduisent cette liberté de ton qui tranche par rapport au reste des productions pour l’enfance, y compris les histoires issues de la veine de l’enfant terrible où la morale reste toujours sauve. Quelques feuilles de l’Imagerie artistique nous paraissent ainsi prendre, discrètement, le contre-pied du manuel scolaire, étalon de la littérature et de la presse enfantines de la seconde moitié du XIXe siècle. En cela, elles sont une forme de compensation, d’autant plus que la modicité de l’image volante lui permet d’être acquise par l’enfant en dehors du contrôle de l’adulte, comme le rappelle habilement l’image de la série Glucq, Ce qu’on fait avec un sou. Les mentions publicitaires – « jolie collection d’images humoristiques et enfantines tout à la fois » et « dessins […] comiques ou fantastiques, mais toujours à la portée des enfants » – suggèrent combien la combinaison comique / littérature de jeunesse ne va pas de soi et inspire la méfiance (62). La Revue bibliographique universelle, Polybiblion, émet en ce sens des réserves sur l’Imagerie artistique ; elle étend le laxisme à la série consacrée aux « Fables de la Fontaine » :
[…] l’un, sous le titre d’Images artistiques, est la reproduction de vingt fables de La Fontaine : les allégories sont spirituelles, les dessins vraiment « artistiques » mais tout n’est pas dans la note qui convient à l’enfance (témoin : la Cigale et la Fourmi, les Deux Pigeons et les Deux Coqs), et il y perce même une certaine tendance démocratique (voir le Loup et l’Agneau et le Chêne et le Roseau) ; l’autre, intitulé Images enfantines, offre une série de scènes pleines d’humour, telles que : Navigation forcée, le Mandarin gourmand, les Oies de Petit Jean, les Allumettes, Un projet téméraire, Médor et le pêcheur, mais la leçon de morale est trop absente (63).
Visenot, l’auteur de ce compte rendu, conclut : « Amuser, oui, le but a été atteint ; instruire, c’est autre chose ». À propos des petits albums de l’Encyclopédie enfantine, il souhaiterait « pour l’enfance des enseignements plus fortifiants » et va jusqu’à signaler « en particulier dans Gribouille un passage fort peu convenable », avec indication des pages concernées. L’empreinte de l’instruction, dans les titres mentionnés de la série 5, est pourtant présente mais se fait discrète, la punition des mauvaises actions se limitant à la dernière case où elle apparaît comme un lieu commun, un topos de circonstance devenu banal, ayant perdu de sa force de persuasion. Le commentaire du narrateur aspire également à une certaine neutralité, comme dans Le Mandarin gourmand (Godefroy, s5-n3) où l’appétit du personnage et le vol des œufs ne sont pas ouvertement condamnés. Dans Pierrot dîne en ville (Rose Maury, s5-n2), où le jeune Arlequin joue un tour à Pierrot, un ami de ses parents, en reculant sa chaise avant qu’il ne s’assoie, la correction n’est pas même dessinée et réduite à une proposition finale : « Pierrot en voulant s’asseoir fait une culbute qui renverse la table, brise pot à fleurs et terrine et effeuille le bouquet. M. et Mme Arlequin accourent relever Pierrot, et vont infliger au petit espiègle une punition méritée ». Des planches de l’Imagerie artistique font ainsi montre d’un certain détachement ou d’une indécision quant à leur valeur morale, le divertissement y apparaît le seul moteur au détriment de l’éducation ou du civisme. Cette tendance de l’histoire en images est confirmée au début du XXe siècle par les « illustrés » d’Arthème Fayard et plus encore par ceux des frères Offenstadt avec les fameux Pieds Nickelés de la revue L’Épatant.
Pourtant, cette collection, comme l’Encyclopédie enfantine, est « honorée de souscriptions du Ministère de l’Instruction publique et de la Ville de Paris ». Cette distinction, affichée dans les réclames, les catalogues ou les bulletins de la maison, indique que les titres de la collection ne sont pas uniquement conçus pour être des livres et des feuilles d’étrennes mais alimentent également le marché de l’édition scolaire ou du livre de prix. Certains albums compilant des feuilles de l’Imagerie artistique arborent une reliure caractéristique des livres-récompense : un cartonnage rouge avec titre en lettres dorées, agrémenté de motifs végétaux (64). Garantie d’un succès commercial et éditorial, cette approbation émane de la troisième sous-commission permanente constituée pour guider le programme de la Commission de la décoration des écoles et de l’imagerie scolaire. Elle naît le 27 mai 1880 sur proposition de Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire et bras droit de Jules Ferry, avec l’objectif « d’introduire dans notre enseignement à tous ses degrés le fécond enseignement du beau » (65). Elle s’inscrit dans le mouvement qui souhaite voir l’éveil au sentiment de l’art intégrer les programmes éducatifs, à partir du discours du Ministre de l’Instruction publique, Victor Duruy, qui annonce en 1869 : « J’emploierai des dessinateurs pour remettre dans la bonne voie l’imagerie populaire » (66). La troisième sous-commission consacrée à l’imagerie scolaire est ainsi composée « des membres de l’Instruction publique, des inspecteurs généraux, le vice-recteur de l’Académie de Paris, des professeurs de lycée et d’Université, des architectes, des artistes comme le sculpteur Delaplanche et le peintre Geoffroy, le publiciste Henry Havard et enfin Champfleury » :
Elle a pour fonction de choisir les types d’imagerie scolaire parmi la production existante et de guider les éditeurs pour la publication de nouvelles images. Elle les invite à recourir aux meilleurs artistes, en dépit des coûts élevés, car « aucun artiste n’a trop de talent pour servir de maître à l’enfance » (67).
Lorsqu’il recrute « des artistes de talent » (68), comme il se plaît à le répéter, Albert Quantin ne fait donc que répondre à cet appel gouvernemental. Parmi la centaine de dessinateurs participant à l’Imagerie artistique (69), et beaucoup contribuent également à l’Encyclopédie enfantine, rares sont ceux qui n’ont pas suivi une formation à l’École des Beaux-Arts de Paris. Certains sont peintres et exposent aux Salons des Artistes Français, des Incohérents et, plus tard, aux Salons des Humoristes. Ainsi de l’anglais Boyd Alexander Stuart, d’Eugène Chaperon (peintre militaire), de Gaston Gélibert (peintre animalier), de Paul Guignebault (peintre d’histoire), d’Adolphe Gumery (peintre de genre), de Victor Nehlig, de Paul Steck, d’Hermann Vogel, etc. Une autre portion de dessinateurs est recrutée sur la base du succès obtenu dans les journaux : Benjamin Rabier, Caran d’Ache, Christophe, Eugène Le Mouël, Théophile-Alexandre Steinlen, Job, Albert Robida, O’Galop, Henri de Sta, etc. À signaler également, la présence d’une femme, Rose Maury, aquafortiste et dessinatrice pour la presse humoristique. Le lancement de la collection parie sur la popularité de ces dessinateurs : Steinlen et Caran d’Ache réalisent les premières feuilles commercialisées. Les « meilleurs artistes » auxquels l’éditeur demande « des dessins d’un genre tout nouveau » (70) participent dès lors à l’entrée de l’image populaire dans l’ère du graphisme moderne, la caricature étant un domaine qui intéresse vivement Albert Quantin (71). Contrairement aux images de type archaïque où règne l’anonymat, les planches de l’Imagerie artistique affichent fièrement les signatures des dessinateurs. La tradition stylistique « populaire » attachée à l’imagerie, qui s’exprime dans la rudesse du graphisme, les tailles frustes des bois ou le style « primitif », cède le pas à une certaine rigueur académique et aux manières « populaires » dans le sens où elles se répandent dans les journaux à la faveur de la caricature. À la forme d’impersonnalité dans le dessin des images traditionnelles succède la singularité de quelques styles graphiques, signatures d’auteurs immédiatement identifiables (72).
Le renouvellement de l’imagerie qu’Albert Quantin dit opérer avec cette collection s’affiche ainsi dans son titre, qui voit le « populaire » jugé désuet ou grossier remplacé par l’« artistique » à valeur éducative. Cette attention portée à la qualité formelle n’est pas cantonnée aux productions pour l’enfance, elle dérive plutôt d’un vaste projet de vulgarisation. À côté des ouvrages de luxe, le catalogue de l’éditeur propose en effet des collections abordables qui mettent à la portée de tous des connaissances jusqu’alors réservées à une élite. Elles prennent les noms de Bibliothèque d’histoire illustrée, Bibliothèque des sciences et de l’industrie ou Bibliothèque de l’Enseignement des beaux-arts. Cette dernière voit le jour sous l’éphémère ministère des Arts créé par Antonin Proust en 1881, et rassemble des manuels comprenant de cent à deux-cents gravures, vendus trois francs cinquante :
Elle comporte d’abord des volumes traitant des principes de l’art dans ses formules générales, de ses grandes règles qui s’adaptent à toutes les écoles, dans tous les pays et dans tous les temps. Son cadre s’élargit en se spécialisant et comprend toutes les divisions de l’art et ses applications. Les arts industriels y seront largement représentés. Un même esprit de méthode et de clarté a permis d’atteindre partout le même but : instruire en intéressant (73).
Se retrouve, à l’adresse du peuple, le précepte d’Horace de l’utile dulci. Si Albert Quantin est poussé par une logique capitaliste de conquête du marché, il n’en nourrit donc pas moins des intérêts d’ordre culturel, esthétique et moral. Il appartient à une nouvelle lignée d’éditeurs ayant gagné, grâce à la spécialisation du secteur et l’essor du livre d’art, une certaine légitimité. Auparavant méprisés et souvent taxés de commerçants, les éditeurs voient leur statut socioculturel évoluer, ils se rapprochent des écrivains, peuvent entretenir des liens étroits avec les milieux littéraires et devenir des amateurs éclairés, des mécènes des arts et des lettres (74). Fin observateur de son époque, Quantin dessine une politique éditoriale qui lui permet d’atteindre les deux polarités du marché, tiraillé entre une production restreinte, celle du livre d’art, et la grande diffusion de l’édition populaire. L’emploi des dessinateurs de la presse, pour l’Imagerie artistique, est une opportunité de créer une passerelle entre ces deux programmes et de concilier ambition commerciale et souci pédagogique. D’une part, il répond à la requête officielle et met à la portée des enfants et des professeurs des planches aux compositions artistiques et aux graphismes contemporains. D’autre part, la popularité des contributeurs et leur pratique de la bande dessinée particulièrement appréciée en cette période permettent de rabattre un lectorat plus vaste, amateur de presse humoristique ou plus globalement de caricature. La relative souplesse dont ils font montre dans le traitement des sujets participe de cette ouverture de l’imagerie pour la jeunesse à différentes classes d’âge.
À côté de ces images dont la facture remplace « les vieux sujets grossièrement enluminés qui ont fait la joie de nos pères » (Supplément littéraire du Figaro, 19.12.1891 ; écho au discours du 12 mai 1880 appelant à « substituer aux grossières enluminures […] une ou plusieurs séries de récompenses consistant en bonnes gravures » (75)), d’autres répondent à l’idée qu’« en première ligne, l’imagerie populaire doit être patriotique » (76). Cet emploi traditionnel de la feuille volante est limité aux séries 2, 12 et 21 qui mettent respectivement en images les grands moments de l’armée française (de la bataille de Jemmapes en 1792 à la guerre de 1870), l’époque de Napoléon et la Première Guerre Mondiale. Est ainsi faite la promotion des valeurs de la Troisième République, axées sur le renforcement du sentiment patriotique et la construction d’une identité nationale fortement ancrée. Après la défaite de 1870, ces questions sont au cœur de l’enseignement scolaire. Sont en jeu l’éveil d’un esprit de revanche et la préparation militaire des jeunes enfants, qu’illustrent des titres comme La tache noire (F. Bouisset, s1-n10, deux écoliers font la promesse de reconquérir l’Alsace et la Lorraine) et Le condamné à mort (Job, s4-n9, lors d’un bataillon scolaire (77), Popaul est traduit devant le conseil de guerre qui décide de sa condamnation pour avoir crié « Prussien ») (78). L’Imagerie Quantin participe avec ces planches au renforcement de la cohésion nationale et à la propagation de l’idée-force qui pénètre l’école : les devoirs envers la patrie. Le dispositif de l’image populaire, récupéré par les institutions, amène la bande dessinée à ce retournement. Loin de la caricature, des charges satiriques ou des opinions à contre-courant qu’elle portait à ses origines, elle est mise au service de la pensée officielle. Non plus seulement dans les rouages d’une culture médiatique et industrielle, elle se fait le relais complaisant de l’idéologie républicaine. C’est bien la dimension partisane attachée à l’image populaire que retient la presse lors de pastiches. Le conte et la planche de soldats sont notamment utilisés dans Le Rire et Le Charivari pour commenter la situation militaire et politique. L’histoire du petit chaperon rouge sert d’allégorie à Lafosse pour représenter les vaines attaques des royalistes envers la République (L’Imagerie politique, Le Charivari, 18.05.1872) quand la feuille représentant la Population désArmée française, numérotée 332 et attribuée à la Nouvelle Imagerie d’Épinal, tourne en ridicule la Conférence internationale de la paix et son projet de désarmement (Henri Avelot, Le Rire, 20.05.1899). Citons également le célèbre supplément en couleur du Figaro (30.03.1889) qui présente, en association avec Glucq et Pellerin, les quatre candidats aux élections législatives du 22 septembre 1889 – Républicains, Monarchistes, Bonapartistes et Boulangistes. Une histoire en images, Le Bulletin de Vote du père François, y dénonce les fausses promesses de la République et en appelle à une « Monarchie moderne ». Glucq s’y donne, dans les marges, comme un pourvoyeur de « publicité industrielle & propagande politique par l’image populaire », et l’éditorial du journal de rappeler combien l’image populaire « est devenue un instrument de propagande, si puissant entre les mains des partis ». C’est dans Le Figaro, précisément, que Caran d’Ache oriente la bande dessinée vers le commentaire personnel de l’actualité, politique ou diplomatique notamment. Apparaît alors combien la feuille volante se doit de véhiculer un système de pensée collectif, préalablement dicté, si elle veut obtenir l’agrément des institutions et espérer reconquérir un public désintéressé. De l’économie du marché découle cette espèce de conformisme, éthique et civique, auquel les dessinateurs habitués à la liberté offerte par le journal doivent se plier (79). Ils le font avec plus ou moins de rigueur, nous l’avons vu, et le passage des histoires d’un support à l’autre en donne des exemples supplémentaires.
2. La circulation des images
Depuis toujours les imagiers ont puisé dans différents domaines leur source d’inspiration :
On peut affirmer, après toutes les recherches qui ont été faites dans ce domaine, tant en France qu’à l’étranger, que le graveur populaire s’est presque toujours inspiré, ou qu’il a nettement copié un modèle emprunté à un art qu’il jugeait plus raffiné, plus savant que le sien. Les images inventées de toute pièce par leur auteur semblent être d’une extrême rareté (80).
Ces copies pouvaient ainsi faire œuvre de vulgarisation, l’adaptation mettant à la portée du plus grand nombre les sujets tirés du grand art. Aucune vocation de la sorte dans les transferts qui concernent l’imagerie des dernières décennies du XIXe siècle. Les images passent d’un support populaire à un autre, d’une sphère culturelle à une autre, avec comme objectif premier celui de la rentabilité par économie de frais ou par la garantie d’un succès éprouvé.
Georges Pellerin alimente ainsi la collection des Histoires & Scènes Humoristiques par le rachat des droits de reproduction de bandes dessinées publiées par Le Pêle-Mêle, Le Chat noir et La Caricature (81). Odile Frossard donne la somme de vingt-cinq francs pour une histoire achetée au directeur de La Caricature en mars 1896 – il s’agit d’Une farce de Fourrier, n° 105 bis. La reprise d’histoires de presse représente pour l’éditeur un véritable gain d’argent : « si un dessinateur était payé soixante francs pour une planche avec l’abandon des droits de reproduction, l’Imagerie n’achetait une image à un dessinateur ou à un éditeur qu’entre dix et vingt-cinq francs » (82). À ce tarif faut-il cependant ajouter les frais d’adaptation ? La comparaison des planches publiées par voie de presse avec leur version en feuille laisse apparaître, en effet, un travail de transposition. Les images sont d’abord intégralement redessinées et manifestent un plus grand soin dans l’exécution. La mise en page peut être revue afin que des éléments comme un pied ou une coiffe ne sortent plus de la case et l’espace entre les images est souvent augmenté pour clarifier la lecture. Dans Le Modèle d’Albert Robida (n° 182), des petits dessins en arrière-plan illustrant une étape de l’histoire – lorsque le peintre Alfred Gulistan course le cochon qu’il veut prendre comme modèle – sont supprimés dans la même optique. Une séparation entre deux images rapprochées est ajoutée dans cette même feuille. D’une manière générale, les légendes sont également revues dans le sens d’une plus grande précision et pour qu’elles soient davantage conformes aux règles du Français écrit – ajout de majuscules, d’accents ou d’éléments de liaison. Une phrase conclusive, souvent moralisante, apparaît fréquemment dans la seconde version. En outre, les planches muettes se voient systématiquement augmentées de légendes, parfois versifiées et rimées, qui assurent la bonne interprétation de l’historiette. La signature du dessinateur peut disparaître de l’image populaire et les titres initiaux être conservés ou modifiés : le clin d’œil politique du titre de l’histoire sans paroles de Caran d’Ache, Aux prises avec trois jeunes anarchistes (La Caricature, 03.01.1885), est gommé dans l’image d’Épinal, Il était trois petits enfants. Chansonnette naïve sur l’air de : « La Légende de St Nicolas » (n° 140).
L’Imagerie artistique donne un exemple d’appropriation mais aucun indice ne permet de déterminer s’il s’agit d’un achat de droits. Signée par Victor Armand Poirson, l’histoire intitulée Pincé quand même (s10-n16, 1892) est directement adaptée de L’Arbre complice, publié dans La Caricature du 26 septembre 1891 (fig. 38). Poirson prend soin de redessiner entièrement la planche et en profite pour changer l’apparence et les vêtements des personnages. Mais il ne s’en tient pas là. La première version se compose de six cases sans légendes, où l’on voit un vagabond avec son ballottin échapper à un garde armé grâce au secours d’un arbre. Dans la seconde version, augmentée de trois images, l’homme est poursuivi par deux gendarmes et l’arbre ne l’épargne plus : il est « pincé quand même, et va pouvoir réfléchir aux dangers de se jouer de l’autorité ». Le glissement d’un support à l’autre occasionne ici une modification de contenu en faveur de la préservation d’une bonne morale. Le changement de titre, d’issue et de composition (nombre de cases, dessin des personnages et suppression des éléments qui dépassent du cadre) autorisent sans doute cette référence sans qu’il y ait strictement reproduction impliquant le paiement de droits. Une autre planche est à signaler comme étant inspirée d’une séquence du même journal. La ressemblance entre les deux histoires est bien moins flagrante malgré qu’elles composent toutes deux sur le phantasme de décrocher la lune : Une mauvaise farce, signée d’un énigmatique Rip (La Caricature, 14.01.1888), montre le peintre « surnaturaliste » Kromécobalt s’emparant de l’astre lunaire, grâce à une échelle, pour en faire un cadran horaire ; dans Un projet téméraire (s5-n13), du même dessinateur, le jeune Lucien tente en vain de s’emparer de la lune en escaladant un amoncellement de meubles surmonté d’une échelle. Comme précédemment, la fantaisie du gag journalistique fait place à un contre-exemple préconisant la prudence et la modestie – Lucien se blesse en tombant de l’échafaudage. Ici, le dessinateur ne fait que s’inspirer d’un motif lui ayant servi un peu plus tôt, les deux planches étant éditées la même année.
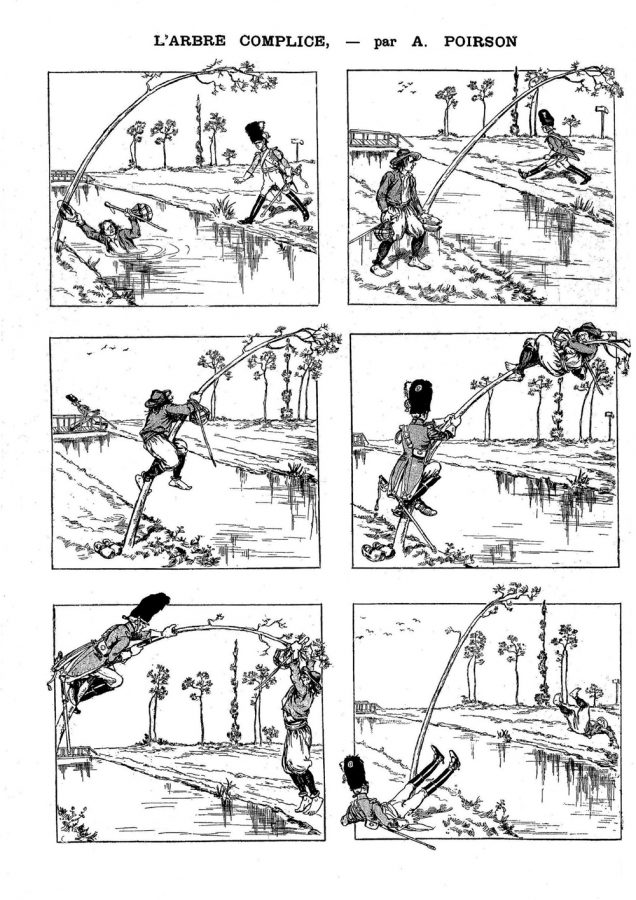

Fig. 38 – V. Poirson, L’Arbre complice, La Caricature, n° 613, 26.09.1891 et planche originale de Pincé quand même, Imagerie artistique, série 10, n° 16, 1892. Coll. numérisée de la Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
Comme les imagiers empruntaient des thèmes au pot commun de la culture, les dessinateurs de l’imagerie popularisée n’hésitent pas à puiser dans le vivier de gags disponibles et se faire l’écho de productions antérieures. Un exemple nous est donné par l’adaptation en bande dessinée d’un récit illustré pour la jeunesse. Il s’agit d’un court feuilleton écrit par Charles Plémeur et ponctué de vignettes signées B. Castelli, intitulé Le Lion désappointé et publié par La Semaine des enfants (n° 184 du 07.07.1860 et n° 185 du 14.07.1860). Il est mis en livre par l’éditeur E. Ardant en 1875 puis repris en 1876 dans l’ouvrage éducatif de Mme Doudet (pseudonyme de Théodore Lefèvre), Bébé sait lire. Suite au grand Alphabet-Album Bébé saura bientôt lire. Courtes historiettes enfantines servant d’exercices de lecture. Le feuilleton présente l’histoire de deux matelots, Cadet Verlinac et Anthime Géry, envoyés à terre remplir une tonne d’eau ; elle est racontée par un narrateur intradiégétique. Pour sa part, Mme Doudet écourte l’histoire pour ne conserver que le récit enchâssé. Seules les neuf illustrations restent inchangées mais leur disposition est simplifiée – dans La Semaine des enfants, les images devancent systématiquement les événements narrés si bien qu’une légende accompagnée de la référence au passage concerné leur est nécessaire. La planche Quantin réalisée par Théophile-Alexandre Steinlen s’intitule Le tigre emprisonné (fig. 39) et se contente de monter en séquence les illustrations redessinées du Lion désappointé. Les images donnent à voir la manière dont les deux matelots, devenus Mathurin et Paturot, échappent à l’attaque d’un tigre en l’emprisonnant sous leur cuvier, puis en nouant sa queue sortie d’un trou. Chacune des images reprend son modèle quasiment à l’identique : les angles de vue, le placement et la posture des personnages sont les mêmes. Du récit illustré à la bande dessinée, ne subsiste que l’essentiel de l’action, c’est-à-dire l’astuce défensive qui se prête parfaitement à une représentation visuelle. Au contraire des précédents cas d’adaptation, point de moralisation additionnelle mais plutôt une évacuation de tout l’appareillage éducatif entourant l’histoire. Quand la version de Plémeur pointait la filouterie et celle de Mme Daudet la paresse, Le tigre emprisonné de Steinlen ne souligne que l’ingéniosité divertissante des héros. Le dessinateur trouve la manœuvre féconde puisqu’il fait suivre cette feuille d’une variante construite sur un canevas strictement similaire. Dans Le Lion enfumé (s7-n5), le fauve n’est plus maîtrisé grâce au nouement de sa queue mais par des bouffées de fumée lancées par le jeune Yvonnet au travers du trou. Une fois encore, les deux planches forment une unité puisque l’on retrouve le personnage de Mathurin « appuyé sur le cuvier, [qui] racontait au mousse Yvonnet la mésaventure du tigre ». Face au lion qui bondit dans leur direction, le matelot « veut user du stratagème qui lui a déjà réussi ». Pour appuyer la continuité, le titre reprend le groupe nominal, et la mise en page, du découpage aux attitudes des protagonistes, est fidèlement reproduite. Graphiquement, des éléments de rappel sont placés, comme les aplats jaunes figurant le sol ou le médaillon laissant voir un bateau près d’une île. Ce médaillon non seulement fait pendant au carré introduisant la première planche et ouvrant sur une même scène maritime, mais prend place dans l’espace de la feuille à l’endroit où figure un imposant disque solaire dans Le tigre emprisonné. L’intention dissuasive à l’égard de la jeunesse semble ici absente puisque mousse et matelot « fumaient en causant ». Cette adaptation montre également que ce qui fait bande dessinée, au XIXe siècle en l’occurrence, est moins la découpe et la figuration des étapes de l’action que la mise en page et la successivité des images. Distribuées continûment, les vignettes illustratives en deviennent narratives et c’est donc le dispositif dans son aspect technique, le compartimentage, qui confère cette valeur au dessin. Le gag est récurrent puisqu’il connaît une cinquième version proposée par l’Imagerie Pellerin sous le titre Le Lion et les deux marins (Série aux Armes d’Épinal, n° 34, 1891), planche non signée et publiée un an après celle de la Maison Quantin. Il voyage jusqu’aux États-Unis parmi une série traduite en anglais et éditée spécialement, en 1894-1895 (83), pour « The Humoristic Publishing Company, Kansas City, Mo », comme indiqué sur les feuilles (84). Il n’y a pas d’accent édifiant là non plus, mais une morale parodique, de circonstance : « Always carry a barrel with you when you go amongst lions » (« Ayez toujours un tonneau avec vous lorsque vous allez parmi les lions »).
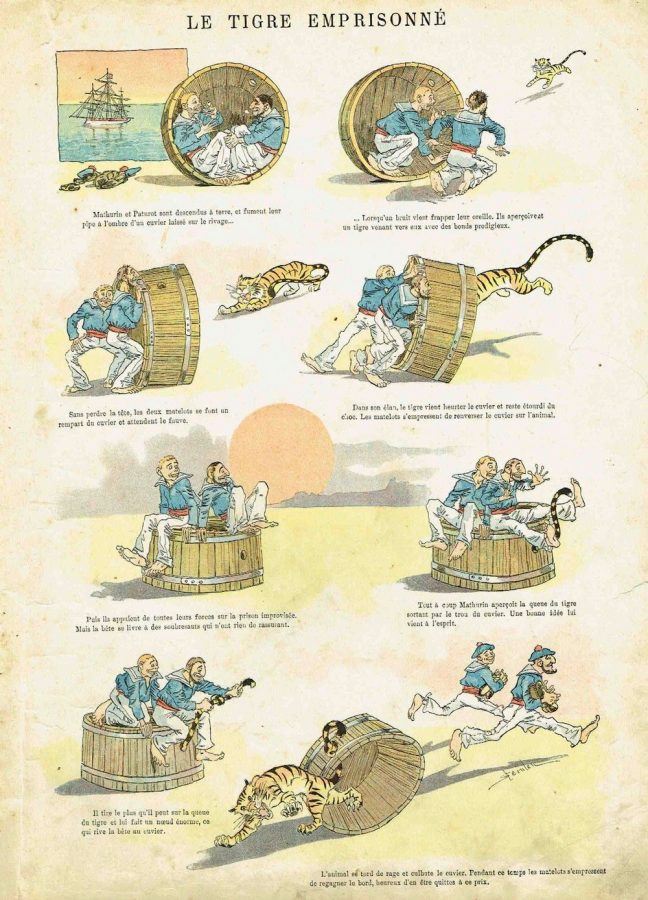
Fig. 39 – T.-A. Steinlen, Le tigre emprisonné, Imagerie artistique Quantin, série 7, numéro 4, 1890. Source : Töpfferiana.
Plus qu’aux productions nationales, c’est à la culture allemande que les planches de l’Imagerie artistique empruntent. En effet, et l’exemple des albums de Töpffer l’a bien montré, si le plagiat est considéré en France comme un vol depuis l’adoption des lois, certes peu efficaces, sur la propriété littéraire en 1791 et 1793, l’absence de législation internationale protégeant les droits d’auteur encourage la contrefaçon d’ouvrages étrangers (85) – dont les Belges se font la spécialité entre 1830 et 1845, comme Cham le caricature fréquemment. Albert Robida s’approprie ainsi un gag imaginé par Wilhelm Busch pour deux Münchener Bilderbogen (n° 300 et n° 301), intitulées Der Bauer und der Windmüller (« Le Paysan et le Meunier ») et publiées en 1861. Le dessinateur allemand y malmène un pauvre âne, attaché par son maître à l’aile d’un moulin et emporté dans les airs lorsque celui-ci est actionné par le meunier. L’animal en meurt et le paysan se venge en sciant le pied du moulin dans la seconde feuille. Dans Le moulin de Kerbiniou (s14-n1, 1897), Albert Robida ne conserve que la première partie de cette tragique histoire et en modifie la mise en page. À la recherche sans doute d’originalité, il propose une ligne de lecture serpentine indiquée par la numérotation des images au format variable. Cette souplesse lui permet d’exécuter une figure centrale imposante où le plaisir du dessin se manifeste dans le jeu de la perspective. Il s’écarte néanmoins de la distribution régulière des images choisie par Busch pour rendre le mouvement de l’hélice du moulin. Le dynamisme de ce gag parfaitement visuel fait donc place à la séduction du graphisme. Albert Robida (ou bien l’éditeur ?) choisit en outre d’adoucir l’issue de l’incident – le meunier « mit la tête à la fenêtre, reconnut le danger et arrêta son moulin » – et supprime toute action malintentionnée, le moulin n’étant plus sciemment mis en marche. La vengeance et la violence initiales – en prenant la scie, le paysan blesse le nez de sa femme d’où coule un filet de sang – font place aux conséquences malheureuses mais non graves du défaut de paresse. À noter que le dessinateur, rédacteur en chef de La Caricature, publie dans ce journal une bande dessinée encore inspirée de ce motif : alors qu’il déjeune au pied d’un moulin, un chasseur est emporté par une des ailes et entraîne avec lui ses deux compagnons, laissant aux chiens l’opportunité de finir le repas (Déjeuner de chasse, 18.10.1890).
Dans l’Imagerie artistique, comme dans les journaux en images, des séquences se révèlent être ainsi de véritables plagiats (86). Le tonneau de Diogène (T.-A. Steinlen, s1-n3, 1886) est de même directement calqué de Diogenes und die bösen Buben von Korinth (« Diogène et les garnements de Corinthe »), autre Münchener Bilderbogen (n° 350, 1863) signée par Wilhelm Busch : des enfants poussent le tonneau dans lequel repose Diogène, ils sont emportés par la force centrifuge et finissent littéralement aplatis. La bande dessinée est redessinée à l’identique et publiée dans L’Éclipse en 1870 (Diogène et son tonneau. Traduit de l’allemand, par Gédéon, 30.01.1870), puis le sujet est repris, un an avant la planche Quantin, dans le journal Le Musée comique. L’histoire est transposée par Gustave Frison dans l’univers de garnison – les enfants sont des Prussiens qui ennuient un sapeur – sous le titre Un Sapeur en grand’garde (1885). Elle s’inscrit à côté d’autres titres de ce journal, sans nom ou signés par Frison, directement copiés de séquences allemandes. Le Chien et le parapluie de Paul Steck (s13-n18, 1895) reprend également une planche d’Adolf Oberländer (Fliegende Blätter, n° 1731, 1878) intitulée Der Herr Professor und sein neuer Hund (« Monsieur le Professeur et son nouveau chien »). Chacune des cases y est strictement dessinée d’après le modèle allemand auquel est ajouté des légendes. Ces exemples illustrent encore, à la suite du développement sur la presse, combien la production outre-Rhin et notamment celle du père de Max und Moritz s’impose en France :
Combien de dessinateurs, étrangers ou français, depuis lui, se sont contentés de faire tremper une tablette de Busch dans l’eau claire de leur imagination, et, ne se vantant point de ces emprunts, ont pu gagner leur vie et leur renom à cette cuisine (87).
Aussi le directeur littéraire de la revue Le Livre et l’image, John Grand-Carteret, nuance-t-il à juste titre l’originalité de la collection : « imagerie artistique, d’un genre et d’un esprit entièrement nouveau, quelque peu inspirée des Fliegende Blätter et des Bilderbogen de Munich » (88). À propos du « livre à l’usage du petit monde », l’historien d’art évoque la « conception toute nouvelle de l’image », « de littéraire qu’elle était à l’origine, l’évolution est devenue artistique : la génération de 1830 visait, avant tout, l’esprit et l’intelligence de l’enfant ; celle de 1893 s’adresse de préférence à l’œil » (89). Il partage les inspirations de son temps en deux écoles : celle qui procède de Boutet de Monvel, « joignant à une certaine naïveté apparente un très grand caractère d’art », et celle qui « se résume en entier dans les histoires en images venues d’outre-Rhin, francisées par Caran d’Ache et par Job ». C’est en réaction à cette imprégnation de l’esprit allemand dans la production graphique, et sans doute aussi pour servir les intérêts de la République évoqués plus haut, qu’Albert Quantin souligne la dimension nationale de son Encyclopédie enfantine : « Enfin, il nous a paru convenable de ne pas mettre exclusivement sous les yeux de nos enfants les figures et les mœurs des pays étrangers. L’esprit français mérite d’être respecté et notre art n’a rien à perdre en restant national » (90). Pourtant, aux plagiats des séquences de Busch ou d’Oberländer s’ajoutent dans l’Imagerie artistique deux copies d’historiettes du Struwwelpeter d’Heinrich Hoffmann. La première concerne la feuille signée par Jules Maurel et intitulée Les allumettes (s5-n7, 1888). Elle reprend, avec de menues variations, la trame narrative de Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug (« Histoire lamentable de la boîte aux allumettes ») : Louis, équivalent de Pauline dans le modèle allemand, anime son jeu de soldats en allumant un feu malgré les recommandations parentales. Son vêtement s’embrase et ne reste que ses souliers le temps de l’arrivée des pompiers. Si l’invraisemblable fin est conservée telle quelle, un autre élément de merveilleux est en revanche gommé. Dans l’histoire d’Hoffmann, deux chats essaient d’avertir la fillette par la parole dont ils sont dotés :
Et les chats Minz et Tristapatte
La menacent avec leur patte,
Et disent, le doigt étendu :
Ton père te l’a défendu !
Miau ! jette cela par terre,
Ou tu vas brûler toute entière (91).
Dans Les allumettes, Louis a bien un compagnon félin, Minet, qui se contente de « proteste[r] à sa façon » : il tire sur le vêtement de l’enfant.
Le second plagiat est réalisé par Firmin Bouisset avec le titre La vengeance d’un nègre (s3-n15, 1886) qui reprend l’argument de Die Geschichte von den schwarzen Buben (« L’Histoire des enfants noirs »). Là encore, la figure justicière du Père Lustucru ou du grand Nicolas suivant les traductions (« große Nikolas » dans le texte original) est évincée – il punit les enfants qui se moquent d’un Maure en les trempant dans un encrier géant. Subissant les moqueries de Jeanne, René et Pierre, Bamboula prend lui-même sa vengeance par une punition identique. Ne paraît être conservé, dans les planches Quantin, que le fantastique mis au service d’une morale ancrée dans un univers profondément réaliste. Contrairement à l’album allemand où « l’introduction d’un élément de non-sens génère une conclusion hors morale qui désamorce la dramatisation des historiettes et produit l’effet comique » (92), les conséquences disproportionnées aux faiblesses des enfants servent d’abord ici d’avertissement. L’irréalisme des situations devient un moyen d’intimidation qui prête la main à la pédagogie par la peur. Avec son point de vue adulto-centrique, le narrateur des légendes se fait de surcroît juge rationnel chargé de maintenir les frontières du bien et du mal. Au jeune lecteur est ainsi rappelé combien les comportements présentés appartiennent au domaine du défendu. La leçon donnée par une résolution parfaitement irréelle se rencontre en revanche dans deux autres planches, au sujet d’un organe particulièrement apprécié des caricaturistes, le nez. Il enfle jusqu’à ce que Désiré soit comparé à un éléphant du Jardin des Plantes, avant qu’un « tondeur de chiens, coupeur d’oreilles » ne le scie (L. Malteste, Histoire d’un nez, s3-n2). L’« horrible passion » de l’enfant – mettre les doigts dans son nez – aboutit à une « terrible » opération qui sert la transmission des bonnes manières puisque devenu « un honnête père de famille », Désiré peut exposer à la vue son nez conservé dans un bocal « afin de préserver ses enfants du défaut de sa jeunesse ». Robert n’est pas moins corrigé de sa curiosité, son nez s’étant considérablement et irrémédiablement allongé, après que la famille au complet ait tiré sur l’enfant dont l’appendice était prisonnier d’une porte à laquelle il écoutait (Rip, Le nez de Robert, s4-n20). Ces exemples restent toutefois rares et dominent dans l’Imagerie artistique des évènements conformes aux lois universelles. D’une manière générale, les planches édifiantes jouent sur la participation empathique et pour cela maintiennent l’histoire dans un contexte vraisemblable. Lorsqu’un élément fantastique survient dans une histoire – hors les contes et les scènes entièrement situées dans un univers merveilleux –, c’est qu’elle ressort du domaine de la distraction pure et concerne des personnages adultes. Des titres comme Le sire de Grandplumet où les protagonistes sont pris dans la glace et dégèlent au coin du feu (E. Zier, s4-n10), Une histoire de chasse (O’Galop, s14-n4) et Les tribulations de M. Cornibus (s18-n6) où ils subissent d’impressionnantes déformations physionomiques après être passés sous la racine d’un arbre pour l’un, à travers une barrière pour l’autre, n’ont aucune prétentions éducatives.
Ces dernières histoires comiques reprennent finalement des motifs passés sous le crayon des dessinateurs de la presse satirique et humoristique. Parmi d’autres, un gag récurrent connaît une formidable circulation au XIXe siècle, celui de l’« arroseur arrosé ». Un billet sur le site Töpfferiana s’attache à retracer la chronologie des différentes versions, du Chat noir en 1885 au New York Herald en 1913 (93). Nous voudrions ajouter à l’inventaire une séquence muette parue dans Le Papillon sous le titre Le Système Kneipp ou l’Hydrothérapie à la portée de tous (20.07.1892, signature illisible) – il pourrait s’agir d’une réédition comme le journal en propose beaucoup. Parmi les variantes publiées dans la presse (Fliegende Blätter, La Caricature, Le Petit Français illustré), l’image Quantin se distingue puisque Hermann Vogel est le seul dessinateur à punir le jeune espiègle de sa blague. Sous la forme d’un pincement d’oreille, le « châtiment bien mérité » est donc donné à Auguste par son patron. Sous le crayon des autres artistes, l’arroseur parvient à s’enfuir ou se félicite de la réussite de la farce. Du dispositif de la feuille populaire, la composante symbolique est ici la plus fortement marquée, qui voit l’histoire enfantine véhiculer le système de valeurs éducatives, tandis que la version donnée par Christophe au Petit Français illustré (03.08.1889) prend le contre-pied de ce principe et confie à l’image seule le soin de transmettre le message pédagogique. Alors que la Maison Quantin ne peut laisser cette image distrayante sans l’aval sécurisant d’un texte orienté, la planche du Petit Français reste muette et le garnement impuni. Discrètement, les premières cases où le dessinateur place l’arroseur public en pied et au centre de la case s’apparentent au descriptif de ce métier sur le modèle des futures Leçons de choses en 650 gravures (94) (Armand Colin, 1895). Après avoir scrupuleusement observé les gestes de l’adulte et le matériel qu’il utilise, le jeune farceur met son apprentissage en pratique, si bien que l’arroseur devient « le cobaye involontaire de cette expérience comique » (95).
La collection Quantin ne fait pas que dupliquer des motifs, elle sème également les germes d’histoires passées à la postérité. Des similitudes sont ainsi à relever entre des feuilles de l’Imagerie et des planches de Little Nemo in Slumberland réalisées par Winsor McCay à partir de 1905. L’audacieuse construction en escalier de la planche de Rip mentionnée plus haut, Un projet téméraire, soulève le doute quant à son influence sur des séquences que l’Américain publie dans le supplément dominical du New York Herald, le 22 et le 29 octobre 1905 notamment. Pour sa thématique et son déroulement, Antoine Sausverd rapproche une autre planche de l’Imagerie Quantin, Un rêve agité (s1-n11), de l’épisode de Little Nemo publié le 15 octobre 1905 (96). Il note que le garçon qui chevauche en rêve son cheval de bois se prénomme Lucien, comme le personnage du Projet téméraire – le jouet est également présent dans cette planche, figuré en amorce dans la première case, comme un rappel. Un emprunt thématique semble également à l’origine de l’épisode du 5 novembre 1905 qui ressemble fort au titre Un cauchemar (E. Vavasseur, s11-n14, 1893). Aucun élément n’atteste la diffusion sur le sol américain de l’Imagerie, mais l’un des bulletins de la Maison Quantin fait mention d’une demande de reproduction des albums de l’Encyclopédie enfantine :
À l’étranger, l’Encyclopédie enfantine fut accueillie avec la même faveur ; des éditeurs des États-Unis et d’Europe nous demandèrent le droit de reproduire presque tous nos albums (97).
Dessiné par Raymond de la Nézière, le garnement de Conte rouge (fig. 40) semble de même l’ancêtre du jeune Buster Brown que Richard Outcault crée en 1902 – des épisodes sont publiés dans le New York Herald en 1903. Outre la thématique des bêtises enfantines, les deux héros arborent un costume marin et des cheveux clairs coupés au carré. Dans Conte rouge, le garçon use à mauvais escient de peinture écarlate qu’il verse dans un aquarium et qu’il applique sur ce qu’il trouve (chien, chat, portrait, vêtements). Un pot de peinture rouge accompagne également Buster Brown, qui lui sert à écrire la résolution de chaque fin d’épisode. Un autre personnage du fonds Quantin peut être considéré comme la préfiguration d’un héros célèbre, il s’agit du sapeur Gruyer d’Eugène Le Mouël (fig. 40) qui annonce le sapeur Camember de Christophe, dont les premiers épisodes paraissent en 1890. Les deux artistes, collaborateurs à Mon Journal, peuvent s’être croisés dans les bureaux des éditions Hachette qui publient le périodique, et avoir échangé des dessins ou des idées au sujet de ce personnage niais récurrent dans la bande dessinée au XIXe siècle (98), doté ici de noms de fromages.
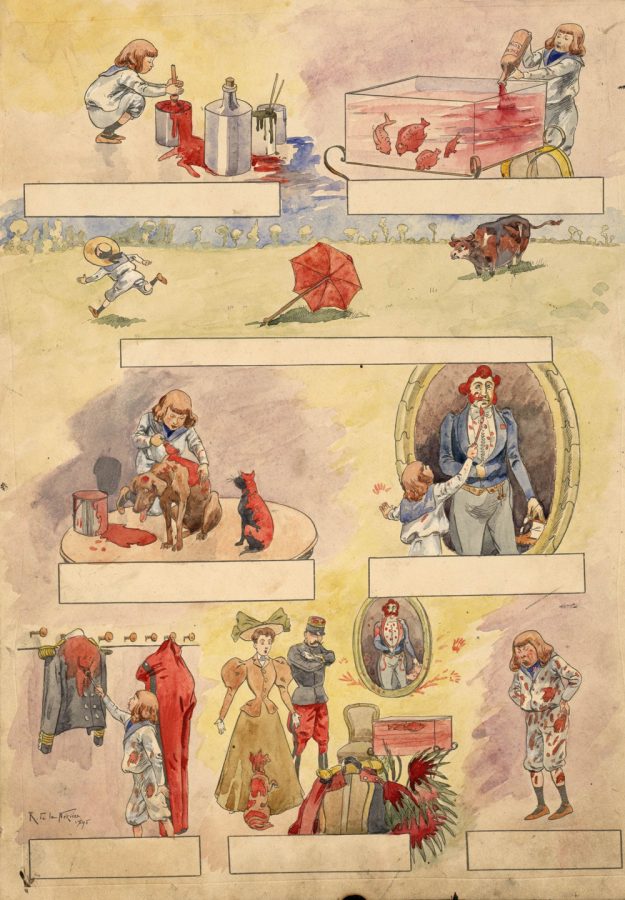
 Fig. 40 – Planches originales de R. de la Nézière, Conte rouge, Imagerie artistique, série 13, n° 17, 1895 et d’E. Le Mouël, Le Sapeur Gruyer, Imagerie artistique, série 1, n° 14, 1886. Coll. numérisée de la Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
Fig. 40 – Planches originales de R. de la Nézière, Conte rouge, Imagerie artistique, série 13, n° 17, 1895 et d’E. Le Mouël, Le Sapeur Gruyer, Imagerie artistique, série 1, n° 14, 1886. Coll. numérisée de la Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
La circulation des images se manifeste ainsi dans l’imagerie populaire des dernières années du XIXe siècle, et au début du XXe, selon différents modes qui vont du simple rachat de droits à l’anticipation thématique, en passant par la dérobade d’un effet comique et le plagiat. Dans tous les cas, il s’agit d’effectuer une plus ou moins conséquente révision des images comme des légendes : l’ajout d’un texte est bien une condition sine qua non de l’adaptation. Les histoires dessinées ne sont donc pas interchangeables en l’état d’un dispositif à un autre. La question de l’action sur le jeune public est au cœur de ces glissements de supports et confirment la complexité de l’Imagerie artistique : à la fois littérature de compensation (dont le rire s’oppose au sérieux du manuel scolaire) et support d’instruction. Précisément dans les opérations d’emprunt ou de déplacement, le dispositif imagerie tel que repensé par la Maison Quantin laisse ainsi voir ce qui fonde sa spécificité par rapport aux albums et aux rubriques journalistiques, en termes technique (efforts relevés en matière de lisibilité de l’image) et pragmatique (dessins nécessairement accompagnés de textes guidant l’interprétation). Seul l’aspect symbolique du dispositif reste relativement ouvert (valeurs axiologiques véhiculées ou non), l’Imagerie artistique s’offrant ainsi aux envies d’acheteurs au profil imprécis.
Finalement, tandis que l’Imagerie Quantin accentue la fonction narrative des dessins, en germe dans les premières images compartimentées, pour atteindre dans certaines planches la fluidité du langage initié par Töpffer, elle se défait timidement des traits que le pédagogue souhaitait précisément lui voir attacher et qu’il énonce dans les Réflexions à propos d’un programme (1836). Le rôle édifiant et la « mission civilisatrice » (99) dont il investit l’image volante se trouvent quelque peu nuancés par l’unique vocation de divertissement, d’amusement de certains titres, laquelle définit le mieux l’histoire en images au XIXe siècle – et plus justement encore celle des dernières années du siècle. Il subsiste bien, pourtant, de l’éducation dans l’Imagerie artistique, pour l’essentiel engagée dans la vaste ambition institutionnelle de développement du sens esthétique de la jeunesse. Le modèle verbal à travers lequel Töpffer pense la littérature en estampes (100) est en ce sens supplanté par une conception graphique de la feuille volante. Et, là encore, les valeurs artistiques que Töpffer louait dans l’imagerie – naïveté, gaucherie d’exécution, clarté et simplicité du trait linéaire – ne s’y trouvent plus ou presque, nous allons le voir dans la seconde partie. Cinquante ans et un bouleversement culturel séparent décidément ces deux conceptions du support de communication de masse.
> Page suivante : Partie II. Les langages de la bande dessinée au XIXe siècle. – Chapitre I. L’art de faire des images. – A. La technique au service de l’iconographie
> Page précédende : Partie I. Les dispositifs éditoriaux. – Chapitre II. Le journal. – B. À l’échelle du numéro
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 2, mai-juin 1886.[↩]
- Décrit dans l’introduction de ce travail et visible en ligne : http://collections.citebd.org/quantin/ (consulté le 15.05.2016).[↩]
- Toutes nos datations sont basées sur l’inventaire établi par Antoine Sausverd et Michel Kempeneers, « Inventory of the plates of the Quantin’s “Imagerie Artistique” », Signs, supplément au n° 1, 2007.[↩]
- L’inventaire d’A. Sausverd et M. Kempeneers donne les dates 1886-1892 : huit premières planches sont créées en 1886, quatre autres en 1890 puis huit dernières en 1892.[↩]
- L’Imagerie artistique s’inscrit dans le sillage des images Pellerin dont l’un des grands succès est un ensemble de soixante feuilles à image unique, intitulé Gloire nationale, Napoléon et gravé sur bois par François Georgin (1801-1863) : « Cette série fut réalisée de 1830 à 1845 : la monarchie de juillet avait réhabilité Napoléon, mais finalement le gouvernement de Louis-Philippe s’inquiéta de ce qu’il jugea être un dangereux appui à l’agitation bonapartiste. Les images furent censurées ou brûlées, et Nicolas Pellerin fut jeté en prison, preuve éclatante que les images d’Épinal avaient alors une influence immense », D. Petitfaux, « Les images d’Épinal », Le Collectionneur de bandes dessinées, n° 36, 1983, p. 31.[↩]
- En ligne sur Joconde, portail des collections des musées de France : http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0656/m500202_atpico041344_p.jpg (consulté le 15.05.2016).[↩]
- H. George, « De l’image populaire à la bande dessinée », Le Collectionneur de bandes dessinées, n° 79, 1996, p. 23.[↩]
- A. Renonciat, « Petit Poucet dans la jonchée des feuilles », Le Vieux Papier, fasc. 316, 1990, p. 208.[↩]
- Sans doute empruntée au papier peint et au décor des toiles de Jouy d’Oberkampf, ibidem, p. 207.[↩]
- Ibidem, p. 211.[↩]
- T. Groensteen, Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, p. 68.[↩]
- T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 2009, p. 136.[↩]
- Considérant la « situation » des figures dans les espaces donnés de son corpus de manuscrits médiévaux, François Garnier détaille les différents moyens utilisés par l’imagier pour signifier les rapports entre les éléments : « S’il a son importance, l’éloignement est souvent matérialisé, par des formes signifiantes ou non signifiantes. Car c’est la séparation elle-même plus que la distance physique, qui a valeur de symbole ». Les « formes non signifiantes » ne sont que des éléments séparateurs tandis que les « signifiantes » indiquent en même temps que la distance, la nature et les circonstances de l’éloignement. Parmi les séparations matérialisées par une forme non signifiante, se trouvent le tracé d’une lettre, une forme géométrique, un élément décoratif et un fond conventionnel, Le Langage de l’image au Moyen Âge. Signification et symbolique, tome I, Paris : Le Léopard d’or, 1982, pp. 98-102.[↩]
- Ibidem, p. 90.[↩]
- B. Peeters, Case, planche, récit, 1998, p. 22. Plus loin, il ajoute que « la bande dessinée repose, à chaque instant, sur une tension entre le récit et le tableau. Le récit qui, englobant l’image dans une continuité, tend à nous faire glisser sur elle. Et le tableau qui, l’isolant, permet qu’on se fixe sur elle », p. 39.[↩]
- F. Garnier, Le Langage de l’image au Moyen Âge, 1982, p. 59-63.[↩]
- La BD avant la BD, dossier de l’exposition de la Bibliothèque nationale de France, [en ligne], http://expositions.bnf.fr/bdavbd/index.htm (consulté le 15.05.2016).[↩]
- Chap. I.C.2. Illusions dynamiques.[↩]
- O. Frossard, Fonds de l’imagerie d’Épinal S.A. 48 J. Inventaire et index de La Série aux Armes, mémoire de DESS : Université de Haute-Alsace : 1989, p. 12.[↩]
- À noter que la mise en bandes des images n’est pas systématiquement synonyme d’histoire en images, comme en témoigne une planche Pellerin intitulée Le Marché (n° 466).[↩]
- P.-L. Duchartre et R. Saulnier, L’Imagerie populaire : les images de toutes les provinces françaises du XVe siècle au Second Empire, Paris : Librairie de France, 1925, p. 30 : « Ainsi les images, et jusqu’au XIXe siècle, n’épousent pas les styles successifs, elles sont et restent d’esprit gothique ».[↩]
- J.-Y. Mollier, L’Argent et les lettres : histoire du capitalisme d’édition. 1880-1920, Paris : Fayard, 1988, p. 156.[↩]
- B. Bouvier, « Pour une histoire de l’architecture des librairies : le Quartier Latin de 1793 à 1914 », Livraisons d’histoire de l’architecture, n° 2, 2001, p. 20.[↩]
- Chap. I.A.3. Les couleurs de l’imagerie.[↩]
- P.-L. Duchartre et R. Saulnier, L’Imagerie populaire, 1925, p. 28.[↩]
- Idem.[↩]
- W. Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris : Gallimard, 2008, p. 11 : « Avec la lithographie, les techniques de reproduction atteignent un stade fondamentalement nouveau. Le procédé beaucoup plus direct, qui distingue l’exécution du dessin sur une pierre de son incision dans un bloc de bois ou sur une planche de cuivre, permit pour la première fois à l’art graphique de mettre ses produits sur le marché, non seulement en masse (comme il le faisait déjà), mais sous des formes chaque jour nouvelles. Grâce à la lithographie, le dessin put accompagner désormais la vie quotidienne de ses illustrations ».[↩]
- Chapitre V, « Une concentration réussie, la SA des Librairies-Imprimeries réunies et la maison Quantin » dans L’Argent et les lettres, 1988, pp. 151-168.[↩]
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 5-6, novembre-décembre 1886.[↩]
- « La notoriété des auteurs, la qualité du papier et de la typographie, la valeur de la reliure ou du revêtement du cartonnage, l’abondance de l’illustration confiée aux meilleurs dessinateurs et aux graveurs les plus habiles, parfois même coloriée, tout concourt à faire de ces volumes des “livres-cadeaux”, que leur valeur marchande et artistique place bien au-dessus du “livre-récompense” de la distribution des prix », J. Glénisson, « Le livre pour la jeunesse », Histoire de l’édition française, vol. 3, 1990, p. 469. [↩]
- J. Grand-Carteret, Les Mœurs et la caricature en France, 1888, p. 528.[↩]
- Loin l’idée de l’imagier comme un petit artisan besognant avec sa famille et mettant tout son cœur à la préservation d’une entreprise patrimoniale. Pour garder un peu de cet esprit et surtout pour ne pas perdre l’acheteur, le nom Quantin est conservé sur les planches de l’Imagerie artistique malgré les différents changements dans la gestion de l’entreprise. On peut y lire les mentions « Imagerie Quantin », « Ancienne Maison Quantin », « Imprimerie-librairie Quantin » ou « A. Quantin Imprimeur-éditeur ». Seul Henry May ôte le prestigieux patronyme, remplacé par « Société française d’éditions d’art. L. Henry May ». Voir pour plus de précisions la liste établie par A. Sausverd, « The Imagerie Artistique of the Maison Quantin », Signs, 2007, p. 32.[↩]
- Ibidem, p. 27.[↩]
- L’absence de page liminaire et d’« oreilles » (mentions de l’éditeur) sur les planches permet généralement de distinguer entre album et recueil.[↩]
- Ces magasins généralistes ne vendent des livres qu’au moment de Noël, dans le cadre de l’exposition de jouets et d’étrennes : « il s’agit pour eux de profiter d’une période de vente intéressante par le volume de livres écoulés, mais aussi par leur nature : le livre d’étrennes est souvent un beau livre illustré, de ces volumes à reliure d’éditeur en percaline à décor, qui valent plus de 10 F…ou beaucoup moins s’il s’agit de soldes ressortis des réserves pour la circonstance », É. Parinet, « Le prix du livre : un vieux sujet de débat », Le Commerce de la librairie en France au XIXe siècle : 1798-1914, sous la direction de J.-Y. Mollier, Paris : IMEC éd. – Éd. de la Maison des Sciences de l’homme, 1997, p. 205.[↩]
- O. Frossard, Fonds de l’imagerie d’Épinal S.A., 1989, p. 15.[↩]
- Les compilations du centre spinalien sont introduites par la formule Pour Amuser Petits & Grands, suivie par Recueil de Petites Images d’Épinal ou Album (N°1) de 50 Images. Il y aurait dix numéros existants de cette série d’albums publiée dans les premières années du XXe siècle. Le premier volume est notamment réédité en 1980. Les ouvrages de Vagné portent quant à eux le titre Album d’Images pour garçons et fillettes.[↩]
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 5 et 6, novembre-décembre 1886. [↩]
- Cité par M.-E. Meyer, « La Lettre et l’esprit », Série encyclopédique Glucq des leçons de choses illustrées, Épinal : Les Presses de l’imagerie d’Épinal, 1997, p. 17.[↩]
- O. Frossard, Fonds de l’imagerie d’Épinal S.A., 1989, p. 13.[↩]
- G. Sadoul, « Les Origines de la presse pour enfants », Enfance, 1953, p. 373 et J. Adhémar, Imagerie populaire française, Paris : Electa, 1968, p. 150.[↩]
- A. Sausverd, « The Imagerie Artistique of the Maison Quantin », Signs, 2007, p. 29.[↩]
- Expression de Félix Vallotton (1865-1925) citée par D. Kalifa, La Culture de masse en France, 2001, p. 5.[↩]
- H. Morgan, Principes des littératures dessinées, 2003, pp. 165-174.[↩]
- A.-M. Thiesse, notice « POPULAIRE (Littérature) », Le Dictionnaire du littéraire, sous la direction de P. Aron, D. Saint-Jacques et A. Viala, Paris : Presses Universitaires de France, 2002, p. 459.[↩]
- J. Hébrard, « Les nouveaux lecteurs », Histoire de l’édition française, vol. 3, 1990, p. 526.[↩]
- « Le mot “populaire” renvoie à une classe sociale précise, à une réalité historique par rapport à laquelle justement se situent les partis politiques. Ne pas voir l’aspect politique du problème, c’est à la fois le fausser et adopter une position politique précise, qui consisterait à ignorer l’existence même du peuple, c’est-à-dire qui serait une position anti-populaire », M. Soriano, Les Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires, Paris : Gallimard, 1968, p. 480.[↩]
- L’Imagerie populaire, 1925, p. 13. Aussi, dans un article de P.-L. Duchartre : « La belle imagerie, de tous les temps, en exceptant l’imagerie industrialisée aux couleurs à l’aniline criardes et fausses qui ne relève plus de l’art populaire, est d’une grande distinction et richesse de couleurs, si peu nombreuses soient-elles », dans « Notes sur les origines de l’imagerie et des imagiers. Les sources d’inspiration et la couleur locale », L’Art populaire en France, 1929, p. 127.[↩]
- A. Renonciat, « Rodolphe Töpffer et l’image populaire », Le Vieux Papier, fasc. 327, 1993, p. 171 pour la première citation, fasc. 326, 1992, p. 132 pour la seconde.[↩]
- « Réflexions à propos d’un programme », Bibliothèque universelle de Genève, 1836, p. 314. Dans Le Peuple, où il rapproche également les deux catégories de personnes, Michelet souligne le penchant de l’enfant pour la forme narrative : « Que de fois en observant la forme historique et narrative qu’il donne aux idées même abstraites, vous sentirez comment les peuples enfants ont dû narrer leurs dogmes en légendes, et faire une histoire de chaque vérité morale ! », Paris : édition Calmann Lévy, 1877, p. 162.[↩]
- R. Saulnier, « De l’Imagerie Populaire à l’Imagerie Enfantine », Les Arts populaires en France, 1930, p. 161.[↩]
- Ibidem, p. 176.[↩]
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 2, mai-juin 1886, p. 14.[↩]
- Firmin-Didot, Ducrocq, Jouvet, Garnier, Delagrave, Marpon et Flammarion, Picard et Kaan, Dreyfous, Charavay, Lemerre… ; J. Glénisson, « Le Livre pour la jeunesse », Histoire de l’édition française, vol. 3, 1990, p. 476.[↩]
- Originaire de Touraine, Albert Quantin commence sa carrière dans le secteur du livre en entrant chez Mame, éditeur installé à Tours, en 1868.[↩]
- Réclame pour l’Encyclopédie enfantine publiée dans le catalogue des Librairies-Imprimeries réunies, 1890.[↩]
- Qui se font parfois narratifs : « Lorsque les abécédaires utilisent l’histoire en images, elle paraît comme un appendice de lecture suivie à la fin de l’abécédaire traditionnel, ou bien la lettre intervient dans chaque case à la manière d’une pagination sans lien d’illustration avec l’image associée : tel est le cas pour l’Alphabet de Pierrot. La collection “Alphabet des enfants sages” de Pellerin à Épinal recourt aux histoires en images ; les images populaires de l’éditeur sont alors présentées sous forme de livre », S. Le Men, Les Abécédaires français illustrés du XIXe siècle, Paris : Éditions Promodis, 1984, p. 40.[↩]
- Supplément littéraire du Figaro, 22.12.1888.[↩]
- P. Hamon, Texte et idéologie, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. 25.[↩]
- Si les enfants ici sont manifestement issus de familles déshéritées, aucune distinction sociale n’est faite dans l’art des espiègleries : enfants de la bourgeoisie, tel Léopold de la Flicotière (Il pleut des chats, s14-n3), et enfants de paysans se livrent aux mêmes bêtises.[↩]
- P. Hamon, Texte et idéologie, 1997, p. 207.[↩]
- De laquelle (entre autres) naîtra la fameuse loi d’organisation et de contrôle des publications pour la jeunesse, votée le 16 juillet 1949.[↩]
- Polybiblion, revue bibliographique universelle, partie littéraire, 2ème série, tome 29ème, 1889, p. 10.[↩]
- Les albums de la sorte que nous avons rencontrés portent les titres Album d’images enfantines et Imagerie artistique. 80 planches illustrées.[↩]
- Rapport présenté à Monsieur le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts le 11 avril 1881 au nom de la commission par Charles Bigot, Commission des écoles et de l’imagerie scolaire. Rapports et procès verbaux, Paris : Imprimerie nationale, 1881, p. 23 ; cité par A. Renonciat, « L’art pour l’enfant : actions et discours, du XIXe siècle aux années 1930 », La Licorne, n° 65, 2003, p. 203. [↩]
- Champfleury, Histoire de l’imagerie populaire, Paris : Dentu, 1869, p. 287.[↩]
- A. Renonciat, « L’art pour l’enfant : actions et discours, du XIXe siècle aux années 1930 », La Licorne, 2003, p. 203. La citation est une nouvelle fois extraite de la Commission des écoles et de l’imagerie scolaire. Rapports et procès verbaux, p. 35.[↩]
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 2, mai-juin 1886.[↩]
- Certains travaillent à la fois pour la Maison Quantin et le centre spinalien, comme Jacques Abeillé, Louis Bailly, Christophe, Caran d’Ache, Henri de Sta, Louis Döes, Félix Lacaille ou Eugène Le Mouël.[↩]
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 5 et 6, novembre-décembre 1886.[↩]
- Il édite, en 1888, Les Maîtres de la caricature française au XIXe siècle d’Armand Dayot ainsi que L’Art du rire et de la caricature d’Arsène Alexandre, en 1895.[↩]
- Chap. I.B.2. Académisme contre caricature.[↩]
- Catalogue de la Maison Quantin, 1885 ; cité par M. Gloc-Dechezleprêtre, « L’imprimeur-éditeur Quantin et l’architecte Édouard Corroyer (1835-1904) », Le Livre d’architecture : XVe – XXe siècle. Édition, représentations et bibliothèques, sous la direction de J.-M. Leniaud et B. Bouvier, Paris : École des Chartes, 2002, p. 83.[↩]
- P. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, 2005, p. 122 ; il cite : « Lemerre, Jouaust, Conquet, Launette, suivis par Pelletan, Quantin, Carteret, Romagnol, etc. ».[↩]
- Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, notice « Imagerie scolaire » écrite par A. Guesse, Paris : Hachette, 1882, p. 1320.[↩]
- Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, notice « Imagerie populaire » confiée à Champfleury, 1882, p. 1320.[↩]
- Les bataillons naissent du décret du 6 juillet 1882 relatif à l’éducation militaire dans les établissements d’instruction primaire et secondaire. L’enseignement est divisé en une partie théorique (discipline, affirmation des valeurs patriotiques, de l’héroïsme) et un entraînement physique (gymnastique, maniement des armes, exercices militaires). Ils disparaissent dans les années 1890. Voir A. Bourzac, Les bataillons scolaires. 1880-1891 : l’éducation militaire à l’époque de la République, Paris : L’Harmattan, 2004.[↩]
- L’absence de sanction aux mauvais tours faits aux prussiens, dans Le petit patriote (V. Poirson, s4-n13) et La farce du petit Alsacien (V. Poirson, s4-n16), trouve ici une justification. Certaines de ces planches qui exaltent le sentiment anti-prussien sont remplacées dans le catalogue après 1895 ; A. Sausverd, M. Kempeneers, « Inventory of the plates of the Quantin’s “Imagerie Artistique” », Signs, 2007. Pourtant l’une d’entre elles est rééditée en 1898 (date indiquée par le dépôt légal) avec quatre autres planches de Firmin Bouisset (Pierrot, La colère d’un concierge, La vengeance d’un nègre), comme le mentionne l’Inventaire du fonds français de Jean Adhémar, tome III, 1942, p. 221. A priori éditées à l’unité (les papiers sont de nature différente), elles portent les mentions de la première période de la société, « A. Quantin, imprimeur-éditeur » et « imprimerie-librairie Quantin ».[↩]
- À partir d’une planche de Christophe, nous verrons que les légendes communiquées par les dessinateurs sont soigneusement passées au crible afin d’éliminer les disjonctions texte / image ou les pointes satiriques. Aussi la teinte ironique présente généralement dans la voix narrative des bandes dessinées s’efface-t-elle au profit d’un commentaire le plus souvent normatif ; chap. II.B.1. De l’ironie töpfferienne aux jeux de mots.[↩]
- P.-L. Duchartre, « Notes sur les origines de l’imagerie et des imagiers. Les sources d’inspiration et la couleur locale », L’Art populaire en France, 1929, p. 134.[↩]
- La collection contient également des planches achetées à une certaine Imagerie Parisienne, à propos de laquelle nous n’avons trouvé que très peu de renseignements. Il s’agit d’une collection éditée par l’Imprimerie des Arts et Manufactures (apparemment tenue par M. Barnagaud, cette société imprime des journaux, des cartes et des affiches, elle est située 12 rue Paul-Lelong à Paris), en plusieurs séries et en albums. Les dessinateurs et le style des planches semblent être similaires à ceux des Histoires et scènes humoristiques de Pellerin et de l’Imagerie artistique de Quantin. John Grand-Carteret les rapproche d’ailleurs : « Adieu donc, vieux contes de fées, vieilles images d’Épinal aux histoires naïves, taillées dans le bois avec une rudesse primitive : toute une imagerie moderne est là qui n’a plus rien à faire avec les bonhommes, coloriés ou dorés, d’autrefois. Suites d’histoires qui, sous les titres de : Imagerie Artistique, Imagerie Parisienne, s’inspirent des Bilderbogen allemands, dénotent une très réelle tendance artistique et popularisent d’amusantes pochades signées : Steinlen, Ed. Zier, Firmin Bouisset, Caran d’Ache, Job, Le Mouël, Giraldon, Legrand, Fau, J. Blass », Les Mœurs et la caricature en France, 1888, p. 528. Le Musée national de l’Éducation, à Rouen, possède sept feuilles (dont l’édition est située en 1890) et un ouvrage de jeunesse (S.-E. Robert, Pour nos enfants. Récit patriotique, 1886) édités par cette Imprimerie ; le fonds du Musée de l’Image à Épinal n’en contient qu’une seule (qui pourrait être la couverture d’un album). En raison de son déménagement à Marseille (ouverture prévue en 2013), nous n’avons pas eu accès à la collection du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, anciennement Musée National des Arts et Traditions populaires.[↩]
- O. Frossard, Fonds de l’imagerie d’Épinal S.A., 1989, p. 15.[↩]
- Dates indiquées par Bernard Houot dans Vosges, encyclopédie Bonneton, Paris : Christine Bonneton éditeur, 2004, p. 66.[↩]
- La série semble compter soixante titres, numérisés et mis en ligne sur le site de l’Université de Floride : http://ufdc.ufl.edu/UF00078633/00001/thumbs (consulté le 15.05.2016). [↩]
- J.-Y. Mollier, « Le Siècle d’or du plagiat littéraire », L’Histoire, n° 152, 1992, pp. 73-74.[↩]
- On en trouve également dans la collection de l’Imagerie Pellerin, tel Le Jupon sauveur (n° 152). Non signée et publiée en 1895, la feuille reprend un gag développé en six cases par Gustave Verbeck dans Le Rire (17.11.1894), sous le titre Le Tigre punit par où il a péché. Le style graphique est nettement différent – la stylisation du trait ferme de Verbeck fait place aux détails d’un dessin plus académique –, les cases sont au nombre de neuf et accompagnées de vingt-quatre quatrains d’hexamètres à rimes embrassées, croisées ou suivies. Plus qu’au sourire à la vue d’un gag sans légendes, placé entre deux rubriques écrites du journal, c’est à la découverte de cette périlleuse étape du « Tour du Monde entier » de Miss Pédalfort, rapportée par un poète qui n’a de cesse de convoquer son lecteur, qu’invite cette planche. Du journal à l’image populaire, le motif gagne en envergure ainsi qu’une mise en contexte et en tension.[↩]
- A. Alexandre, L’Art du rire et de la caricature, 1892, p. 259.[↩]
- Le Livre et l’image : revue documentaire illustrée mensuelle, tome II, août-décembre 1893, p. 327.[↩]
- Ibidem, p. 328.[↩]
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 2, mai-juin 1886.[↩]
- Trim, Pierre l’ébouriffé. Joyeuses histoires et images drolatiques pour les enfants de 3 à 6 ans, Paris : Librairie Fischbacher, 1872, p. 6.[↩]
- N. Feuerhahn, Le Comique et l’enfance, Paris : Presses Universitaires de France, 1993, p. 66. Sur la fortune de l’album d’Hoffmann, voir N. Feuerhahn, « De Pierre l’ébouriffé à Crasse-Tignasse. La réception française du Struwwelpeter (Heinrich Hoffmann, 1845). Contribution à une histoire des échanges culturels comiques en Europe », Autour de Crasse-Tignasse : actes du Colloque de Bruxelles augmentés et illustrés, coordonné par C. Ermans et M. Defourny, Linkebeek : Théâtre du Tilleul, 1996, pp. 25-41. Nelly Feuerhahn y rappelle que le motif de l’enfant terrible circule d’abord dans la presse satirique, notamment avec la série de lithographies de Gavarni, Les Enfants terribles, publiée dans Le Charivari de 1838 à 1842, et dont Hoffmann se serait peut-être inspiré. L’engouement pour le thème est exploité par l’Imagerie d’Épinal, qui reprend les idées de Gavarni, pp. 32-33.[↩]
- A. Sausverd, « Arroseurs arrosés », Töpfferiana, [en ligne], http://www.topfferiana.fr/2010/10/arroseurs-arroses/ (consulté le 15.05.2016). Voir également L. Rickmann, « Bande dessinée and the Cinematograph : Visual Narrative in 1895 », European Comic Art, n° 1, pp. 2-19 et T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 2009, pp. 98-100.[↩]
- Parmi les historiettes du fonds Quantin du Musée de la bande dessinée, figurent des planches originales dans la même veine que les leçons de choses (aucun imprimé dans sa forme commercialisée n’a été conservé dans ces dossiers d’impression). Elles appartiendraient à la série de planches mentionnée dans les catalogues de la maison sous le titre Les Images des connaissances utiles. Antoine Sausverd suppose qu’elles ont été éditées en 1887-1888 au nombre de quatre : Les aliments, Le blé et ses produits, La culture du blé et Le Vin. Dans le fonds Quantin, nous trouvons six planches didactiques, non titrées et non signées (un « P » ou « JP » apparaît au bas des cases de certaines feuilles). Elles s’intéressent respectivement aux différentes sortes d’huile, aux produits confectionnés à partir de lait, à la fabrication du vin, aux produits issus de la culture du blé et aux activités de l’élevage, de la pêche et de la chasse. Sans les textes, il nous est difficile de déterminer la qualité narrative de ces images, l’enchaînement chronologique d’une planche comme celle consacrée au vin (des vendanges à la dégustation autour d’une table de convives) est néanmoins indéniable.[↩]
- A. Sausverd, « Arroseurs arrosés », Töpfferiana, [en ligne], http://www.topfferiana.fr/2010/10/arroseurs-arroses/ (consulté le 15.05.2016).[↩]
- A. Sausverd, « Le Petit Lucien au pays des rêves », Töpfferiana, [en ligne], http://www.topfferiana.fr/2008/11/le-petit-lucien-au-pays-des-reves/ (consulté le 15.05.2016).[↩]
- Bulletin de la Maison Quantin, n° 5 et 6, novembre-décembre 1886.[↩]
- Comme relevé par Antoine Sausverd, le sapeur Gruyer trouve lui-même un ancêtre dans le sapeur Tête-de-Loup de l’album La Perroquettomanie, publié à compte d’auteur et vraisemblablement à Marseille par Édouard Chevret en 1861 : « dans les deux histoires, le bonnet à poils, abandonné sur la voie publique par son propriétaire, provoque un quiproquo similaire : la coiffe hirsute, prise pour une bête dangereuse, effraie la population et doit être abattue ! », Töpfferiana, « La Perroquettomanie par Édouard Chevret », [en ligne], http://www.topfferiana.fr/2010/12/la-perroquettomanie-par-edouard-chevret/ (consulté le 15.05.2016).[↩]
- A. Renonciat, « Un théoricien de la “littérature en estampes” », Töpffer, 1996, p. 263. Elle précise que ce « moralisme était aussi lié à une sensibilité conservatrice », Töpffer se montrant, « au cours des années, de plus en plus hostile à une libéralisation du pouvoir, s’engageant même, lors des troubles populaires qui secouent Genève dans les années 1840, dans une lutte contre le “dégoûtant tumulte” [lettre à Dubochet du 5 janvier 1842, Un bouquet de lettres de Rodolphe Töpffer, 1974, p. 207] du parti radical » ; ibidem, p. 264. D’après Maurice Agulhon, Töpffer figure parmi les écrivains lus [avec Molière, La Fontaine, Augustin Thierry, Mérimée, Florian, Béranger, Casimir Dalavigne] lors de séances de lecture à l’usage d’un public populaire, organisées dans les années 1850 au Palais National sur mission du ministre de l’Instruction publique : « Ces noms évoquent moralité, patriotisme, libéralisme modéré ; ni révolution, ni cléricalisme » ; « Le problème de la culture populaire en France autour de 1848 », Romantisme, n° 5, 1975, p. 62. Aussi voit-on le Genevois exprimer des regrets à l’égard de ses propres albums : « Que si ces petits livres dont un ou deux seulement s’attaquent à des travers, ou taquinent des extravagances à la mode, eussent au contraire tous mis en lumière une pensée utilement morale, n’est-il pas vrai qu’ils auraient atteint bien des lecteurs qui ne vont pas chercher ces pensées-là dans les sermons, tandis qu’ils ne les rencontrent guère dans les romans ? », R. Töpffer, Essai de physiognomonie, 2003, p. 7. [↩]
- A. Renonciat, « Un théoricien de la “littérature en estampes” », Töpffer, 1996, p. 264 : « Comme le reflète la dénomination littérature en estampes, à une époque où l’on désignait les images populaires par les termes d’estampes, d’images ou de gravures – lesquels situent cette production dans le champ iconique qui leur est propre –, Töpffer les “dénature” en les concevant à travers un modèle verbal : “Le bon et le mauvais apprenti d’Hogarth, son Mariage à la mode sont certainement des ouvrages plus littéraires encore qu’artistiques”, précise-t-il [dans une lettre à Dubochet du 6 janvier 1841, Un bouquet de lettres de Rodolphe Töpffer, 1974, p. 109]. Et en effet, Töpffer regarde la littérature en estampes moins comme une expression artistique, fût-elle mineure, que comme “une pensée en tableaux” et, plus précisément encore, comme un discours figuré, dont l’esthétique obéit aux exigences de la rhétorique […] ».[↩]





