.
CARAN D’ACHE À TRAVERS SON TEMPS
par Herlé Luc-Michel
Peu de gens le savent, mais l’histoire de Caran d’Ache commence quarante-six ans avant sa naissance ! Étonnant, non ?…
1 – Le roman familial
Été 1812. Napoléon marche sur Moscou à la tête de sa Grande Armée, gigantesque et terrifiante coalition multinationale qui, forte de plus de 500 000 hommes, est alors la plus grande armada jamais rassemblée en Europe. Il y a là des soldats français bien sûr, mais aussi des Belges, des Hollandais, des Piémontais, des Romains, des Napolitains, des Suisses, des Portugais, des Autrichiens, des Prussiens, des Badois, des Wurtembourgeois, des Bavarois, des Hessois, des Westphaliens, des Saxons, des Thuringiens, des Mecklembourgeois, et même des Slaves : Polonais, Dalmates, Croates.

À cette « armée des vingt langues », comme l’a nommée le peuple russe, le tsar Alexandre Ier ne peut opposer que 250 à 300 000 hommes.
Fort de ses victoires passées dont beaucoup sont déjà légendaires, le Corse ne doute pas de sa supériorité sur Alexandre et ne soupçonne pas une seconde l’issue désastreuse de cette expédition qui va s’achever par la tragique Retraite de Russie – le terme de « déroute » serait mieux approprié.
Le bourbier de la guerre d’Espagne, qui avait sonné comme un avertissement quatre ans plus tôt et s’éternisait toujours, aurait pourtant dû rendre Napoléon moins sûr de son infaillibilité. Cette campagne russe va en tout cas apporter à toute l’Europe la preuve manifeste que le déclin de l’aventure impériale a bel et bien commencé.

Parmi ces grognards qui avancent à marches forcées sur les terres slaves se trouve un certain Victor Poiré, chef d’escadron au 7e chasseurs de la Garde. Poiré est un Lorrain originaire de Montigny-lès-Metz et sa bravoure lui a valu d’être décoré de la Légion d’honneur par l’Empereur lui-même. Tout comme ses compagnons, il vénère Napoléon ; tout comme eux, il serait prêt à le suivre jusqu’en enfer.
Et justement, c’est bien l’enfer qui les attend dans les immensités de ces steppes russes !

Les batailles qui se sont déroulées entre fin juin et début septembre n’ont pas été déterminantes et se sont toutes soldées par un repli des Russes, obligeant les troupes françaises à s’enfoncer de plus en plus loin sur le territoire. Mais ce que veut Napoléon, c’est une capitulation d’Alexandre.
Pour tenter d’enrayer la progression ennemie et sauver Moscou, le tsar fait appel au général Koutouzov. Celui-ci envoie 135 000 hommes, 25 000 cavaliers et 624 pièces d’artillerie prendre position près du village de Borodino, sur les bords de la rivière Moskova, à environ 120 kilomètres de la capitale russe.
Face à eux, Napoléon oppose 130 000 hommes, 28 000 cavaliers et 587 canons.
Les deux armées se rencontrent le 5 septembre. Les premiers affrontements, commencés en fin d’après-midi, sont interrompus par la nuit. La journée suivante, les deux camps s’observent et rassemblent leurs forces, se préparant pour livrer le lendemain cette bataille décisive que l’empereur cherche depuis le début.
Le 7 septembre, les combats commencent vers 6 heures du matin. Ils vont être d’une violence et d’une sauvagerie effroyables. Durant quatorze heures, les belligérants s’entretuent dans une mêlée épouvantable. Les tirs d’artillerie atteignent 140 coups de canon par minute – un record –, provoquant des pertes énormes. Napoléon lui-même, pourtant peu enclin à la compassion, dira dans ses mémoires que cette bataille fut la plus affreuse qu’il ait livrée.

Le bilan estimé de cette boucherie s’éleva pour les Russes à quelques 35 000 morts et 15 000 blessés. Du côté français, on dénombra environ 20 000 blessés et 10 000 tués dont les généraux Montbrun et Caulaincourt (1). Rajoutons à ça un nombre incalculable de chevaux, victimes éternelles et oubliées de la folie meurtrière humaine, sacrifiés sur tous les champs de bataille depuis l’Antiquité jusqu’à l’ère industrielle où les machines les remplaceront.
À la fin de cette terrible journée, les Russes, invaincus mais trop diminués pour espérer reprendre les positions perdues, décidèrent de se retirer, laissant le champ libre à Napoléon.

Aveuglé par cette victoire en trompe-l’œil, l’empereur reprit sa marche, ne se doutant pas du piège qui l’attendait : Moscou désertée, livrée aux flammes ; et surtout l’arrivée de l’hiver. Un hiver glacial, atroce et terriblement meurtrier, d’autant que, partie au printemps sans prévoir une campagne aussi longue, l’intendance française avait omis – erreur fatale autant que stupide – de se pourvoir en équipements chauds pour les soldats.
***

Le soir du 7 septembre, le chef d’escadron Poiré n’était plus parmi ses compagnons. La décharge à bout portant d’un peloton de Cosaques lui avait arraché une jambe, et il gisait dans le charnier du champ de bataille, sans vie… C’est du moins ce que pensèrent ses camarades qui, l’ayant vu dans cet état, le crurent mort et l’abandonnèrent là.
Or, bien qu’horriblement mutilé, il était encore vivant. Après avoir passé trois jours entre la vie et la mort dans ce cloaque de cadavres putrides d’hommes et de chevaux, il fut repéré par des Cosaques et emmené en détention dans une forteresse. Une famille polonaise des environs fut chargée de le soigner. La constitution de l’homme devait être d’une robustesse peu commune car, miraculeusement, il survécut… (2).
Il y avait là surtout une jeune fille, dont la tendre sollicitude le toucha jusqu’au plus profond du cœur… Vous devinez la suite. Le blessé aima la jeune fille, la jeune fille aima le blessé.
(Adolphe Brisson, Nos humoristes, 1900)
Combien de temps Poiré mit-il à se rétablir ? Certainement plusieurs mois. Après sa guérison, une fois libéré, il épousa sa belle Polonaise et, sur les instances de sa femme, renonça à rentrer en France. Le couple s’installa à Moscou (3). Napoléon avait alors fui la ville depuis bien longtemps, regagnant Paris à la hâte en abandonnant derrière lui les lambeaux de ses troupes, pitoyables fantoches hagards décimés en chemin par la faim, l’épuisement, les maladies, les tempêtes de neige, des températures polaires descendant sous les -20° C, et harcelés par des hordes cosaques qui poursuivirent les derniers survivants jusque dans la capitale française.


L’ex-grognard s’établit dans la ville des tsars comme maître d’armes malgré son handicap, sa spécialité étant l’escrime française (4). En 1826 naquit un fils prénommé Jacques, ou plus exactement Yakov Viktorovitch, c’est-à-dire « Jacques, fils de Victor » (5). Il reçut les enseignements paternels dans cette discipline, puis succéda à son père à la direction de la salle d’armes fondée par celui-ci, rue Neglinnaïa.

Dans cet établissement réputé de gymnastique et d’escrime viendront s’entraîner des personnalités comme l’écrivain Léon Tolstoï, un jeune professeur de théorie musicale et d’harmonie au conservatoire : Piotr Ilitch Tchaïkovsky, ainsi que des militaires et officiers. Il revient en effet à Jacques Victorovitch Poiré d’avoir introduit la pratique de l’escrime française dans l’armée russe, et l’hypothèse qu’il l’ait également enseignée à la Cour impériale est parfois avancée. Tout ceci témoigne en tout cas d’une réussite sociale certaine.

***
2 – De Moscou à Paris
C’est donc à Moscou, probablement au 17 rue Petrovka, que, le 6 novembre 1858, naquit Emmanuel Yakovlevitch Poiré (en russe : Эммануил Яковлевич Пуаре), cinquième ou sixième enfant sur les sept qu’auront Jacques Poiré et son épouse.
Notons toutefois que si cette date du 6 novembre est celle du calendrier julien (le calendrier grégorien ne sera adopté qu’en 1918 par les Bolcheviques), cela voudrait dire que le futur Caran d’Ache est né en réalité le 18 novembre selon notre calendrier.
L’aîné de la fratrie se prénommait Vitaly. Né en 1851, il mourra en 1902. Viendront ensuite :
Evguenia (1852-après 1916), Alexandra (1854-après 1916), Vladimir (1857-1898), Emmanuel (1858-1909), Alexander (18..?-1880 ?) et enfin Maria, surnommée Maroussia (1863-1933). Peut-être d’autres sont-ils morts en bas âge, comme cela était courant à l’époque…
La mère s’appelait Youlia (Julia) Andreïevna Tarassenkova, ce qui implique que le nom du grand-père maternel était Andreï Tarassenkov. Les parents de Youlia étaient de riches fabricants de tissus. Quant à Jacques, il éleva ses enfants dans le culte fervent de leur héroïque grand-père français et de la glorieuse Épopée napoléonienne.
L’imaginaire du jeune Emmanuel se développa donc très tôt autour de deux éléments absolument fondamentaux : la figure tutélaire omniprésente de ce grognard mythique, quasiment déifié ; et une attirance précoce pour le dessin, comme il l’expliquera plus tard :
J’ai toujours dessiné, c’était dans ma nature, et, à Moscou, je dévorais avec fièvre les biographies d’artistes dans les journaux illustrés. Les dessins militaires surtout m’attiraient, je les collectionnais. Le nom de Detaille, très en vogue, était pour moi l’objet d’une vénération particulière (…) Ma vénération pour les costumes militaires date de mes premières joies à feuilleter des pages de soldats.
(Caran d’Ache, cité par Émile Bayard, La caricature et les caricaturistes, 1900)
On rapporte qu’il avait lu dans un livre de Gustave Goetschy, Les jeunes peintres militaires, qu’Édouard Detaille, enfant, admirait les soldats parader au Champ-de-Mars… mais cet ouvrage n’a été publié qu’en 1878 et si Emmanuel en a eu connaissance, ce fut seulement après son arrivée à Paris. Quoi qu’il en soit, Detaille devint rapidement pour le jeune Emmanuel un modèle, une référence.
Que de fois Caran d’Ache m’a conté comment tout enfant, à Moscou (…), il s’échappait de la maison paternelle pour causer avec les gendarmes qui étaient de garde au théâtre. À 12 ans, il était ferré sur les uniformes et les passe-poils comme un vieux grognard. Il avait appris par cœur l’Annuaire de l’armée russe.
(Hugues Le Roux, Le Temps, 5 avril 1888)
Emmanuel fut élève au meilleur lycée de Moscou entre 8 et 18 ans, rêvant, une fois sa scolarité terminée, d’aller à Paris pour étudier à l’école des Beaux-Arts, rencontrer Detaille, et devenir, comme lui, peintre militaire.
Son grand frère Vitaly s’était engagé dans l’armée du tsar et il l’accompagnait parfois pour assister aux manœuvres à Krasnoïé-Selo, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Le souvenir marquant de ces scènes ne le quittera jamais.
En Russie (…) j’allais souvent voir manœuvrer la cavalerie cosaque dans les steppes. On les découvre à perte de vue ; ils passent au triple galop, ils s’éloignent, ils se perdent, ne forment plus qu’un mince ruban noir à l’horizon. Cela a pu me donner quelque sens du mouvement ; je croquais cela tant bien que mal. Un jour, j’ai vu des chevaux lancés bride abattue, de front, arrivant sur moi. Oh ! La place était fort intéressante du point de vue de l’étude des raccourcis… mais elle était pas mal critique au point de vue de la sécurité. Heureusement, un poteau était à proximité ; je me suis collé contre, me faisant le plus mince que je pouvais, et, sans perdre un détail, je me suis trouvé en pleine charge. Il a pu m’en rester quelque chose dans l’œil…
(Caran d’Ache, cité dans Le Journal des Artistes, 12 octobre 1890)

« Quelque chose dans l’œil »… On peut interpréter cette formule au sens propre, comme au figuré : l’œil d’Emmanuel a très certainement été impressionné par cette scène au point qu’elle soit restée gravée dans sa mémoire ; et un projectile a aussi pu le toucher et altérer légèrement sa vue car plus tard on le verra très souvent arborant un monocle à l’œil droit.
***
Puis arriva un moment où, se sentant décliner et prévoyant sa fin prochaine, le maître d’armes exprima la volonté qu’Emmanuel devienne militaire, lui aussi.
Mon fils aîné sert dans l’armée russe, lui déclara-t-il, tu serviras dans l’armée française.
(Adolphe Brisson, Nos humoristes, 1900)
Jacques Victorovitch Poiré mourut en 1877. Son épouse était décédée six ans plus tôt. Dès lors, plus rien ne le retenant à Moscou, Emmanuel signa une demande de rapatriement au Consulat de France, fit ses bagages et, début 1878, s’engouffra dans un train à destination de Paris, non sans avoir emporté le portrait du grand-père et sa Légion d’honneur, reliques qu’il conservera toute sa vie.

Des années plus tard, il se souviendra de ce périple :
Et dans quelles conditions ce voyage ! Imaginez-vous ce long trajet exécuté par étapes dans un misérable wagon de troisième classe, avec des bons de soupe pour manger en route, tout cela en compagnie d’un pauvre mécanicien français, venant de Moscou également, qui ne connaissait pas un traître mot de sa langue maternelle ! Ce furent de durs commencements dans l’existence dont je n’ai conservé aucune amertume.
(Adolphe Brisson, Nos humoristes, 1900)
Pourtant, l’arrivée à la frontière leur réserve une très mauvaise surprise. Ils descendent du train pour les formalités d’usage avant de poursuivre jusqu’à Paris, mais le commissaire de police auquel ils s’adressent leur répond : « On ne vous doit le rapatriement que jusqu’en France. Arrangez-vous maintenant comme il vous plaira, je ne puis rien pour vous (6). »
Nous pleurions tous les deux dans la rue (…) J’avais dans ma poche une traite de cent roubles sur une banque parisienne. Bien entendu, personne ne voulait me donner d’argent contre ce chiffon de papier. Nous ne savions plus que faire. Par bonheur, dans la gare où nous étions échoués, nous fîmes la rencontre d’un homme fort aimable, M. Paul Lindau, le consul d’Allemagne en Espagne, le frère du célèbre adaptateur de théâtre (7). Il nous questionna sur notre chagrin. Je lui fis voir ma traite qu’il mit dans son portefeuille, et en échange, en belle monnaie, il me donna l’équivalent de mes cent roubles.
(Caran d’Ache, cité dans Le Temps, 5 avril 1888)
La Russie que quitte Emmanuel pour ne plus jamais y revenir peine à sortir de la féodalité. Le tsar Alexandre II a bien engagé une série de réformes comme l’abolition du servage et la création d’assemblées provinciales mais, après avoir réchappé à plusieurs attentats, il sera finalement assassiné en 1881, avant d’avoir pu octroyer une constitution à son peuple.

Lorsqu’Emmanuel Poiré débarque à Paris, il a 19 ans. Proclamée le 4 septembre 1870, surlendemain de la bataille de Sedan où Napoléon III a été capturé, la Troisième République a connu des débuts tragiques et incertains. Aux traumatismes successifs de la guerre franco-prussienne, du siège de Paris, de la perte de l’Alsace et d’une grande partie de la Lorraine, de l’insurrection et l’écrasement de la Commune, a succédé une période de tentation monarchique sous le gouvernement ultraconservateur d’Adolphe Thiers, et il fallut attendre les lois constitutionnelles de 1875 pour que le régime républicain devienne pérenne.
Vaincu de Sedan, chef de l’armée versaillaise qui, sous l’implacable férule de « Foutriquet » (8), anéantit le temps des cerises communard dans un bain de sang, l’inénarrable maréchal Mac-Mahon est le deuxième président de cette jeune république. Il démissionnera en 1879, cédant la place au républicain modéré Jules Grévy.

Le 1er mai 1878 débute la troisième Exposition universelle de Paris sur le Champ-de-Mars encore vierge de toute tour Eiffel, ainsi qu’au palais du Trocadéro construit pour la circonstance. Elle fermera le 31 octobre. Probablement notre jeune Moscovite prit-il le temps de la visiter comme il le fera assidûment pour les suivantes…
Les années 1880 vont voir l’expansion coloniale de la France, ainsi qu’un rapprochement progressif avec la Russie qui aboutira, en 1892, à la fameuse alliance franco-russe destinée à contrer la menace germanique grandissante.

Pour l’heure, la France possède une importante épargne à placer en Europe et, justement, la Russie manque de capitaux pour poursuivre sa modernisation et son développement industriel.
Les célèbres emprunts russes ne sont pas loin.
***
C’est dans ce contexte qu’Emmanuel se présente pour revendiquer sa nationalité française et, conformément au vœu de son père, effectuer son service militaire comme engagé volontaire.
À cette époque, le service dure cinq ans.
Je voulus m’engager aussitôt à mon arrivée à Paris. Pourquoi plutôt au 113e régiment de ligne qu’autre part ? Tout simplement parce qu’ayant causé avec le planton en faction devant la porte de cette caserne, je fus gagné par l’amabilité de celui-ci, par sa bonne mine… Je ne connaissais personne, l’accueil chaud de ce sourire m’avait décidé ; les renseignements demandés au brave planton étaient, de plus, très engageants : bon colonel, excellent rata, discipline paternelle…
(Caran d’Ache, cité par Émile Bayard, La caricature et les caricaturistes, 1900)
Là, il est difficile de le croire sur deux points : tout d’abord, s’étant engagé à Moscou, il n’a certainement pas eu la liberté de choisir son régiment, son affectation lui étant imposée par l’administration. D’autre part, quand il prétend ne connaître personne à Paris, c’est oublier qu’à l’armée, il va retrouver un certain Adrien de Mortillet, un jeune homme de cinq ans plus âgé que lui et qui termine alors son service militaire. Entre 1872 et 1874, Mortillet avait séjourné à Moscou (9) où il avait fait la connaissance d’Emmanuel. Après son service, il travaillera pendant dix ans avec son père, célèbre archéologue et anthropologue dont il illustrera bon nombre de livres, et il deviendra lui-même préhistorien.
Les retrouvailles renouent leurs liens d’amitié et Adrien sera même à l’origine du futur pseudonyme d’Emmanuel, mais n’anticipons pas…
Les formalités d’incorporation à la 4e compagnie du 3e bataillon du 113e régiment de ligne sont accomplies le 20 (ou 21) février 1878.
Poiré s’adapte le plus aisément du monde à sa nouvelle vie de troufion. Son origine russe et son accent slave lui valent d’entrée un surnom : ses camarades de chambrée l’appellent « Poiroff ».
Il n’en oublie pas pour autant ses autres objectifs : entrer à l’école des Beaux-Arts et rencontrer le peintre Édouard Detaille.
Élève de Meissonier (10), spécialiste des scènes militaires, ayant acquis un statut d’artiste officiel, Detaille a juste 10 ans de plus qu’Emmanuel. Son grand-père avait également servi dans la Grande Armée où il était intendant. Detaille mènera une longue et glorieuse carrière de peintre d’histoire. Décoré de la Légion d’honneur, il deviendra membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1892, président de la Société des artistes français en 1895 et il contribuera à la création du musée de l’Armée à Paris. Il mourra le 24 décembre 1912.
Quelques temps après mon incorporation au régiment, je résolus d’aller bravement frapper à la porte de Detaille ; mais malheureusement j’ignorais le numéro de sa demeure, boulevard Malesherbes… Je m’adressai pour ce renseignement à un sergent de ville dont l’allure m’avait plu de suite (…) Justement l’agent connaissait Detaille ! « Tenez, me dit-il, voici sa maison, en face de vous ; j’ai souvent servi de modèle au maître peintre pour ses grenadiers de la garde notamment… Si je le connais ! »

Curieuse coïncidence… Je frappai donc chez Detaille, qui me reçut avec une parfaite amabilité ; je lui montrai mes dessins, auxquels il voulut bien s’intéresser ; il me conseilla fermement de faire des croquis d’après nature, dans la rue, partout, et, puisque j’étais au régiment, l’occasion était excellente pour moi de trouver des modèles à bon compte.
Très désireux de mettre au plus tôt à profit le conseil de Detaille, je me rendis un jour à la cuisine du quartier et tentai de décider un des cuisiniers, le nommé Bonnard, autant qu’il m’en souvient, à affronter les ardeurs… de mon crayon. « Viens te mettre là, je vais te tirer en portrait… » Bonnard, très enchanté, quitte aussitôt ses casseroles, ouvre des yeux très ronds et m’obéit à la lettre. Je rectifie la pose balourde qu’il me donne, après quoi, l’immobilité lui ayant été demandée, je commence mon croquis. Tout à coup, mon modèle chancelle, il devient pâle, puis cramoisi, puis vert, et finalement tombe en syncope dans mes bras… J’étais atterré. On prodigua aussitôt au malheureux Bonnard des soins énergiques, grâce auxquels il fut bientôt en état de me conter la cause de sa terrifiante indisposition. Figurez-vous que le pauvre cuisinier, préoccupé d’une immobilité parfaite, avait tout à coup avalé la chique qu’il gardait soigneusement au fond de sa bouche.
Croirez-vous que depuis ce temps, je n’ai jamais plus voulu dessiner d’après nature ? Je fus tellement épouvanté de cet accident, que je craignis toujours par la suite que pareille aventure ne se renouvelât ; les sollicitudes dont j’entourai mes « patients » furent à ce point compliquées, que je finis bientôt par me passer complètement de modèles (11).
(Caran d’Ache, cité par Émile Bayard, La caricature et les caricaturistes, 1900)
Dans un premier temps, les rapports entre Emmanuel Poiré et Édouard Detaille n’ont pas dû aller beaucoup plus loin que cette entrevue courtoise. Le maître ne prenait pas d’élèves et ses carnets personnels ne mentionnent son jeune visiteur que de façon anecdotique. Pour être objectif, il faut bien reconnaître que les dessins produits par Emmanuel à cette époque ne se signalent pas encore par une criante originalité. Son identité graphique si particulière se construira au prix d’un travail acharné, d’une profonde maturation, et on ne peut pas reprocher à Detaille de ne pas avoir su déceler le futur Caran d’Ache dans le carton à dessins du jeune soldat Poiré. De plus, de 1879 à 1884, la célébrité va éloigner Detaille de Paris pour beaucoup voyager en Europe, en Tunisie…

Mais leurs chemins ne tarderont pas à se recroiser. Emmanuel ne manquera jamais de témoigner sa gratitude et son admiration envers son aîné, et une sympathie réciproque, qui évoluera en amitié durable, les rapprochera, comme en témoigne, par exemple, ce souvenir de Francisque Poulbot (12) :
Il [Caran d’Ache] vint vers moi en 1908, au Palais de Glace (13), alors que j’installais sur leurs bancs d’école des petites poupées de son. Édouard Detaille l’accompagnait et les deux maîtres prirent dans leurs mains, tournèrent, retournèrent à la lumière mes figurines… J’eus des compliments, des compliments de Caran d’Ache, qui taillait dans le bois ses magnifiques soldats, officiers de tous grades ou demi-soldes.
(Poulbot, Humour Magazine, décembre 1950)
Quant à l’autre but fixé, être élève aux Beaux-Arts, Emmanuel ne le réalisera pas car il est nommé caporal en août 1878, et son régiment caserné au mont Valérien. Au mois d’octobre, il est affecté au 46e régiment (14), puis passe au ministère de la Guerre, attaché au 2e bureau de l’État-major, sous les ordres d’un colonel nommé Vanson. Là, il va avoir l’opportunité de se perfectionner car Vanson, ami du peintre Meissonier, est amateur d’art. Désireux d’utiliser les talents de son subordonné, il lui demande de dessiner des uniformes d’armées étrangères, ordre que le caporal Poiré exécute avec un réel plaisir, on l’imagine. Boulimique de dessin, il emploie ses heures de loisirs à se documenter et à s’exercer dans la science de l’anatomie de l’homme et du cheval.

***
Les cinq plus belles années de ma vie sont celles que j’ai passées au régiment (…) J’ai été caporal et je n’ai jamais voulu être davantage. C’est le plus beau grade de l’armée : on vit de la vie des hommes, on sent battre leur cœur, on partage leurs joies et leurs peines. Et c’est une vie admirable, avec ses levers matinaux, son grand air et ses longues marches. Ah ! les marches, quel souvenir pour moi ! J’avais la spécialité d’entraîner les hommes en chantant, et je leur battais la mesure sur un triangle. J’aimais cela. Il nous est arrivé de faire des étapes de quarante kilomètres et, une fois, je me rappelle que ma compagnie fut obligée de faire un rabiot de six kilomètres pour gagner ses cantonnements. Il était midi. La chaleur était forte. Nous avons eu un homme, un réserviste, je crois, qui fut pris de faiblesse. Je pris son sac et son fusil et, pendant une lieue (15), je portais deux sacs et deux fusils. Ainsi il n’y a pas de traînard dans la compagnie. J’étais heureux. C’était délicieux.


(…) Quand j’étais au régiment, il ne m’est jamais arrivé de punir un homme (…) J’en ai eu qui refusaient de balayer. Alors, je prenais le balai et je balayais moi-même. C’était… délicieux !
(Caran d’Ache, cité dans La Liberté, 19 mai 1899)

Il se sent donc comme un poisson dans l’eau, mais son caractère frondeur s’exprime aussi parfois. Ainsi, en 1879, il est suspendu de son grade de caporal pendant soixante jours pour « mauvaise volonté »…
***
Au bureau de l’État-major, il rencontre un capitaine des cuirassiers, Richard de l’Isle de Falcon, vicomte de Saint-Geniès, qui publie des articles dans la presse sous le pseudonyme de « Joyeuse », et écrit des romans, nouvelles, vaudevilles et comédies sous celui de « Richard O’Monroy ».
Le noble-officier-littérateur voit les dessins du jeune caporal, les trouve très amusants, et lui propose d’en faire pour La Chronique Parisienne. À l’automne 1880, c’est dans ce journal que sont publiés ses premiers dessins, signés E. Poiré, ainsi que cinq dessins de militaires russes pour « Michel Strogoff », d’après Jules Verne, dans La Vie Moderne (16).


Cependant, très vite, va se poser un problème. Une circulaire du ministère de la Guerre interdisait aux soldats et aux officiers d’écrire ou de publier quoi que ce soit sans une autorisation de leur hiérarchie. Après avoir signé un dessin de ses seules initiales dans Le Monde Parisien, le caporal Poiré se décide à prendre un pseudonyme pour contourner cette embarrassante contrainte.
Un pseudonyme, d’accord, mais lequel ? Brainstorming : … Euh… « Poiroff » ?… Non !… Euuuuhhh…
L’idée lumineuse vient d’Adrien de Mortillet qui lui suggère le mot russe карандашь (karandach), signifiant crayon et qui, une fois librement retranscrit en « Caran d’Ache », sonne comme un véritable nom français, empreint d’une distinction toute nobiliaire qui ne peut que séduire le dessinateur.
Emmanuel adopte cette proposition avec enthousiasme et signera même une couverture de La Caricature sous les deux formes, en alphabet cyrillique d’un côté, et en alphabet latin de l’autre (17).

.
Je n’aime pas beaucoup qu’on m’appelle « Mon cher Caran ». J’aime bien mieux qu’on dise Monsieur d’Ache, c’est plus distingué. J’avoue même que Monsieur le baron d’Ache me plairait encore davantage.
(Caran d’Ache, « Lettre d’Amérique », Le Figaro, 14 février 1895)
Détail amusant, « Dache » fut jadis le nom d’un perruquier des zouaves qui, pendant la guerre de Crimée, fabriquait des figurines en papier pour représenter des pièces comiques.
À suivre…
.
Chapitre suivant | Chapitre précédent | Iconographie | Sommaire
- Il s’agit là d’Auguste de Caulaincourt, dont le frère, Armand de Caulaincourt, était aussi général.[↩]
- Lorsque la Grande Armée quitta Moscou, environ un mois et demi plus tard, elle repassa par Borodino et d’autres blessés ayant réussi à survivre pendant tout ce temps furent retrouvés. L’effet psychologique sur les soldats fut désastreux.[↩]
- De nombreux soldats comme Poiré firent souche en Russie. Dans les années 1830, on comptait une diaspora française de 3200 personnes, rien qu’à Moscou.[↩]
- Unijambiste et portant une prothèse, il boitera toute sa vie. Certains textes disent qu’il avait également perdu un bras pendant la bataille. Ce n’est pas impossible, mais on imagine mal comment il aurait pu exercer son métier de maître d’armes amputé de la moitié de ses membres.[↩]
- Entre le prénom et le nom de famille, les Russes intercalent le « nom patronymique » indiquant le prénom du père, se terminant par les suffixes -vitch pour les garçons, ou -vna pour les filles.[↩]
- Caran d’Ache ne précise pas le lieu de cette gare frontalière. Cela se passait probablement du côté de Lunéville ou Nancy.[↩]
- En réalité ce diplomate s’appelait Rudolf Lindau, et son frère Paul était dramaturge, écrivain et journaliste. Il semblerait que la mémoire de Caran d’Ache ait inversé les Lindau…[↩]
- Surnom donné à Thiers[↩]
- Pendant son séjour, il fut successivement employé dans une usine de parfums, aéronaute, et jongleur dans un cirque ![↩]
- Ernest Meissonier (1815-1891) : peintre et sculpteur très célèbre à l’époque, spécialisé dans la peinture historique, représentant de ce qu’on appellera « l’art pompier ».[↩]
- Par contre, il utilisera parfois plus tard des lieux publics, comme les restaurants, pour observer et croquer discrètement les physionomies des clients, utilisant ensuite dans ses pages celles qui lui semblent les plus intéressantes. Mais il est vrai que, dans ces cas-là, les « modèles » ignorent qu’ils posent…[↩]
- Francisque Poulbot (1879-1946) : dessinateur des célèbres gamins de Montmartre qui, depuis, portent son nom : « les poulbots ».[↩]
- Une patinoire sur les Champs-Élysées, où se tenait le Salon des Humoristes.[↩]
- Dit « régiment de la Tour d’Auvergne », et pour lequel il dessinera en 1892 le programme de la fête annuelle donnée à la caserne de Babylone.[↩]
- Une lieue = environ 4 kilomètres[↩]
- Quelques mois auparavant, il avait déjà fait une lettrine pour La Vie Moderne.[↩]
- Vers la fin des années 1880, La Caricature publiera des dessins d’un auteur signant « Pencil », sans qu’on sache si c’était son vrai nom ou un pseudo anglais en référence à Caran d’Ache.[↩]









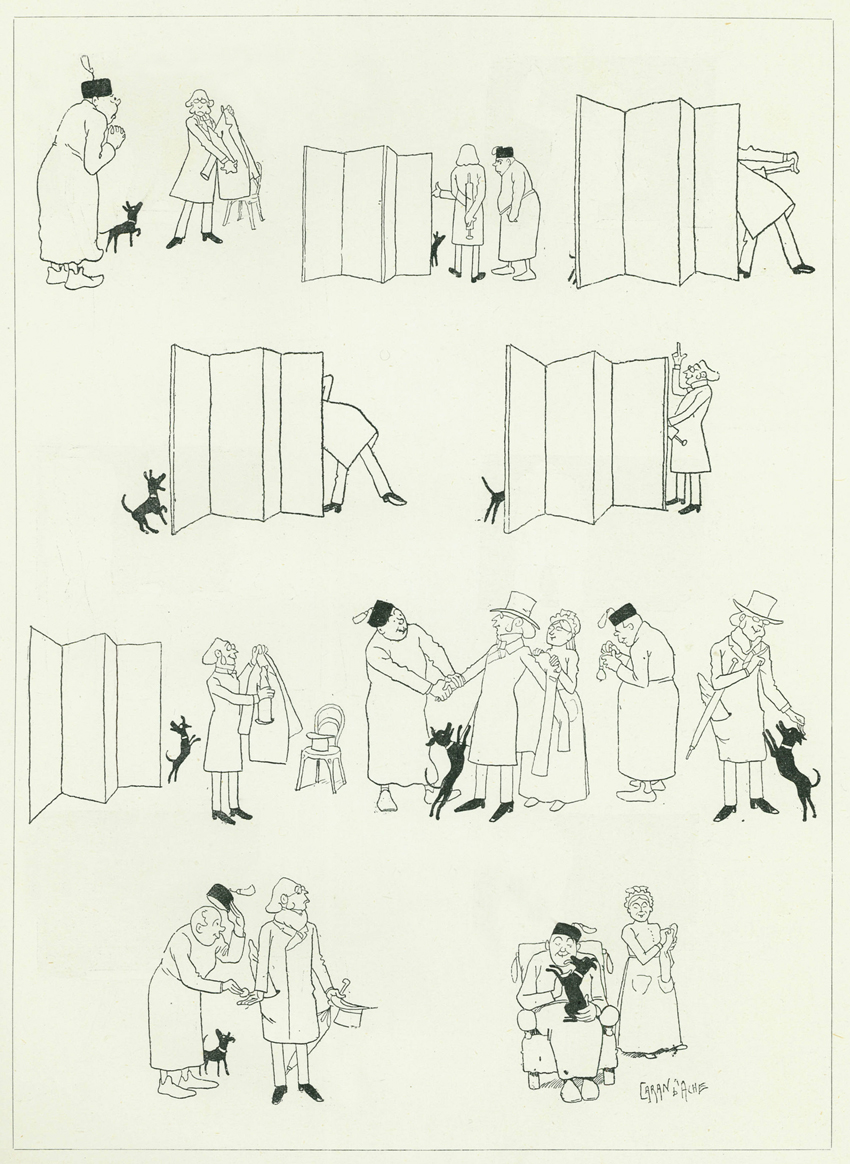

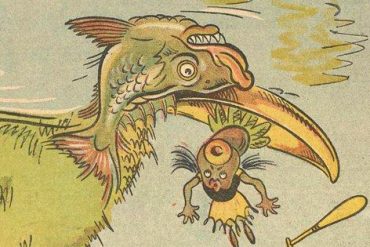
Merci pour tout cela.