. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)
[Partie II. – Chapitre I. L’art de faire des images]
Chapitre II. Le verbe dans le récit graphique
Les images de la bande dessinée au XIXe siècle partagent un certain nombre de leurs caractéristiques avec l’imagerie moderne (caricature, peinture, photographie) et transforment des procédés issus de l’iconographie plus ancienne (art rupestre, manuscrits médiévaux) en conventions propres à son expression séquentielle. Pensé par Rodolphe Töpffer comme une littérature en estampes, le neuvième art comporte également une dimension textuelle, restreinte dans le cas de la bande dessinée muette où seul un titre est généralement donné à lire. À une époque où la place accrue des images conduit à des réactions dans le champ littéraire, qu’en est-il de l’usage du texte dans le récit graphique ? Dans quelle mesure l’emploi du verbe dépend-il de l’inspiration puisée dans les autres médias, d’emprunts à des systèmes de représentation qui passent par d’autres supports et d’autres canaux ? Comme observé à l’égard de la facture des images, les légendes de la bande dessinée sont façonnées par les relations entretenues avec le récit excentrique mais aussi avec les genres où prend part le visuel, théâtre comique et littérature pour enfants notamment. Il s’agit ici de déterminer s’il existe un usage spécifique du langage dans la bande dessinée eu égard aux rapports, à déceler, du medium aux arts contemporains du langage. L’observation de l’apparence du texte, de son aspect visuel et des variations signifiantes de sa densité fournit en cela les premiers indices, donne des clefs quant au statut attribué au verbe dans la bande dessinée.
A. L’inscription visuelle du langage
1. Écriture manuscrite ou typographique
La liberté du trait revendiquée par Rodolphe Töpffer dans la réalisation des dessins s’applique de même à l’écriture des légendes, dont le régime manuscrit appuie le concept d’indissociabilité de la lettre et de la figure prôné pour la littérature en estampes. Le procédé autographique permet de réaliser conjointement, dans un même geste, les textes et les images, de les niveler par une unité de traitement. Le partage de la narration entre le « dit » et le « montré » se double ainsi d’une alliance structurelle immédiatement perceptible. Le caractère vivant et spontané de la graphie töpfferienne, sa « nonchalance visuelle » (1), est conservé par l’écriture manuscrite aux qualités plastiques et expressives occultées par l’imprimerie typographique. La calligraphie personnelle de l’artiste neutralise la froide convention du signe et les lettres fantaisistes (pourvues de longues boucles et d’entrelacs, comme dessinées) rapprochent la légende d’un énoncé oral, en train de se dire. Un rapport d’authenticité et de sincérité s’instaure dans ces mouvements de la main qui traduisent la pensée :
[…] toute proposition manque son but si elle ne se transforme en image, en action, en mouvement, si elle n’agit à la fois sur les sens, sur l’imagination et sur le cœur. Dans le discours d’un fougueux missionnaire, ce n’est pas tant le sens des paroles qui agit sur la foule attentive, ce sont bien plutôt les gestes, l’accent, la physionomie du harangueur : ce qui se voit plus que ce qui se comprend ; ce qui frappe, plus que ce qui persuade ou éclaire. (2)
L’écriture manuscrite préserve un peu de la spécificité du corps écrivant, pose une empreinte personnelle et instaure une relation indicielle, un effet de présence que ne permettent pas les caractères de plomb. L’accentuation expressive des jambages et des queues de lettres choisies s’associe aux oscillations et minuscules figures qui dynamisent les filets d’encadrement de la case pour rappeler les variations de tonalité du registre parlé – le fac-similé du premier manuscrit de Mr Cryptogame (cat. n° 17) laisse en outre découvrir ratures et ajouts, les aléas de la création. Comme ceux des Voyages en zigzag (récits également écrits à la main et autographiés), les émules les plus fidèles au style töpfferien donnent à lire des légendes manuscrites. À Genève, nous n’avons rencontré aucun album aux lettres typographiques, à Paris les albums de Léonce Petit, Georges Chicki et Louis Lemercier de Neuville présentent l’écriture toute personnelle de leurs auteurs, qui va de pair avec l’adoption du style croquis. L’écriture nerveuse de Léonce Petit s’apprécie notamment dans Les Mésaventures de M. Bêton, où son inclinaison vers la droite donne une impression de fuite en avant, crée un dynamisme qui coïncide avec le rythme frénétique du voyage. Les lettres bâtonnées franches et allongées (les barres des « T » sont spécifiquement appuyées), les formes bouclées et annelées des lettres rondes et les mots butant parfois contre le bord du cadre animent la page au même titre que les dessins et apportent à l’album un surplus de vivacité et d’expressivité.
Ces qualités de l’écriture manuelle ne sont pas préservées dans le reste des albums parisiens. D’abord, pour les contrefaçons des histoires en estampes comme pour l’ensemble de la Collection des Jabots, l’éditeur Aubert choisit une calligraphie anglaise élégante et relativement standardisée, faite de pleins et de déliés, probablement réalisée à l’aide d’une plume très fine (3). Dans la notice sur la contrefaçon de l’Histoire de Mr Jabot, Töpffer souligne non sans ironie « les légendes écrites en ronde excessivement soignée », évoquant ensuite les dessins « tristement fidèles et scrupuleusement alourdis » dont « on dirait l’œuvre du calligraphe distingué qui a écrit la ronde » (4). Par ce choix d’écriture appliqué à l’ensemble des Albums Jabot, Aubert fait donc prévaloir l’unité de la collection éditoriale au détriment de la singularité des graphies de chaque auteur. La finesse des déliés et la petite taille des lettres ont par ailleurs favorisé leur altération et rendent aujourd’hui la lecture laborieuse. Ces rondes calligraphiques, qui conservent encore, sous leur aspect codifié, le geste de la main, voisinent à l’occasion avec des caractères typographiques, qui servent à inscrire un commentaire métatextuel ou une intervention gnomique. Ce moyen de spécifier par l’aspect visuel de l’écriture une voix supplantant celle du narrateur figure à plusieurs reprises dans Deux vieilles filles vaccinées à marier où des caractères fins, aux empattements réduits, distinguent les remarques émanant d’une instance auctoriale implicite. La voix typographique ainsi créée est là pour placer un commentaire ironique, assurant la filiation avec l’Album Jabot publié quelques moins auparavant (5), ou explicitant des images déroutantes, comme les cases occultées – « (on déploie les serviettes) » (pl. 41). Inauguré par Cham, le procédé est prolongé par Gustave Doré dans Trois artistes incompris – où il donne une dimension historique à la rixe entre les trois compères et le conseil municipal, laquelle ameute la garde nationale et fait jouer les télégraphes pour prévenir le ministre (6) selon une réaction en chaîne démesurée reprise de Mr Crépin –, puis dans Des-agréments d’un voyage d’agrément où la voix s’incarne dans le personnage de l’éditeur, excusant les faiblesses du voyageur (7).
Le dernier album de Gustave Doré, Histoire de la Sainte Russie, se distingue par ailleurs dans l’emploi de l’égyptienne pour la page de titre (cat. n° 46). Il s’agit d’une police de caractère sans empattement, perçue comme monotone (symbole d’un pragmatisme économique anglais et menaçant) et opposée à l’idéal esthétique et traditionnel français des Didots :
C’est cette dernière forme de littérature issue de la caricature et où l’aspect visuel joue un rôle déterminant qui nous donnera notre seul exemple d’emploi dans l’imprimerie littéraire de caractères « grotesques ». La page-titre de l’Histoire de la Sainte Russie que Gustave Doré publie chez Bry Aîné, spécialiste des livres illustrés, en 1854 se présente en effet comme une véritable affiche qui fait coexister toutes sortes de caractères.
On notera surtout que les lettres choisies pour le mot principal, HISTOIRE, sont sans empattements, ce qui a tendance à lui donner une forte autonomie. L’arrivée de ces nouveaux et scandaleux caractères ne semble par ailleurs pas se faire facilement puisqu’une première page-titre, abrégée, qui précède conserve des caractères traditionnels pour le mot en question.
Doré a-t-il choisi lui-même les caractères, mis en scène les contrastes typographiques et ainsi en lumière la modernité radicale de son projet d’histoire en bande dessinée ? Difficile à dire. (8)
Cet emploi d’une typographie controversée au XIXe siècle (tandis qu’elle s’impose au XXe siècle) est d’autant plus remarquable que les autres albums voient leurs titres lithographiés, dessinés en fonction d’un effet purement esthétique et attractif. Pour les légendes, les cartonnés des éditions Aubert, Arnauld de Vresse et Martinet adoptent les mêmes lettres d’imprimerie neutres et parfaitement lisibles – une typographie utilisée, comme la calligraphie des Albums Jabot, pour les légendes et les titres des caricatures du Charivari et de La Caricature de Philipon. Caractérisée par l’empattement inférieur unilatéral des jambages, cette typographie marque une rupture définitive avec le régime manuscrit töpfferien. Parfois, le recours à la capitale sert l’inscription de titres qui prennent place sous les cases à la manière des dessins de presse, l’italique et le gras permettent quant à eux des effets de citation et soulignent les indications scéniques qui sont comme des didascalies. Seules les signatures autographes des dessinateurs, Cham en apposant presque à chaque planche, conservent un peu de la personnalité du trait. Une parenthèse pour noter ici que la signature caractéristique de Töpffer dans chacune des planches de Mr Jabot résonne dans celle de Bob, le narrateur d’Une Élection à Tigre-sur-mer, que Gyp place de même dans toutes les cases (9).
De Töpffer, un autre élément lié au régime de la lettre trouve une répercussion dans le corpus du XIXe siècle, il s’agit de l’intégration du texte dans l’espace réservé à l’image par le biais d’un courrier manuscrit. L’archétype est l’échange de billets passionnés entre la Marquise Caroline Thérèse de la Franchipane, veuve de Miriflor, et Alphonse du Jabot. Trois cases sont chargées de reproduire ces lettres, parodies de la déclaration d’amour : jeu sur le sens propre et figuré des mots typiquement romantiques (« feu », « flamme »), pudeur incomprise, (« Devinez le reste qui me coûte trop à dire », « Pour le reste, il me coûte trop à deviner »), accumulation de stéréotypes et emphase, (« un oui ! ou je meurs consumé »). Les formules et la mise en page usuelles de la lettre sont respectées, jusqu’à la signature, mais la graphie n’est pas adaptée, elle est identique à celle du reste de l’album. Enclin à modifier son écriture comme l’atteste sa correspondance, Töpffer ne la travestit pas ici, probablement pour ne pas créer d’hétérogénéité au sein de l’œuvre ; plus tard, il s’autorise pourtant l’effet dans l’Histoire d’Albert, lorsque l’apprenti poète reçoit une réponse de Mr de La Bartine, à qui il a adressé ses vers (pl. 12). Peut-être est-il alors poussé par les exemples ultérieurs, nombreux. Dès la contrefaçon de Mr Jabot par Aubert, le contraste est en effet appuyé entre les légendes soigneusement calligraphiées et les lettres dans un style d’écriture plus libre, l’écart étant plus ou moins marqué selon les différents tirages pour lesquels les missives sont réécrites. Il est nettement accentué dans le cas où l’écriture manuscrite de la lettre tranche avec les légendes en caractères d’imprimerie. L’effet de citation joue alors à plein, comme dans la case de l’album d’Albert Humbert où « le croquis ci-dessus donne l’autographe » du testament d’Anatole Balochard.
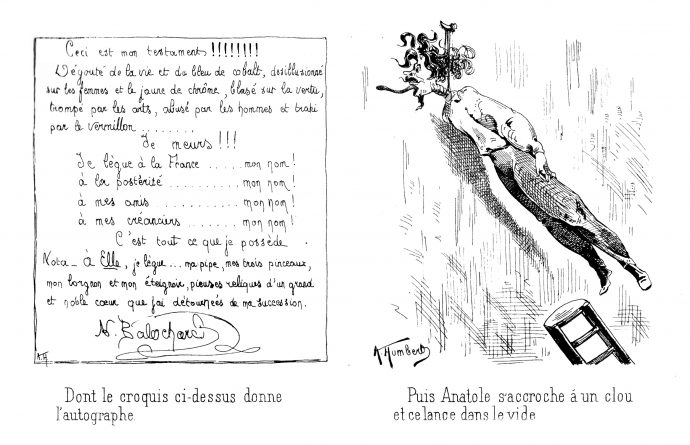
Fig. 68 – A. Humbert, Anatole Balochard, Arnauld de Vresse, 1866, détail pl. 5. Source : Collection J.-M. Bertin.
Dans le feuilleton des Aventures sentimentales et dramatiques de Mr Verdreau (L’Illustration, 1850), Stop différencie nettement la retranscription de la reproduction donnée pour véritable des lettres reçues par le personnage. Dans le premier cas, Mr Verdreau se fait traduire une lettre écrite « en caractères étranges », qu’il suppose être du Chinois (la case laisse voir de vagues idéogrammes), par un cousin qui « avait failli suivre un cours de mantchoux au Collège de France » : le contenu (parodie, là aussi, de la lettre d’amour) est donné en typographie. Dans le second cas, Mr Verdreau reçoit une lettre du « barbare époux » de l’« objet aimé » (10), cette fois écrite d’une main laissant voir l’agressivité de son signataire, « Duracuiros Kolk ». Également, dans la séquence de l’énigmatique Félix Igrec, Comment le jeune et trop galant Aimé Bourdonnot, droguiste en herbe, s’est reposé un beau Dimanche des fatigues de la semaine (Le Journal amusant, 16.09.1865), une lettre placée au centre de la partie supérieure de la page sert de prologue et indique l’enjeu de la séquence – adressée au jeune Aimé, la lettre d’« Honoré Chevillard, rentier » lui propose un déjeuner champêtre en compagnie de ses deux filles. Dans le contexte de l’impression typographique des bandes dessinées comme du reste du journal, la reproduction d’une écriture manuscrite fait donc office d’effet de réel, elle sert également la parodie de l’album de voyage, comme dans les Des-agréments d’un voyage d’agrément où le compte des dépenses quotidiennes (pl. 19), la chanson composée au sommet de noirs sapins (pl. 19) ou les essais de Passementerie (pl. 21) authentifient les croquis de Mr Plumet. Également dans La Famille Fenouillard, les appendices et pièces justificatives reproduisent les écritures des filles Fenouillard (« Extrait du cahier de romances de Mlles Fenouillard ») et donnent la parole à Agénor par le biais d’un récit épique qui fait l’objet d’une des Lettres choisies « conservées à la bibliothèque de Saint-Rémy-sur-Deule ».
Cette authenticité fabriquée sur le régime manuscrit fait le succès, dans L’Éclipse à partir d’avril 1868, des lettres du fusilier Onésime Boquillon à sa « chaire » Simone, rapportées par Albert Humbert. Lithographiées directement sur la pierre, les graphies malhabiles d’Onésime et de Simone s’assurent les sympathies des lecteurs pour leur côté populaire (11) : fautes d’orthographe et de syntaxe enrichissent leur parler caractéristique et font l’originalité de ces lettres où texte et images s’entremêlent continûment. En 1866 déjà, dans La Lune, le feuilleton de Gédéon, La première affaire du fusilier Pilor, reproduit dans le même esprit une missive que le jeune Pilor adresse à ses « chairs parrans ». Dans Le Chèque-Obsession, histoire contenue dans le Carnet de Chèques de Caran d’Ache, L’accent germanique du Juif corrupteur se lit dans les annotations manuscrites apposées sur le talon des chèques. Dans cette séquence comme dans le reste de l’album, les lettres d’imprimerie (utilisées pour la préface, les titres, les éléments récurrents du chèque) côtoient les écritures manuelles de différentes sources (signature de Caran d’Ache au début et à la fin, commentaires du corrupteur) ainsi que des taches d’encre, des empreintes digitales, des biffures, des dessins reportés au dos des chèques. Le réalisme de l’objet est parfait, le propos bien servi par ce bric-à-brac de signes, par cet assemblage composite – comme le député soumis à la tentation du chèque partout où il va, l’œil du lecteur est appelé de toutes parts, comme saturé. La confrontation du régime manuscrit et typographique de l’écriture sert ici la satire antisémite par l’imitation d’un objet réel. Elle peut être mise au service d’un gag, comme dans une séquence de Lourdey, intitulée Petites annonces (fig. 69). Elle commence par un personnage lisant Le Journal et à côté duquel prend place le court paragraphe imitant l’annonce lue, dans sa typographie et sa disposition caractéristiques (« UNE DAME jeune encore, ayant voiture, partagerait sa fortune avec premier joli garçon qu’elle verra »).

Fig. 69 – Lourdey, Petites annonces, Le Journal pour tous, n° 18, 29.04.1896. Source : Gallica.bnf.fr.
L’homme soigne sa présentation puis se rend sur le lieu d’un rendez-vous donné, il découvre une femme en fauteuil roulant tenant un panneau, écrit à la main, « AVEUGLE. Vous qui passez, daignez la secourir ». Fantasme et réalité s’entrechoquent d’un lettrage à l’autre, révélant à rebours l’italique du dernier mot de l’annonce, « verra ». D’une manière générale dans les journaux, le texte des bandes dessinées est plus volontiers imprimé comme le reste des rubriques, en lettres d’imprimerie standardisées. Simples et fonctionnels, adaptés aux cadences d’impression, les didones (fusion du caractère didot et du bodoni) semblent privilégiés pour leur précision et leur neutralité. Dans un journal comme Le Rire, quelques dessinateurs tracent néanmoins eux-mêmes leurs légendes, choix que font notamment Georges Delaw, Jules Dépaquit et plus occasionnellement Adolphe Willette, Fernand Fau et Raymond Radiguet (12). Comme dans le journal genevois Le Bossu, où toutes les histoires en images ont des légendes manuscrites, le graphisme de la lettre souligne un statut différent de celui des autres rubriques, contribue à l’identification de l’espace dédié aux dessins narratifs – les bulles, que l’on examine plus loin, s’assortissent également de lettrages manuels.
En ce qui concerne l’Imagerie Quantin, la typographie la plus neutre et transparente est de rigueur. C’est dans l’Imagerie Pellerin que s’observent quelques variations dans l’apparence des lettres, pour différencier diverses strates narratives. Commentaires, indications de régie, paroles de chansons et effets de citations sont notamment distingués par des italiques. Le régime manuscrit se fait rare, il marque un effet d’authenticité dans la planche attribuée au jeune Toto (Le petit Toto et les trois brigands, n° 396) ou d’oralité dans les bulles d’un personnage anglais (Les Anglais pourvoyeurs des Boers, n° 4142). Dans ce dernier cas, l’écriture manuelle conserve toute sa lisibilité en ce qu’elle relève du script qui se rapproche, en les simplifiant, des caractères typographiques. La compréhension du lecteur, dans l’histoire en images pour la jeunesse, prime sur tout autre effet, excepté lorsqu’il s’agit d’attirer l’œil par le biais des lettres de titrage.
2. Dessinateurs de caractères
C’est au XIXe siècle que l’art de la typographie se développe, les polices de caractères s’ouvrant à une floraison de formes aussi inventives que racoleuses. Il est rendu possible par la lithographie qui libère la lettre de la contrainte du plomb et laisse libre cours à toutes les fantaisies. Grâce à l’autographie, Rodolphe Töpffer dessine les titres des histoires en estampes, les lettres étant, sur certains premiers plats et dans les compositions des pages de titre, pleinement intégrées à l’image (elles forment un cercle autour des personnages, dans la seconde couverture de Mr Crépin, cat. n° 3) et s’en distinguant parfois à peine. L’entremêlement des mots du titre de l’album Voyage aux Alpes et en Italie (fig. 70) montre combien l’écrit crée un effet plastique avant même d’être lisible.

Fig. 70 – R. Töpffer, Voyage aux Alpes et en Italie, 1837, détail couverture. Source : Collection J. Droin.
Pour introduire les bandes dessinées comme les relations de voyage, la linéarité de l’écriture se plie, littéralement, à l’intention esthétique du dessinateur, elle emprunte la forme du zigzag, métaphore romantique, invitant le regard à la libération perceptive conforme à l’hédonisme revendiqué de l’œuvre. Le frontispice des Voyages en zigzag (Dubochet & Cie, 1844) illustre cette manière d’intégrer la lettre au motif au point qu’elle en devienne l’un des éléments graphiques.
Le titre réalisé par Charles DuBois-Melly pour la couverture de l’album Robinson (cat. n° 7), où des lettres prennent place au cœur d’une agglomération de figures humaines à peine esquissées, s’inspire des premiers plats des histoires en estampes. Les Albums Jabot, de même, affichent des couvertures où les titres lithographiés confèrent aux lettres une visibilité particulière par le biais d’un effet de texture, par des formes et des tailles diverses. Mises en couleur comme le reste du décor de style rococo où elles prennent place, elles se font l’image prospective de la fiction. Les titres de Mr Vieux Bois (cat. n° 20) et de Mr Lamélasse (cat. n° 23) l’illustrent notamment : le premier est composé de morceaux de bois mort, le second, de tiges de cannes à sucre. Avec la Collection Jabot, la bande dessinée participe pleinement du nouveau mode de présentation du livre qu’est la couverture illustrée, espace hautement stratégique une fois investi par la vignette romantique. La lettre contribue à l’attraction visuelle, elle s’intègre au décor, s’inscrit à l’intérieur d’un cartouche ou d’une banderole (Deux vieilles filles vaccinées à marier cat. n° 28, Un Génie incompris cat. n° 29). Elle renoue avec le procédé ancien de la figuration de l’alphabet (13), mélange serré du texte et de l’image annonçant le contenu de l’album. Le récit de chasse de Mr de la Canardière s’ouvre et se ferme ainsi sur les mots du titre (cat. n° 36) et le mot « fin » figurés à partir d’éléments représentatifs (fig. 71). La canardière (fusil employé pour la chasse aux gibiers à plumes) se lit en même temps qu’elle se voit, le mot étant formé à partir de fusils, de chiens, de canards, de lapins, d’oiseaux et autres petits animaux des bois, des « alphabêtes » pour reprendre l’expression de Raymond Queneau. Le mot de la fin dit combien l’expérience est laborieuse, les lettres étant constituées du personnage à l’allure défraîchie, se prenant une douche, que l’on suppose froide, sur la tête.
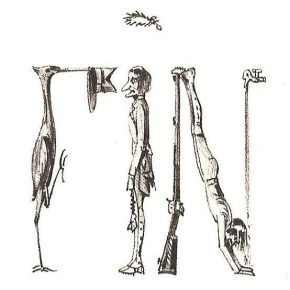
Fig. 71 – H. Émy, Mr de la Canardière, fac-similé éd. Marval, 1979, épilogue. Source : coll. personnelle.
Sur la couverture de l’Histoire de la Sainte Russie (cat. n° 46), Gustave Doré laisse le futur lecteur entrevoir l’atmosphère d’un album où les statuts de l’image et son rapport avec le texte sont sans cesse repensés. Le mot Russie y est dessiné à partir de personnages torturés et torturant, lettres « vivantes » agrémentées de gouttes de sang imprimées dans le même rouge qui sert, en alternance avec le vert, à inscrire la titraille. Ce mode de communication ludique, fondé sur les qualités plastiques de la lettre, est à rattacher à la vogue des rébus journalistiques où les lettres prennent jambes et bras, comme à celle des abécédaires, dont Aubert s’est d’ailleurs fait une spécialité (14). Une case d’Un Génie incompris en est une référence directe : alors qu’il fait le désespoir de son professeur de langue française, « par son assiduité à ne rien faire du tout », Barnabé se livre à l’anthropomorphisation embryonnaire de l’ABC, l’alphabet n’étant plus pour lui « qu’un régiment de 25 hommes » (pl. 10). Rappelant les origines imagées des lettres, Jean-Jacques Grandville donne de beaux exemples d’animation de l’alphabet, avec les titres des Métamorphoses du jour (1829), des Scènes de la vie privée et publique des animaux (1842) ou des Fleurs animées (1847). Dans Un Autre monde (1844), les titres des chapitres s’écrivent dans des polices chaque fois renouvelées tandis que sur le premier plat, les lettres s’incorporent au dessin par leur disposition, leur mise en couleur et en relief. Non restreints à la surface de la page, le nom de Grandville et le titre de l’œuvre sur l’affiche de lancement font danser le regard par leur allure multidimensionnelle. Dessinées selon une perspective axonométrique (l’assise matérielle est appuyée par l’ombre qu’elles projettent), les lettres deviennent des objets monumentaux à part entière, inscrits dans la profondeur et l’ordre spatial de la composition. Par cette dénaturation de l’écrit, l’affiche comme la couverture font participer la lettre de l’image et annoncent parfaitement l’enjeu du livre où la gravure prend l’ascendant sur le texte.
C’est une manière, également, de mettre en perspective la question sensible au XIXe siècle, tant en littérature que dans les arts graphiques, du relief ou du volume. En peinture, les préceptes de l’école du néo-classicisme prônant l’apprentissage de techniques picturales éprouvées (15), pour atteindre une perfection pensée notamment en termes de modelé, sont désavoués par les peintres du mouvement impressionniste pour qui ces illusions données d’un relief accusé masquent la réalité des choses telles que l’œil les voit, ne sont qu’idées préconçues et représentations artificielles – on pense aux Menus propos d’un peintre Genevois de Rodolphe Töpffer. La science du modelé que le chef de file de l’art traditionnel, Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), met en œuvre dans une toile comme La Grande Baigneuse (1808) se voit préférer dans la seconde moitié du siècle la traduction d’une vision spontanée de l’artiste, la sincérité dans le traitement des couleurs et des ombres, dans le rendu du mouvement (16). La recherche n’est plus celle d’une perfection des formes guidée par l’art de l’Antiquité grecque, la sculpture au premier rang, mais de la traduction d’une sensation particulière, d’une tonalité lumineuse ou d’une atmosphère éphémère. Comparées à l’art officiel, les toiles des impressionnistes se verront reprocher leur manque de fini mais aussi leur platitude, leur absence de profondeur. L’image plane est aussi et surtout, au XIXe siècle, l’image industrielle, commerciale, multipliée à l’infini et sans aura. Spectaculaire nivellement iconique qui produit des réactions parmi les écrivains iconoclastes, un rejaillissement direct de l’impact des images dévaluées sur la littérature où émerge une « esthétique de la platitude » (17). Philippe Hamon évoque en ce sens les procédés stylistiques qui témoignent de cet impact des images à voir sur l’image à lire, comme le « collage » qui consiste en la juxtaposition de slogans, de clichés issus des enseignes, des prospectus commerciaux, ou le « mouvement de défiguration du texte » par lequel toute image littéraire, toute métaphore garante de l’instillation d’une épaisseur de texte, d’un effet de perspective par des analogies suggestives (18), est évacuée du récit. La question du relief est au cœur des nouvelles esthétiques, elle constitue l’un des enjeux de la modernité. Peut-être cette profondeur donnée aux lettres des titres évoqués doit-elle marquer l’écart avec l’image plate, insignifiante et mercantile, montrer l’art du lithographe dans l’égalisation, par les multiples effets optiques, de la vision binoculaire offerte par le stéréoscope (19). Mais la couverture des albums, nous l’avons dit, emprunte aux affiches, manifeste comme elles le « délire typographique propre à l’époque romantique » (20). Sur le mode du « jaillissement » (21), les titres déclinent de multiples formes typographiques : accentuation décorative des empattements, lettres ombrées, ornées, éclairées, anamorphosées, grasses ou maigres. La couverture des Trois artistes incompris et mécontens (cat. n° 41) déploie, pour l’inscription du titre, du sous-titre, du nom de l’auteur, de la maison d’édition et de son adresse, pas moins de douze polices différentes. Au jeu sur la forme et la texture de la lettre se joint une recherche dans la disposition des syntagmes qui sont placés de manière penchée, incurvée, ondulante ou encore pyramidale par variation du corps des lettres. Cette hétérogénéité des énoncés en fait des éléments que le passant ou le potentiel lecteur apprécie d’abord visuellement ; elle doit attirer et surprendre par la fusion des deux systèmes de code, comme sur la couverture du Punch à Paris (mensuel créé par Cham en 1850) où les mots dessinés se détachent à peine du décor, sur le modèle du journal anglais.
Objet symbole de la sémiotisation de la rue, tendant à l’effet, l’affiche est mise en case par les dessinateurs. Elle est racoleuse dans Mr Crépin (planche 86, Craniose se ruine en affiches pour trouver des souscripteurs à ses cours), annonciatrice de rassemblements populaires sous le crayon d’Henri Hébert dans St Trucard (22) et dans Histoire d’une chapelle, ainsi que dans Robinson de Charles DuBois-Melly où elle donne le programme d’un « Grand oratorio à Grand orchestre » (pl. 16). Comme les légendes, les textes de ces affiches sont manuscrits, les dessinateurs empruntent différentes graphies pour créer des effets de voix, de variation et de mise en valeur. L’affiche est en revanche reproduite avec ses typographies caractéristiques dans le feuilleton de Nadar, M. Réac, comme dans l’album de Gyp, Une Élection à Tigre-sur-mer. Dans les deux cas, le discours placardé est officiel, il présente la compagnie de « Chemin de fer de Cracovie à Monaco, avec embranchement sur Madagascar », créée par M. Réac et le digne Ravageorff, et le discours de campagne des deux postulants à la mairie de Tigre-sur-mer. D’un côté, l’escroquerie financière est dénoncée par cette affiche, placardée à dix mille exemplaires, dans laquelle « l’écriture sert à diluer la responsabilité collective en désincarnant la voix officielle » (23), de l’autre, la tension née de la rivalité entre conservateurs et républicains se dit dans l’omniprésence et la densité des affiches et autres documents électoraux (brochures, arrêtés municipaux, charte, bulletin de vote) qui se donnent à lire ou à voir à chacune des planches.
L’insertion de textes typographiques ou manuscrits dans les images, par le biais d’enseignes, de vitrines, de journaux, d’inscriptions, est fréquente dans la bande dessinée, elle force à penser le texte dans sa relation à l’image, la capacité du dessin à intégrer non seulement l’écrit mais la page de livre, dont l’affiche se rapproche. Elle est aussi un moyen d’étonner le lecteur, de le mettre au défi d’une lecture plurielle. Ainsi Grandville place-t-il nombre de documents, reproduits comme à l’identique, dans Un Autre monde : programmes (pp. 18 et 175), livrets de Salon (p. 83), extraits d’un guide et d’un journal (pp. 188 et 186), prospectus (p. 206), enseignes (pp. 213 et 220), avis au public (p. 237). On touche à l’« irruption de l’hétérogène » typique des littératures excentriques, où l’effet est plus surprenant encore compte tenu de l’unité de l’œuvre littéraire, ainsi ouverte à des corps étranges et étrangers (24). Dans l’Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux (1830, éd. Delangle frères), Nodier insère la page de titre repensée et la réclame de l’ouvrage (p. 35 et p. 69), il use par ailleurs d’« ultrà-capitales » (p. 84), de « lettres d’une forme et d’une couleur inconnues sur la terre » (p. 7) et d’autres typographies originales (p. 31). C’est probablement une manière pour l’auteur de l’article « De l’alphabet typographique » de faire la satire des caractères de fantaisie qui envahissent la rue comme le livre romantique (25). Le retour de la lettre gothique s’illustre par exemple dans l’inscription de l’intitulé du roman (p. 30), il inspire de même Alcide-Jospeh Lorentz dans Fiasque, mêlé d’allégories (1840). Parmi les multiples documents manuscrits (télégraphe, pl. 44, vol. 1, lettre d’avis, pl. 60, vol. 1, lettres d’invitations, pl. 10 et 15, vol. 2, signature presque illisible, pl. 74, vol. 2) on peut y voir les informations périphériques (« Préface », « Première partie », « Deuxième partie »), et les légendes de la séquence sentimentale du récit (26), écrites en gothiques. Comme Laurence Sterne dans Tristram Shandy, Lorentz place également des étoiles à certains endroits de ses légendes, précisément pour masquer le nom d’une personnalité féminine invitée à la soirée de la baronne de Charnueshanches. L’usage rappelle, dans ce cas, celui fait par les écrivains romantiques des points de suspension, où il participe d’une poétique du sous-entendu, de l’allusion. L’effacement de la dénomination dans le texte romantique (« Monsieur R…. ») sert notamment à entretenir le trouble sur la séparation entre réalité et fiction (27), il est parodié ici lorsque des étoiles gardent confidentielle, comme par délicatesse ou pudeur (on songe aux points de vue déceptifs abordés plus haut), l’identité d’un personnage censé ainsi renvoyer à une personne réelle :
******
Mme de ****** , veuve ou pas de………, n’importe qui (Fiasque, pl. 22, vol. 1).
******
Signes graphiques (étoiles) et de ponctuation (points de suspension) sont les symboles de la réticence dans un énoncé des plus curieux, équivalent dans le domaine stylistique des cases laissées vides. Par ailleurs, deux idéogrammes (des signes représentant une idée) sont à relever dans notre corpus d’albums. Le premier dans Histoire de la Sainte Russie (pl. 96), lorsqu’un point d’interrogation en corps gras est le sujet d’une case et laisse entendre le doute de la population russe quant à son avenir – il est même anthropomorphisé par le biais d’une couronne de lauriers. Le second dans Les Trente six métiers de Becdanlo où lignes de points d’interrogation et d’exclamation, ces derniers inversés, produisent un effet esthétique en même temps qu’ils illustrent, procédé désormais récurrent en bande dessinée, la stupéfaction de Becdanlo dont la « tête était bourrée de points d’exclamation et de points d’interrogation » (fig. 72) (28).
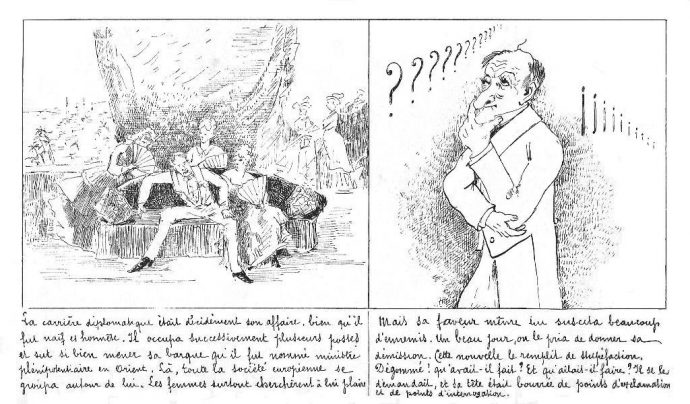
Fig. 72 – L. Lemercier de Neuville, Les Trente six métiers de Becdanlo, L. Frinzine et Cie, 1885, pl. 10. Source : coll. personnelle.
Le signe linguistique peut également servir la mise en page, nous avons rencontré une telle utilisation dans une planche de l’Imagerie Pellerin (n° 276) qui contient deux historiettes indépendantes. La seconde est intitulée Une facétie de Mossieur Poulot et montre le personnage racontant une histoire drôle à « Mame Vertuchou ». Dans chacune des six cases, les deux sujets sont dessinés devant une lettre monumentale qui structure la séquence et remplace le dessin de la case mais forment aussi le mot « BLAGUE », multipliant les fonctions données à la lettre. Dans la série des Histoires & scènes humoristiques, beaucoup de feuilles affichent des intitulés dessinés, au graphisme élégant, ciselé ou stylisé, réalisés à partir de lettres ombrées, épaisses ou colorées, en caractères gothiques ou ornées à la façon de lettrines. En revanche, dans les planches de l’Imagerie Quantin comme dans les séquences de presse, il y a peu d’exemples de réactivation visuelle de l’alphabet, la typographie reste neutre et discrète. Sans doute la prégnance des images est-elle jugée suffisante pour charmer le regard.
3. Place et format des légendes
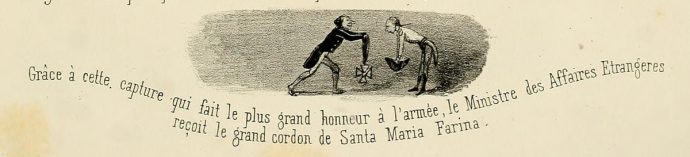
Fig. 73 – Cham, Nouveaux voyages et nouvelles impressions lithographiques, phylosophiques et comiques de M.M. Trottman et Cham, Aubert & Cie, 1846, détail pl. 3. Source : Archive.org.
Sous une image de l’album Nouveaux voyages et nouvelles impressions lithographiques (fig. 73), le texte est placé d’une façon serpentine, créant dans la page une surprise visuelle. Si nous citons cet effet mineur, c’est que l’histoire en images observe durant le XIXe siècle un mode de gestion de l’écrit assez peu variable. À partir du modèle des histoires en estampes de Töpffer, le texte est placé sous les images à raison, le plus souvent, d’une ou deux phrases par case. À l’instant représenté par l’image correspond un énoncé plus ou moins bref en fonction des détails ou des compléments qu’il apporte. Le temps de lecture de la phrase est généralement équivalent au temps de décryptage de l’image, et le parcours de lecture rendu fluide par ce partage relativement équitable.
Dans le corpus des albums, quelques entailles dans ce prototype sont alors à relever. La première concerne la taille des légendes, ponctuellement plus denses pour rendre possible le pastiche : lors des démonstrations phrénologiques de M. Craniose (29) et de la plaidoirie de l’Avocat au procès du contrebandier à la Cour d’Assises (pl. 82) dans l’Histoire de Mr Crépin ; lors des exhortations successives aux ouvriers attroupés (pl. 30) dans l’Histoire de Mr Pencil ; quand sont rapportées la rumeur (30) et les assertions prononcées par un député de l’opposition (pl. 26) et un membre du pouvoir exécutif (pl. 28) à la suite d’un « événement politique […] survenu dans le pays voisin » dans Robinson de Charles DuBois-Melly ; au moment où s’expriment, en « deux pages de législation sèche et noueuse » (pl. 45-46), maîtres Trikonoff et Schlagowitz ainsi que le prince Mentschikoff et S. M. le sultan (pl. 83-87) dans l’Histoire de la Sainte Russie de Gustave Doré (31). La saturation de la case ou de la planche par le texte dit, dans ces exemples, l’épanchement de la parole populaire et la prétention d’une érudition creuse et incompréhensible (voir la « Réplique de maître Trikonoff » dans l’album de Doré, interminable citation du poète de Salmone, mêlée de latin et de grec, dont la « déclamation trop prolongée » fait craindre à l’érudit de se faire traiter de pédant). Le discours direct y remplace l’habituel discours rapporté pour permettre la « mimèse », cette forme de charge qui emprunte la phraséologie ou le style d’un discours antérieur pour le disqualifier ou le tourner en ridicule (32).
La seconde irrégularité concerne la disposition du texte. Elle est directement liée à la littérature excentrique où est prise en considération la part spatiale, visuelle de l’écriture, exemplairement dans l’Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux. En bande dessinée, elle est spécifiquement illustrée par les deux volumes de Fiasque où, là encore, Lorentz s’inspire des procédés de Nodier. Dans l’Histoire du Roi de Bohême, les lignes sont assujetties « à des règles de disposition si bizarres, ou pour mieux dire si follement hétéroclites !!! » (p. 41), à l’image de ce qui est évoqué : sept mots décalés figurent les sept marches de l’escalier sur lequel se tient le portier (p. 107), la disposition des mots « sa loge » et « parallèlogrammatique » schématise la loge de Polichinelle (p. 216), tandis que l’impression à l’envers d’un paragraphe illustre la distraction, sujet du chapitre (p. 297). Cela renvoie au procédé ancestral des vers figurés, appelés calligrammes après le recueil de Guillaume Apollinaire, Calligrammes, publié en 1918. Comme Gustave Doré dans l’Histoire de la Sainte Russie, Alcide-Joseph Lorentz, dans Fiasque, n’adopte pas un modèle répété de mise en page, le nombre et l’emplacement des images varient, les légendes sont placées où reste de l’espace, au-dessous, au-dessus ou à côté des images. Elles sont imprimées d’une manière spécifique, toutefois, afin de produire certains effets. La légende peut être coupée par le dessin pour encadrer, à deux reprises, l’enlacement de Mr Quadrature et Mme de Charnueshanches occasionné par l’évanouissement de cette dernière (pl. 8, vol. 1 et fig. 74). Elle peut être distribuée verticalement, dans un paragraphe extrêmement étroit, pour accompagner le mouvement de la flèche de Cythère qui essaie d’atteindre le cœur de Quadrature en partant du sommet du crâne (pl. 9, vol. 1), ainsi que dans le portrait en pied (33) du peintre de la ville voisine, dont les multiples fonctions sont énumérées une à une mais les mots sans cesse reportés à la ligne, rendant la liste encore plus longue et fastidieuse – rappel des interminables listes qui émaillent l’Histoire du Roi de Bohême. Le texte peut être encore imprimé à l’encore rouge et disposé selon la forme d’une pyramide inversée pour créer un effet de rime ou annoncer la deuxième succession de portraits en pied (pl. 12, vol. 1 et pl. 26, vol. 2).

Fig. 74 – Lorentz, Fiasque, mêlé d’allégories, Auguste, 1840, pl. 37, vol. 1. Source : Coll. personnelle.
Texte : « Les domestiques portent de l’eau pour faire du thé. » / « Mme de CHARNUESHANCHES s’est trouvée mal, mais pas si longtemps » / « que la première fois… (car il y avait du monde.) » / « Revenue à elle, Mme de CHARNUESHANCHES fait passer son monde au salon. »
Dans ces derniers cas, les deux phrases sont isolées sur une page entièrement dédiée, comme le sont également les mots « Lettre d’avis », « Minuit… », « Le grand jour est arrivé », équivalents d’indications scéniques (en écho à la représentation fictive) qui sont ainsi mises en valeur (le décrochage énonciatif est signifié par l’isolation sur le blanc de la page) et créent une bizarrerie, une surprise au sein de l’album. Peu après, Cham imite Lorentz dans l’album Deux vieilles filles vaccinées à marier (1840), lorsqu’il prend soin de justifier une ellipse par un commentaire métatextuel inscrit sur une planche entière, associant le temps de la lecture au temps de la fiction et appelant à prendre conscience des « feuilles de papier blanc » (34).
Eugène Forest, la même année, est lui aussi inspiré par les originalités de Nodier et de Lorentz. Nous avons vu qu’il est le premier, dans Histoire de Mr de Vertpré, à ébranler la mise en page des Albums Jabot. Notamment planche 27 (fig. 75) : à la distribution canonique de deux images par planche est substitué un enchaînement de six cases progressivement plus étroites. Le moment de l’histoire est celui du dîner que Mr de Vertpré organise pour faire la connaissance de son voisinage. Soucieux de répondre « à sa position sociale et aux exigeances (sic) de la civilité » (pl. 21), Mr de Vertpré n’a de cesse de penser « à récréer sa société » (pl. 22-23). Après « ¾ d’heure d’une exquise politesse » (pl. 25), les convives passent à table, avant que l’assiette d’un enfant ne se renverse violemment et « cause beaucoup de désagrémens (sic) à la société » (pl. 26). À la planche 27, donc, les six cases s’arrêtent sur la réaction de chacun des convives. Au fur et à mesure, l’espace dédié au texte (d’une taille immuable ailleurs) augmente au point qu’il se partage d’une manière quasi égale avec l’image. Parallèlement, les mots se superposent en raison de l’étroitesse des vignettes, avec des espaces entre eux chaque fois plus importants. L’effet de cette inscription singulière du texte est de souligner, voire même de reproduire, l’atmosphère de gêne et le froid jeté par cet incident. « Mr de Vertpré, remis de son émotion affirme que l’enfant est charmant » : l’isolement du terme « affirme », dans cette case, indique le malaise de l’hôte qui tente de rétablir la situation. « Cependant, l’Officier mange » / « son vis-à-vis baille » / « l’ami Durocher ne dit rien » / « ni les autres non plus » : la vacuité des images comme des textes, renforcée par l’importance visuelle des espaces blancs entre chaque mot, dit cruellement l’échec de la tentative de Mr de Vertpré. Il y a bien, ici, un effet de sens ajouté au texte lui-même et véhiculé par son seul aspect visuel.

Fig. 75 – E. Forest, Histoire de Mr de Vertpré, Aubert & Cie, 1840, pl. 27. Source : Archive.org.
En dehors de ces procédés proprement excentriques, d’autres gestions de l’écrit s’émancipent du modèle töpfferien pour les besoins de la parodie (dans les Impressions de voyage de Mr Boniface, notamment, où nous avons vu l’importance du matériel écrit, épigraphes et numérotation des chapitres) ou pour reprendre les modalités de présentation des caricatures, dans les albums hybrides (un titre est placé entre l’image et la légende, ou en haut de la planche). Dans Ah quel plaisir de voyager !, la disposition des mots marque d’emblée le passage à la caricature : à la planche 3, sous les images figurant trois personnes assises dans le compartiment du train à destination de Bruxelles, les légendes sont disposées non pas les unes à la suite des autres mais chacune en dessous du personnage qu’elles caractérisent – « Une Dame qui quitte Paris pour fuir l’épidémie », « Un Monsieur qui s’annonce devoir être gênant pendant la route », « Une Dame qui s’attend à dérailler à chaque instant ». On retrouve dans la presse cette différenciation visuelle entre les légendes narratives, de type récitatif, et celles qui sont uniquement descriptives, de type dénominatif – nous reparlons de ces deux formes un peu plus loin.
De manière générale, la part écrite des premières histoires diffusées par les journaux de Philipon est équivalente à celle des albums. Ensuite, les Histoires campagnardes de Léonce Petit présentent des légendes un peu plus longues, qui peignent l’atmosphère rurale et la psychologie de ses habitants. Léonce Petit, qui propose des feuilletons alors que les séquences de presse sont de plus en plus courtes, est encore en décalage avec ses contemporains puisque le calibre des légendes, dans le journal, diminue drastiquement, au point de disparaître. Lorsque la séquence est totalement dépourvue de matériel linguistique, ou qu’il se limite à quelques mots, une ligne est couramment placée au-dessous pour en donner le ton et faire office de titre allongé. Par ailleurs, dans le domaine de la presse enfantine, une différence est à faire entre le format des légendes des feuilletons de Christophe et celui de leur version album. Il apparaît beaucoup plus dense dans les albums, les légendes formant des blocs strictement justifiés et de taille assez peu variable. Il ne s’agit plus d’une ou deux phrases comme dans Le Petit Français illustré, mais bien d’un développement narratif ayant lieu sous chaque image, donnant son essor à la parodie du discours savant (35). Nous évoquons dans la partie suivante les différences majeures entre les versions de ces histoires.
Dans l’Imagerie artistique de la Maison Quantin les légendes se font, globalement, plus concises que dans la plupart des images populaires antérieures. Toutefois, l’immense production du centre spinalien laisse constater une grande variété dans la gestion de l’écrit : des feuilles croulant sous la masse scripturaire y côtoient d’autres ne comportant que quelques lignes de texte. Cet ajustement se retrouve dans la collection parisienne, où les feuilles qui développent un récit comportent des légendes plus denses que celles proposant une situation visuelle, la part du texte étant alors réduite car moins nécessaire à la compréhension. Dans de nombreux cas, la distribution d’une ou deux phrases pour une image est néanmoins appliquée. Elle est modifiée en fonction d’une mise en page spécifique, comme dans les planches dites « en patchwork », qui impliquent un renvoi du texte au bas de la feuille, ou lorsque les images ne sont plus encadrées et se chevauchent, la correspondance traditionnelle « une légende pour une image » n’étant plus observée. Dans les Histoires & scènes humoristiques de Pellerin, cette correspondance est encore modifiée lorsque la légende adopte une allure versifiée. Cet aspect particulier du texte est identifiable visuellement, de petits paragraphes de vers assez brefs s’accumulant en dessous des images, parfois imprimés en italiques. Dans cette collection d’images d’Épinal, la grande diversité des mises en page occasionne des placements variés du texte qui empiète sur l’espace figuratif, se place dans une case accolée à la droite des images ou est mis en facteur commun de deux vignettes ou plus. Dans les premières décennies du XXe siècle, c’est le modèle du gaufrier d’Épinal, avec ses pavés de texte sous les images, censés favoriser l’apprentissage de la lecture, qui est repris par les illustrés. Les séquences de La Jeunesse illustrée ou des Belles images, les épisodes de Bécassine dans La Semaine de Suzette et ceux des Pieds Nickelés dans L’Épatant, donnent à lire de longues légendes disposées au pied du dessin. Concernant les magazines d’Arthème Fayard, Annie Renonciat précise qu’« au lendemain de la Grande Guerre, la part du texte sous l’image augmente même, entraînant une réduction de la dimension des vignettes » (36). Dans Les Pieds Nickelés, le recours supplémentaire à la bulle, dès 1908 (37), ralentit encore la lecture qui est d’autant plus complexe en raison de la désynchronisation du texte et de l’image – la légende ne s’interrompt pas à chaque case mais se déroule d’une manière continue.
B. Les usages du texte
1. De l’ironie töpfferienne aux jeux de mots
Les critères de limpidité et de concision que Rodolphe Töpffer exige d’un dessin efficace, compréhensible par tous, s’appliquent également à l’écriture des légendes. Quand le trait graphique « ne donne de l’objet que ses caractères essentiels, en supprimant ceux qui sont accessoires » (38), le texte converge vers cette même idée de précision. Complément d’images claires, l’écrit se veut d’une « éloquence simple » (39), servie par des phrases élémentaires qui désignent le dessin auquel elles correspondent : « Mr Jabot répète un souvenir de quadrille » et l’image montre le personnage en mouvement. Cette simplicité, il faut la rapprocher de la vocation pédagogique assignée à la littérature en estampes (imagerie populaire et bande dessinée). Dans les Réflexions à propos d’un programme, Töpffer en évoque les qualités, en tant que langage le plus à même d’être compris par le peuple et les enfants :
La première de toute, c’est la simplicité d’exécution unie à la simplicité de la pensée ; c’est la naïve clarté de la légende, jetant une lumière surabondante, mais point superflue, sur une composition déjà tenue de se comprendre d’elle-même par la netteté des procédés, et par la force d’intention qui doit surtout en constituer le style. (40)
Les légendes répondent ainsi pour la plupart à une construction simplifiée, parfois reproduite sur plusieurs cases d’affilée. Au premier abord, l’écrit a donc la fonction de décrire au plus juste un état de fait visible et coprésent, actualisé par l’emploi systématique du présent de l’indicatif. Les deux modes sémiotiques sont situés dans la même temporalité par ce présent de description, d’accompagnement, qui est le même que celui des titres-phrases des tableaux ou des didascalies théâtrales. Nous avons relevé, au sujet de M. Tringle de Champfleury et Léonce Petit, la différence de temporalité entre le récit illustré, aux temps du passé, et la bande dessinée, au présent de l’indicatif (41) ; le même écart est à relever entre les deux versions du Docteur Festus de Töpffer.
Sous le patronage direct des albums töpfferiens, les premières histoires en images de Cham adoptent cette posture énonciative. Dans Mr Lajaunisse, le dessinateur accompagne les images de phrases simples, composées de termes clairs et conjuguées au présent de l’indicatif : « Mr Lajaunisse pour entretenir la fraîcheur de son teint se couche entre 8h et 8h ¼ », « Au moment d’éteindre sa chandelle, Mr Lajaunisse entend cogner à sa porte » (pl. 1). Il est frappant de noter, dans cet album, l’usage récurrent d’un groupe avec participe présent en ouverture de phrase : « Mr Lajaunisse étant parvenu après des efforts inouïs à ouvrir la porte, on lui présente la lettre de Mr Lembêtant », « Mr Lajaunisse s’étant remis de son émotion et ayant fermé sa porte, entraîne la lettre pour la lire » (pl. 4). D’une manière très didactique, Cham explicite ainsi les liens entretenus entre les images successives, souligne leur rapport de succession. Henry Émy use de la même technique dans Mr de la Canardière, la majorité des légendes étant formée de deux propositions reliées par un principe de succession ou de causalité. Dans Mr Lajaunisse, l’énoncé apposé formule un fait que le lecteur pressent aisément par le seul enchaînement des images, dans Mr de la Canardière, il permet de résumer des événements que les images seules ne laissent pas deviner. Sorte d’anadiplose de liaison, les participes présents et passés comblent un vide laissé par une ellipse graphique, ils structurent les épisodes entre eux et assurent la consécution des images. Dans cet emploi, la légende assume spécifiquement la fonction de « suture » que Benoît Peeters assigne au récitatif, par « lequel le texte vise à établir un pont entre deux images séparées » (42). Dans la mesure où elle ne se réfère pas directement à une image représentée, la première partie de la légende peut ainsi être perçue par le lecteur comme une sorte de parenthèse avant que le texte, en renouant avec l’image, ne renoue avec le récit. En plus d’effectuer une minuscule « pause » dans la lecture de l’histoire dessinée, cette construction binaire de la phrase impose un cheminement narratif uniquement linéaire, basé sur une relation de type causalo-déductif entre les vignettes.
L’anadiplose ou le participe passé assure donc une continuité d’ordre textuel, qu’elle soit nécessaire ou non à la compréhension, tandis que cette continuité est plus volontiers d’ordre graphique dans les albums de Töpffer, la succession des images se suffisant à elle-même. Les légendes peuvent en effet s’y enchaîner selon un mode parataxique, le « blanc » entre deux vignettes y étant bien « le lieu d’une articulation idéelle, d’une conversion logique, celle d’une suite d’énonçables (les vignettes) en un énoncé unique et cohérent (le récit) » (43). D’une manière plus discrète que Cham ou Émy, Töpffer use aussi, lorsque cela est réellement nécessaire, de chevilles linguistiques qui aident à clarifier les relations entre des actions parfois entremêlées. Il s’agit de locutions conjonctives de type « après quoi », « puis », « cependant », « pendant que ». En 1851, alors qu’un certain nombre de bandes dessinées ont déjà été publiées, Victor Adam manifeste une totale confiance à l’égard des capacités narratives des images. Les aventures de Mr de la Lapinière (qui se succèdent de façon linéaire, sans la complexité des montages narratifs de Rodolphe Töpffer) sont racontées par le biais de légendes juxtaposées, sans mots de liaison ou connecteurs logiques. La parataxe et la forte concentration du matériau lexical, réduit au strict minimum, donnent le sentiment d’une pensée frappée, dans l’instantanéité de l’image et emportée par la succession des faits.
Planche 5 :
M. de la Lapinière souffre comme un damné.
Il se regarde dans l’eau et est effrayé de lui-même.
Il se décide à retourner au logis.
Il se trouve face à face avec un gendarme.
Il est appréhendé.
Il supplie le gendarme qui reste inflexible.
Planche 6 :
Faute de port d’armes et permis de chasse M. de la Lapinière est condamné.
Il s’arrache les cheveux.
Son chien se sauve de nouveau.
Il est surpris par l’orage.
Il n’est plus reconnaissable.
Sa portière le prend pour un voleur.
Le présent de caractérisation ne détient en lui-même aucune valeur temporelle, l’ancrage déictique et l’embrayage chronologique sont alors établis par la succession des images, dont la lecture doit être sans équivoque. Le style télégraphique est également marqué par une posture énonciative parfaitement neutre, ce que contourne subtilement Rodolphe Töpffer. La narration töpfferienne n’a pas, en effet, le style « froid comme une étiquette » de l’écriture épistolaire de Mr Cryptogame (pl. 4) : un sentiment de jeu dans le sens de décalage, d’interstice dans lequel se donne à lire un second discours, est instillé par divers moyens, qui concernent d’une part la gestion de l’écrit, d’autre part la relation du texte à l’image.
Le comique de répétition
Dans le premier groupe prennent place des indices dans l’ordre du discours qui laissent entendre la posture ironique de l’auteur face à son œuvre. Il y a d’abord la reprise incessante, à chaque case, du nom du personnage, le dessinateur ignorant sciemment, dans la rédaction des légendes, l’emploi du représentant anaphorique. Les six premières légendes de Mr Pencil :
Monsieur Pencil, qui est artiste, dessine la belle nature.
Mr Pencil, qui est artiste, regarde avec complaisance ce qu’il a fait, et remarque qu’il en est content.
Mr Pencil, qui est artiste, remarque qu’à rebours il est content aussi.
Et même en regardant par-dessus l’épaule.
Ayant essayé de ne regarder que le revers Mr Pencil, qui est artiste, remarque avec plaisir qu’il est encore content.
Pendant que Mr Pencil remarque avec plaisir qu’il est content, un petit Zéphir s’amuse à lui enlever sa casquette.
Parce qu’il accompagne l’obsession orgueilleuse de Mr Pencil, l’automatisme de la voix narrative produit un évident effet d’ironie qui n’agit pas seulement à l’égard de l’autosatisfaction du personnage. En déjouant les attentes de continuité et d’harmonie, la réitération machinale du patronyme et de l’incise qualificative altère également la projection naïve du lecteur dans le cours des évènements : « la répétition insistante des noms propres pose les personnages comme tels, comme des figures dont l’existence est en quelque sorte renouvelée à chaque case, de sorte que tout effet de croyance est impossible […]. Dès lors l’absence d’histoire suppose absence de psychologie : chaque image est un moment neuf où tout est possible » (44). L’effet est celui d’une « mise à nu des ressorts trompeurs de la narration qui, en défaisant les récits auxquels nous sommes habitués, acquiert ainsi une légitimité morale » (45).
La présence de refrains fonctionne également comme l’indice de la teneur caricaturale (à plusieurs degrés donc) des albums : dans Mr Crépin, l’instituteur sans cesse « explique les propriétés dans son système », dans Mr Pencil, le narrateur déplore par une parenthèse vingt fois répétée qu’« (hélas la passion aveugle) », tandis que Mr Jabot toujours « croit devoir » et « se remet en position ». Surgit ainsi une « mécanique qui fonctionne automatiquement », comme l’explique Henri Bergson : « Ce n’est plus de la vie, c’est de l’automatisme installé dans la vie et imitant la vie. C’est du comique » (46). L’écriture nette et faussement détachée se révèle hautement railleuse, elle joue sur la répétition pour faire entendre la présence d’un sujet énonciateur sous l’allure d’impersonnalité et de didactisme des légendes. Présente dans les premières images d’Épinal, la répétition du patronyme peut également se comprendre comme un outil d’aide à la lecture, en relation avec les réflexions de Rodolphe Töpffer sur l’intelligibilité de la littérature en estampes qui doit se mettre à la portée du peuple et des enfants, auxquels fait défaut l’esprit déductif (47). Les refrains et les petites propositions subordonnées intercalées entre le sujet et le verbe de la proposition principale (comme « qui est artiste », qui joue comiquement le rôle d’un attribut du genre), relèvent néanmoins indubitablement de la caricature et du comique. Ces automatismes sont repris par les continuateurs, comme par exemple le leitmotiv dans Des-agréments d’un voyage d’agrément de Gustave Doré (« Le soir grande discussion avec Vespasie sur la passementerie Genevoise…. », pl. 12, 17, 19, 20 et 22), et l’incise dans Un Ménage dans les nues (« M. Joséphin Durandeau, rentier », pl. 2, 4, 5, 6, 7, 16, 26 et 32). Plus qu’une case ou une phrase, c’est une suite de propositions, dont les sens varient, que répète Timoléon Lobrichon dans l’Histoire de Mr Grenouillet. À six reprises se lit l’enchaînement, « Ça mordra », « Ça va mordre », « Ça mord », « Ça a mordu », que Mr Grenouillet pêche une chaussure (pl. 5-6), se fasse mordre par un chien (pl. 7-8), déloge un souffleur de théâtre (pl. 19-20), harponne une baleine (pl. 26-27), etc.
Légendes et récitatifs
Parfois aussi laconiques, les textes dans les albums de Rodolphe Töpffer peuvent également être rapprochés de la pratique théâtrale, modèle sous-jacent aux histoires en estampes comme nous l’avons déjà évoqué. Selon la démonstration de Thierry Smolderen, le manuscrit de Mr Vieux Bois (le premier des histoires en estampes, réalisé en 1827) procèderait de l’adaptation parodique de l’ouvrage d’Engel sur le langage gestuel destiné aux acteurs de théâtre. La filiation entre les postures de M. Vieux Bois et les illustrations d’Henry Siddons dans la version anglaise parue en 1822 est surprenante :
Les pantomimes de Töpffer correspondent délibérément à sa définition de l’académisme : articulant les postures stéréotypées des Idées sur le geste et l’action théâtrale, elles mettent en œuvre une langue toute entière contenue dans des « dictionnaires » artificiels. (48)
Aussi les légendes vont-elles jusqu’à imiter la brièveté des termes inscrits sous les illustrations de Siddons : « Devotion », « Dejection », « Sublime adoration », « Jealous rage », etc. Töpffer se jouant souvent, dans les albums, de l’art de la réplique comme de la didascalie, les attitudes emphatiques de l’amoureux éconduit, à la planche 8 de Mr Vieux Bois, sont légendées de la même manière : « Soupçons croissants », « Soupçons rentrés », « Crise », « Projets » (49).
Ces derniers exemples correspondent à des « légendes » dans le sens restreint du terme, c’est-à-dire à un mot ou groupe de mots qui livre une interprétation linguistique à l’image sous laquelle il est placé, comme dans les encyclopédies ou les catalogues illustrés (50). La forme de la légende est celle de la désignation ou de la dénomination, l’absence d’article signifiant un procès en cours dont un moment est sélectionné par l’image. La « légende » correspond aussi aux mots placés sous une illustration ou une caricature pour la désigner, l’expliquer ou la commenter ; nous en avons donné des exemples à propos des albums hybrides, où des cases s’autonomisent par rapport aux autres. Sa forme est généralement celle d’un énoncé averbal (« Toilette de Mlle Poupée », « Promenade de Mlle Poupée », L’Éducation de la Poupée, Baric, pl. 1-2) ou dont le verbe principal est à l’infinitif (« Avoir juste le temps nécessaire pour arriver au Chemin de fer », Ah quel plaisir de voyager !, pl. 1) ou au participe présent (« Toby suivant sa maîtresse la Baronne du Noyau à la promenade », Au Diable les domestiques !, Cham, pl. 8-9). La phrase peut également commencer par l’opérateur typique de reformulation de l’image : « Comme quoi ». Dans ces formes, le référent n’est plus inscrit dans le temps, le repère déictique se perd et l’image devient difficile à situer par rapport aux autres. La « légende » est donc à distinguer du « récitatif » qui, lui, se fait support de la narration, lié à l’image mais surtout aux cases placées avant et après lui – dans les bandes dessinées à bulles, le terme désigne spécifiquement le texte placé dans un cartouche pour donner des indications de lieu, de temps, et assurer une fonction de régie (51). Les deux usages du verbal, légende et récitatif, peuvent se relayer sans entraver la séquentialité à partir du moment où la chaîne des images, un élément du contexte ou la simple logique rend sensible le lien entre chacune des cases, comme dans la séquence des Impressions de voyage de Mr Boniface où l’on comprend que les positions adoptées par le voyageur souffrant du mal de mer, embarqué sur Le Sauteur (pl. 18), malheureusement se succèdent : « Un peu de mieux », « Mieux sensible », « Rechute », « Rechute », « Rechute ». À la manière des bandeaux-titres placés sous les caricatures, certaines légendes se font de la sorte essentiellement descriptives, disant ce qui se joue dans le dessin, mais elles n’en sont pas moins narratives dans la succession des images qu’elles contribuent à éclairer. Ramassées à l’extrême, elles peuvent aussi faire entendre une voix et orienter la lecture de la séquence, notamment lorsque les mots relèvent d’un champ lexical décalé, comme celui de la navigation en haute mer dans Une carrière maritime de Gino (« L’embarquement », « La traversée », « Abordage », « En perdition » évoquent les situations d’un enfant dans une cuve portée par les eaux d’une rivière, La Caricature, 08.01.1881) ou celui des techniques de guerre (« En embuscade », « Préparatifs de combats », « Escarmouche », « L’attaque », « L’assaut » désignent les mouvements d’un chat essayant de jouer avec un bébé, L’enfant et le chat, Imagerie artistique, s4-n19).
Nominales, ces « légendes » sont interprétées comme étant « actuelles », relevant du même présent d’énonciation que celui employé par Töpffer, dans la mesure où aucune donnée contextuelle, ni aucune indication temporelle, comme une date ou un adverbe, ne vient situer le procès, ce dernier étant nécessairement rapporté au hic et au nunc (l’ici et le maintenant) du locuteur et de l’image (52). Ce présent actuel n’est pas celui que l’on peut rencontrer dans les albums de certains émules, où il est mélangé à d’autres temps verbaux. Dans les Impressions de voyage de Mr Boniface, Cham emploie les temps principaux du récit romanesque : imparfait, passé simple et présent. Il ne s’agit plus de présent actuel mais d’un présent historique, d’un « présent pour le passé », à l’aspect achevé, employé pour dynamiser le récit ou créer un effet de tension, de dramatisation : « Le roulis se fit subitement sentir, M. Boniface prend terre » (pl. 16). Contrastant avec les débuts in medias res des albums de Töpffer, les légendes d’exposition écrites au passé ancrent le récit dans un moment révolu :
M. Boniface descendait doucement le fleuve de la vie entre la rue Babylone et l’esplanade des Invalides, sa promenade favorite, lorsqu’un matin il reçut un billet de garde, accessoire glorieux, mais tannant, de la vie parisienne.
Dans Les Travaux d’Hercule, Gustave Doré emploie également les temps du passé : « Un beau jour, Eurysté, doutant de la force de son luron de frère, lui fis (sic) accepter plusieurs effroyables défis » (pl. 1). Quand certains dessinateurs optent pour le présent actuel töpfferien, comme Timoléon Lobrichon, d’autres reviennent ainsi sur des événements situés dans le passé, comme Gabriel Liquier (« Quand j’eus atteint l’âge de raison (5 ans et demi) mon papa crut devoir m’engager à parcourir le monde », Voyage d’un âne dans la planète Mars, pl. 3), et ne font plus coïncider le moment de l’énonciation (le texte) avec le moment du procès (l’image).
S’écartant de la simplicité töpfferienne, la phrase chez les continuateurs peut également prendre une tournure plus complexe, plus littéraire (53). Dans Les Travaux d’Hercule, une image qui constitue une analepse au regard de la précédente porte cette légende : « Tant avait été violente la vitesse toujours croissante avec laquelle Hercule l’avait fait tournoyer » (pl. 3). La construction syntaxique à partir de l’adverbe d’intensité, qui place le sujet après le verbe, l’emploi du plus-que-parfait et le retour sur l’événement complexifient la lecture et la compréhension. À la planche 12, également, la phrase témoigne d’une certaine recherche dans l’écriture : « Bien plus effrayée fut la femme lorsqu’elle crut entrevoir l’Hydre ». Ce sont les histoires de Christophe qui manifestent le mieux cette littérarisation des légendes. La comparaison entre les histoires diffusées dans Le Petit Français illustré et leur version en album laisse voir le minutieux travail de réécriture auquel Christophe s’est attelé. François Caradec évoque en ce sens « les épreuves de l’album en couleurs, constellées de corrections » et donne des exemples de variantes. Il lui semble qu’en général, les légendes originales sont presque toujours plus longues que celles du volume (54). Un travail d’épure du texte est effectivement à l’œuvre lors de la mise en livre, qui concerne la suppression des phrases accessoires ou redondantes par rapport à l’image (« Ces demoiselles n’y comprennent rien, et donnent des signes d’une profonde stupéfaction qui les tient clouées sur place », PFI, 24.05.1890, la proposition relative de la phrase est supprimée). Christophe corrige son texte dans le détail, déplace ou réécrit des éléments pour rendre le récit plus cohérent, plus percutant (« une mission diplomatique chez des Peaux-Rouges de l’Afrique centrale », PFI, 16.02.1895 devient « une mission diplomatique chez les nègres du pôle Antarctique », Savant Cosinus, pl. 18) et plus fluide (« Retrouvée au fond de son cachot le lendemain », PFI, 12.07.1890, « Retrouvée le lendemain au fond de son cachot », La Famille Fenouillard, pl. 15). Il écrit les chiffres en lettres, remplace les deux points par des parenthèses, change certains patronymes et donne de l’épaisseur à l’histoire (« Bien décidé à gagner le Havre, Cosinus a pris le train, où il se trouve seul avec Mistouflet », PFI, 16.02.1895 ; « Bien décidé à arriver cette fois sans encombre au Havre où il désire toujours s’embarquer, Zéphirin choisit un compartiment où se trouve déjà un voyageur d’aspect sympathique, qui n’est autre que notre vieille connaissance Mitouflet », Savant Cosinus, pl. 18). Comme dans ce dernier exemple, les légendes nous paraissent donc plutôt prendre de l’ampleur dans la version album. Incontestablement, les dialogues sont étoffés, donnés tels quels dans le journal, ils sont encadrés d’un commentaire narratif, voire transformés en discours rapportés, et percés d’incises dans le volume :
– Un homme de bonne volonté pour scier le bois du colonel ! dit le sergent Bitur.
– Voilà chef ! riposte aussitôt Cancrelat.
(PFI, 09.03.1895)
Cancrelat, qui est de corvée, a des pensers (sic) amers et il cherche, sans le trouver, le moyen de carotter le service, lorsque le sergent Bitur paraît et demande un homme de bonne volonté pour scier le bois du colonel. « – Voilà, chef ! » riposte aussitôt Cancrelat.
(Sapeur Camember, pl. 8)
Christophe augmente ainsi le volume des légendes (des cases sont également ajoutées, comme les points de vue aériens dans La Famille Fenouillard), il ajoute des qualificatifs, des commentaires ou des répliques (« Que c’est beau ! dit-elle, l’immensité, c’est le commencement de l’infini ! », La Famille Fenouillard, pl. 11) et précise les faits (« grâce à un ami », PFI, 16.02.1895, devient : « grâce à un conseiller municipal qui s’est chargé de solliciter pour lui », Savant Cosinus, pl. 18, en référence à un épisode précédent d’ailleurs presque entièrement réécrit). Surtout, il place dans le volume des effets littéraires, comme une gradation (55), ajoute des répétitions ou des évocations lancinantes (56), et développe des jeux de mots ou des décalages texte / image. Précisons que l’édition au format de poche de La Famille Fenouillard, en 1895, voit les légendes une nouvelle fois retouchées, elles sont allégées en vue d’un public plus spécifiquement enfantin – l’édition de 1893, par la reliure et cet état du texte, peut être considérée comme une édition de luxe pour adultes (57).
Régression verbale
Avec l’exemple de Christophe, on voit combien la part du texte peut prendre de l’importance dans les albums où se développe un véritable comique de mots. Il est symptomatique d’un siècle qui porte un intérêt renouvelé au registre comique, le rire en général, enrichi de qualités nouvelles (ironique, satirique, noir, grotesque, absurde, fantaisiste), pénétrant différents domaines (littéraire, poétique, dramatique, graphique) et cristallisant les réflexions sur la modernité. Il a ses théoriciens, notamment Victor Hugo dans la préface de Cromwell (1827) et Charles Baudelaire dans l’article « De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques » (1855). Les albums des années 1850-1860 cultivent particulièrement un rire fondé sur des jeux linguistiques proprement régressifs, qui mettent une nouvelle fois l’histoire en images en lien avec l’esprit d’enfance.
Parmi les différentes manières qu’ont les dessinateurs d’exploiter les virtualités de la langue, l’usage du calembour manifeste parfaitement ce rire primitif. Figure par excellence du comique vulgaire, longtemps décrié, le calembour est partiellement réhabilité par l’esthétique romantique où il est l’expression d’une naïveté recherchée : « le caractère grossier, populaire, inculte du calembour l’associe à un langage originel non souillé par la société » (58). Il est corrélé au rire de l’enfance, marqué par l’innocence, la joie et l’état de bonheur – il contraste avec les « rires modernes » accompagnés d’agressivité, de tristesse ou d’ennui. Son caractère visible et son manque de finesse en font une figure de fantaisie verbale pure, sans grande portée. Cham et Gustave Doré en placent à plaisir dans leurs albums et ne manquent pas d’en souligner la présence, dans une sorte de complaisance dans la lourdeur, comme une manière de s’en excuser :
Arrivé dans les régions cétaciennes, le sage Ivan demande à son guide comment il nomme ce grand animal qui se cache à l’eau.
« Vous l’avez dit ! » lui répond son sage conducteur (Histoire de la Sainte Russie, pl. 37).
Mr Plumet, dans Des-agréments d’un voyage d’agrément, s’amuse lui-même de ses trouvailles (« À mon retour ma femme me demande si je suis timbré, non non, ce ne sont que des impressions de voyage repris je par un calembourg analogue hi hi hi ! », pl. 11), et quand ce n’est pas le personnage, ce sont des italiques qui signalent l’endroit où il faut rire, ou la légende qui fonctionne comme un commentaire de l’écriture :
Mais Sviatopolk qui n’aime pas l’esprit d’à propos et de badinage, sort de l’eau décidé à laver un outrage aussi sale.
Arrivé dans celle du trône, il trouve malheureusement quelque chose de plus badin encore : c’est môssieu son fils qui se déclare surpris de trouver son père encore debout.
À ce jeu de mots si déplacé dans une circonstance aussi dramatique, le malheureux père lui demande avec une voix altérée par les larmes, s’il songe bien à ce qu’il dit : « Vous vous trompez, mon père, répond Vladimir, je suis loin de me faire un jeu de vos maux (Histoire de la Sainte Russie, pl. 21).
Gustave Doré se livre dans cet album à force fantaisies verbales, qui répondent toutes à ce même esprit de régression et participent au pastiche du récit d’histoire comme à la satire des tsars de Russie, de grands enfants aussi cruels qu’en proie aux crises de larmes. Cham, plus encore, se distingue par un emploi excessif des jeux de mots, des calembours mais aussi des procédés de « suspension d’évidence » (59) où jouent à plein le non-sens, le paralogisme et l’absurde, dans une sorte d’infantilisme mental : « Puis un ancien soldat (ainsi que l’atteste un bras en moins), très actif et ne restant jamais un seul instant les bras croisés », « Parfaitement satisfait des trois domestiques que l’on vient de lui présenter le Baron de Noyau remet son adresse et prie qu’on lui envoie toute autre chose », Au Diable les domestiques !, pl. 2. Signalons également les Aventures de Nestor Camard (1855, cat. n° 47), un album dans lequel Quillenbois fait montre d’un humour particulièrement puéril. Tout au long de l’album, les légendes consistent à faire l’inventaire des expressions construites autour du mot nez, censées être drôles au regard du personnage à l’appendice handicapant. Tout y passe – « pied de nez », « avoir le nez long », « nez au vent », etc. (60) – et le dessinateur, comme une forme d’aveu, concède son indigence au travers des amis de Nestor Camard qui « le bombardent de leurs calembourgs, jeux de mots et traits d’esprit qu’il trouve fort bêtes » (pl. 7).
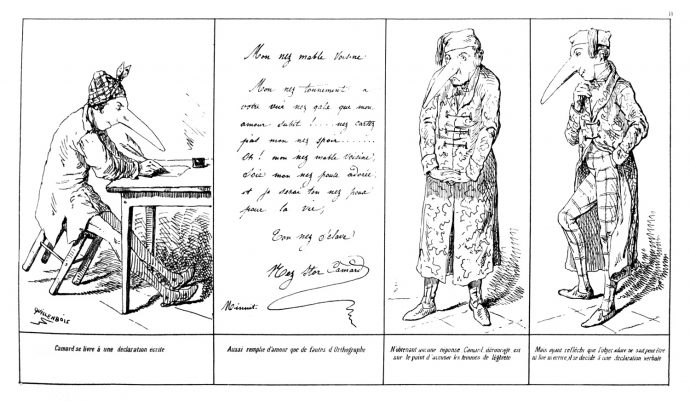
Fig. 76 – Quillenbois, Aventures de Nestor Camard, H. Gache, 1855, pl. 11. Source : Coll. J.-D. Candaux.
Entretenant une connivence avec l’image à voir, l’« image américaine » (61) est une autre figure notamment employée par Gustave Doré. Elle consiste à choisir un comparant situé dans une réalité prosaïque, matérielle ou totalement décalée et incongrue par rapport au comparé :
C’est en se fondant sur certains procédés stylistiques (élimination de l’effet de perspective, bloquage (sic) du récit et nivellement dans une co-présence d’éléments équivalents, déclinaison d’éléments contigus dans un même plan, prosaïsme des comparants et des comparés dans une même comparaison, etc.) que l’image « américaine » et l’image « métonymique » s’efforcent de concurrencer les structures et les effets même de l’image à voir. (62)
Mr Plumet décrit ainsi la vue des montagnes : « Au dessus de moi, les pics d’Anterne comme un peigne à barbe, au dessous, Sallanches comme un groupe de punaises de bois, les lacs, comme des écuelles de lait. Mon Dieu, faites moi mourir, j’en ai assez vu », Des-agréments d’un voyage d’agrément (pl. 6). Personnage ô combien lyrique, César Plumet manifeste ici un trait que la bande dessinée partage avec la littérature des années 1850-1880, qui consiste en la prise de distance ironique vis-à-vis de l’image rhétorique, et constitue, nous en avons parlé, une réponse à l’envahissement des images « plates ». Philippe Hamon évoque « une réaction à l’égard de la grande tradition de l’image romantique, voire comme une crise de confiance des littérateurs à l’égard des images littéraires en général » (63). Aussi le récit graphique met-il l’écriture à distance, la confronte-t-il à la représentation en défaisant les expressions figées et les métaphores, remotivées dans le dialogue du texte et de l’image.
Le manège texte / image
Dans l’union qu’ils forment pour mener à bien le récit, textes et images organisent des jeux d’interprétation, de complétion, de décalage qui constituent des pointes d’ironie dirigées tant vers le langage que vers la mise en fiction. Dans les histoires en estampes, Rodolphe Töpffer ne pratique pas d’humour purement verbal, il réserve les excentricités langagières aux œuvres écrites où l’autorité du littérateur, son inscription dans la tradition du récit fantaisiste établie lui autorise une certaine liberté à l’égard du matériau linguistique, des conventions du discours littéraire (64). La nouveauté et l’hybridité du récit en images, son absence de légitimité, en excluent une telle excentricité textuelle, qui viendrait ébranler encore une forme en soi subversive. Sous l’égide de l’école (anglaise) de la caricature, l’image elle, en revanche, est investie et tirée vers l’originalité. L’humour, dans ce contexte, naît spécifiquement des contrastes entre la position énonciative affectant sérieux, neutralité et les images participant du registre burlesque. Pour exemple, dans un épisode de Mr Jabot (pl. 36-37), la chemise du personnage prend feu au contact d’une bougie tandis qu’il évoque une « certaine chaleur !!….certaine flamme amoureuse !…..et sympathique ! ». Criant « Holà !!.. Holà !! au feu !! au feu !! », il est entendu par la Marquise de Mirliflor qui comprend « Hélas ! Hélas ! ô feux !! ô feux !! » et « ne doute plus qu’elle n’ait inspiré une passion d’une violence extraordinaire ». Par l’émergence du sens littéral et la reprise inadaptée par la Marquise du sens métaphorique, « c’est de fait la métaphore usée des feux de l’amour qui se trouve mise en scène et tournée en ridicule. Ironie à l’égard d’un comportement mais aussi de toute une esthétique qui a fait son temps » (65). Gustave Doré reprend l’idée dans les Des-agréments d’un voyage d’agrément, lorsque César Plumet est embroché au-dessus d’un tas de braises : « Ô sublime meunier, m’écriai-je dans le feu de ma reconnaissance, vous ne connaîtrez que dans un autre monde, ce que je vous dois pour vos bontés…… » (pl. 4) ; case suivante : « Ce ne sera que 75.fr 50.cent dans ce monde, me répondit cet homme qui, sans doute, n’était pas sublime ». Dans la même planche, les métaphores construites autour de l’eau sont de la sorte « dé-figurées » par l’image : le voyageur, dans un « politique élan », se sent si « imbibé » de l’« Être infini » qu’il est aussitôt emporté par les eaux de l’Arve en crue, ce qui ne l’empêche pas de continuer à déclamer : « Ô traîtres élans de l’esprit, sur quels courants jetez vous l’homme…. ». Cet épisode est d’autant plus ridicule qu’il est construit, d’après la note de l’éditeur, « sur un bain de pied qu’il avait pris en glissant sur les graviers de l’Arve ». Non seulement le langage et ses virtualités sont soumis à révision mais l’acte de narration lui-même n’a plus rien de fiable – seul le personnage de l’éditeur garde ici un semblant de crédibilité.
Également, des expressions verbales sont littéralement mises en images, selon des codes figurés, signalétiques, qui s’installent durablement en bande dessinée, au même titre que les traits de mouvement ou les points d’interrogation et d’exclamation. Ces idéogrammes sont, là encore, à rapprocher des rébus publiés par les journaux : un idéogramme trop schématisé, comme il y en a dans les bandes dessinées d’André Franquin, aboutit d’ailleurs au rébus (66). Le symbole du cœur est notamment utilisé par les dessinateurs, chacun à leur façon. Cham, dans le Voyage de Paris dans l’Amérique (pl. 18), offre une transposition graphique du « cœur très barbouillé » de Mr Clopinet souffrant du tangage à bord du bateau qui doit le mener au Havre : l’image montre le dessin d’un cœur rudimentaire, franchement gribouillé. La case suivante est plus explicite, elle montre Clopinet penché par-dessus bord, « forcé de se débarbouiller ». Dans les Des-agréments d’un voyage d’agrément, un cœur percé d’une flèche illustre l’émoi de Mr Plumet à la vue d’une « blonde oberlandoise » (pl. 19). Stop, dans les Aventures sentimentales et dramatiques de Mr Verdreau (L’Illustration, 1850), représente le personnage avec une flèche dans le cœur, entendu qu’il « est frappé d’un coup mortel » à la vue d’un « chapeau jaune », métonymie qui désigne, textuellement et graphiquement, la femme dont il est épris, lui-même étant symbolisé par un cœur organique, d’abord ailé puis motorisé. Donner ainsi l’équivalent du texte par le dessin idéogrammatique est une façon pour les dessinateurs, à l’instar des écrivains de la même période (67), de prendre une distance amusée avec des images rebattues et de les surinvestir. La logique interne du dessin s’en trouve modifiée puisque la case ne se fait plus mimétique mais symbolique, appliquée à transposer les images de la langue, avant qu’elle ne retombe dans sa dimension prosaïque. L’expression idiomatique, « voir trente-six chandelles », est de même graphiquement traduite tout au long du XIXe siècle, pour devenir un idéogramme usuel en bande dessinée. Gustave Doré l’utilise dans l’Histoire de la Sainte Russie (pl. 37), Caran d’Ache dans une séquence du Figaro (16.12.895, « Nota : les 36 chandelles y sont. On peut les compter ») et Christophe dans La Famille Fenouillard (pl. 16), Les Malices de Plick et Plock (PFI, 02.10.1897) et Le Baron de Cramoisy (PFI, 30.12.1899). On en relève également une occurrence dans une feuille de l’Imagerie Pellerin, La Planche de salut (n° 414), où les bougies sont remplacées par une myriade d’étoiles. De ces différents emplois, on remarque que l’idéogramme est intégré, pleinement signifiant à la toute fin du siècle où il peut se défaire de l’expression écrite qui l’accompagne systématiquement au début.
Ainsi, les expressions figurées sont une source d’inspiration majeure pour les dessinateurs. Le Petit Français illustré leur consacre d’ailleurs un article dans lequel est racontée une histoire qui en convoque un grand nombre, à côté d’images (réalisées par Christophe) qui en représentent des passages et interprètent, dans un coin de la vignette, les expressions prises dans leur sens littéral (« Les Expressions figurées », PFI, 30.08.1890). Redonnant vie à la tradition des proverbes en images, rendue célèbre par Brueghel l’Ancien – notamment dans la toile des Proverbes flamands (1559) où se concrétise pas moins d’une centaine de dictons –, beaucoup de cases des histoires en images figurent « au pied de la lettre » l’image du texte de la légende. L’Histoire de la Sainte Russie regorge d’exemples (nous en avons déjà cités) où le dessin exploite à tel point le pouvoir du langage de « redécrire » (68) la réalité qu’il en devient parfaitement absurde. Cham use constamment du procédé comique, comme dans le feuilleton Voyage exécuté autour du monde, par le capitaine Cham et par son parapluie (Le Charivari, 1852) où une case figure une pluie d’échelles dans la mesure où « le navire du voyageur Cham se dirige vers l’Orient, mais l’inexpérience du capitaine est cause qu’il se trouve fort embarrassé au milieu des échelles du Levant ». Dans la presse comme dans les albums, le procédé est récurrent, voire éculé, il perd de sa portée comique sous le crayon de Baric notamment. La concrétisation graphique peut toutefois se faire plus subtile lorsqu’elle opère à partir d’une syllepse de sens. Fonctionnant intégralement sur la distance entretenue entre le texte et l’image, une séquence tirée du Sapeur Camember de Christophe est en ce sens analysée par François Cornilliat (69). La planche s’intitule « Puissance de l’addition » : Camember, chargé par « mam’selle » Victoire d’aller chercher des pommes de terre à la ferme, s’endort en route à la table d’une auberge, son sac vide sur l’épaule. L’apercevant, l’élève Merlin propose à son ami Batifol de lui apprendre « ce que c’est que l’addition des fractions ». Pour ce faire, Merlin remplit progressivement le sac du sapeur de cailloux trouvés au bord du chemin. Sous l’effet du poids du sac, Camember se redresse jusqu’à finalement basculer en arrière et briser la table sur laquelle il s’était avachi. Alors que le gag visuel est pleinement compréhensible, le texte propose un autre récit dont la portée imagée ne se révèle qu’au regard des vignettes :
il imagine une autre opération, en baptisant « fractions » les cailloux dûment cassés, que l’on « pose » en les déposant dans un sac. Et le texte signale cette distance tropologique, dans la dernière case, en jouant sur la « fraction » de la table : voici que dans l’ordre des mots, par recours au sens étymologique, s’énonce quelque chose qui fait concurrence à l’évènement visible et en redouble la « chute ». (70)
Plus que de complémentarité texte / image, François Cornilliat évoque une compétition entre les deux modes d’expression, le jeu de mots rivalisant avec la dynamique du gag.
Beaucoup d’écarts entre la figure et le verbe sont ainsi créés dans la bande dessinée (sans être toujours aussi complexes que sous le crayon de Töpffer (71) ou de Christophe), ils participent de ces « calembours visuels », un type d’images généré par un jeu de mots, que l’on retrouve dans la caricature, dans le rébus où abonde « ce genre d’images délirantes », puis dans les Arts Incohérents où est exploitée au maximum la polysémie des mots : « Il revient au calembour visuel de contester par l’absurde ou par la dérision la similitude entre décrire et peindre » (72). Le dérèglement ou la transgression sont poussés à l’extrême dans le cadre de la bande dessinée où les relations perverties du lisible et du visible suspendent la narration où les deux systèmes sont censés se compléter : elles font éclater au grand jour l’amiguïté, l’imposture du récit, sa faculté à s’apparenter, en une seule image, à une blague. Spécifiquement, les rapports contrapuntiques de la légende et de l’image rappelent les titres antithétiques donnés aux toiles fictives des Salons parodiques, voire même les intitulés, sémantiquement opaques, de toiles réelles où s’insinue un écart entre ce qu’ils stipulent et ce qui est montré par le tableau (73). Ils sont aussi un héritage des titres ironiques de livres, particulièrement fréquents au XIXe siècle, comme ceux donnés par Victor Hugo aux livres des Châtiments (1853) ou celui de La Joie de vivre (1884) d’Émile Zola.
L’impropriété de l’énoncé, qu’il soit laconique, euphémique ou laudatif, s’exhibe ainsi le temps d’une image, à l’instar de la caricature, mais peut aussi dynamiser des séquences architecturées, comme dans le procédé du « pied de la lettre », autour du caractère irréalisant, abstrait des mots. Le narrateur adopte donc souvent une posture ironique articulée sur le ton de la fausse naïveté. Son éthos moqueur se constitue par le biais de l’antiphrase expressément révélée par le dessin. Une double énonciation s’établit alors, qui dresse une hiérarchie entre les deux moyens d’expression, le signifié de l’image l’emportant sur celui du texte. C’est une forme d’ironie relativement élémentaire et in praesentia, ne laissant subsister aucun doute d’interprétation, que Töpffer met ainsi en œuvre lorsque le narrateur du Docteur Festus s’entête à répéter, malgré les innombrables péripéties dessinées, que « le Docteur Festus continue son voyage d’instruction jusque là si heureusement commencé ». Par le Groupe Mu (74), cette sorte d’ironie est jugée « mauvaise » car trop manifeste. Cet avis s’applique cependant à un corpus de dessins de presse. Dans le cours d’un récit, la duplicité sémantique explicite vient dessiner une ironie supplémentaire qui dépasse le contenu de la fiction pour s’appliquer à la fiction elle-même : la narration se dénonce comme pur artifice en même temps qu’elle engage une lecture au second degré. Régulièrement mise en échec, la part du texte est ainsi démentie par l’image porteuse de la « vérité » de la diégèse. Henry Émy fait reposer l’humour de Mr de la Canardière sur ce contrepoint du texte par rapport à l’image. Le lecteur est invité à rire de l’inexpérience et des chutes de l’apprenti chasseur, au fil de cases le figurant de plus en plus mal-en-point. Le comique burlesque qui résulte de la figuration du personnage dans de mauvaises postures puise dans la mise à distance évaluative toute sa force et son intérêt : bien piètre chasseur à l’image, Mr de la Canardière apparaît dans le texte comme « intrépide », plein de « grâce », d’« ardeur » ou de « prudence ».
Dans les séquences de la presse, les syllepses de sens, les euphémismes ou les contrepoints texte / image (fréquemment entre le titre et l’histoire muette) sont le plus souvent de simples ingrédients du gag, contribuant à l’effet de chute. Cet exemple tiré de La Caricature (fig. 77) utilise le « pied de la lettre » dans l’esprit nonsensique de surprise visuelle (« – Levez la tête, joignez les talons et portez les yeux à quinze pas devant vous. », « – Voilà ! sargent »).

Fig. 77 – J. Dépaquit, Obéissance passive, La Caricature, n° 942, 15.01.1898. Source : Gallica.bnf.fr.
Dans l’Imagerie artistique de la Maison Quantin, l’examen de la réécriture du scénario premier, communiqué par l’auteur, indique un raffinage du texte dans le sens de l’élimination du moindre élément de disjonction entre le texte et l’image. La confrontation des différentes phases de réalisation des planches de Christophe en donne une flagrante illustration. Un premier contrepoint est gommé dans Deux pêcheurs (s3-n14, 1886). Dans la planche originale, Christophe inscrit (au crayon graphite) sous une case montrant les lignes des pêcheurs entremêlées, « à qui appartient cette importante capture ? » : le lecteur distingue à peine un alevin. Dans l’imprimé final, l’amusante interrogation devient : « Surprise ! Elles se sont accrochées, et il y a un pauvre petit poisson qui s’agite avec désespoir au bout des deux hameçons ; on ne peut savoir à qui il appartient ». Dans les trois cases suivantes, où les personnages se disputent la capture, Christophe joue sur les mots : d’abord « la discussion s’échauffe… », « puis se refroidit…. », les compères étant tombés à l’eau, et enfin « les pêcheurs sont repêchés ! ». Voici ce que donne le texte définitif : « Les deux pêcheurs se lèvent : “Je vous dis qu’il m’appartient, monsieur Robinet. – Erreur ! monsieur Coquillard, il est à moi !” », « La discussion s’échauffe. Ils en viennent aux coups, et, dans leur colère, se poussent, se bousculent et tombent à l’eau », « Deux bateliers, qui suivaient la lutte à quelque distance, font force de rames et arrivent à l’endroit critique. Remontant par bonheur à la surface de l’eau, les malheureux purent être repêchés ». Non seulement le texte s’amplifie de détails explicatifs et souvent redondants, mais le comique de la narration disparaît comme le rythme qui en faisait la force. Le laconisme de la légende est de même comblé dans la planche où Un entêté (s3-n16, 1886) s’obstine à lire son journal en marchant. Planche originale : « un obstacle imprévu l’arrête… », « et l’oblige à s’asseoir ». Imprimé : « Tout à coup, il sent un coup violent ; c’est un bec de gaz contre lequel il s’est heurté », « Il s’est cogné avec une telle violence qu’il tombe à terre, et s’assied sur son chapeau. Quel dommage : un chapeau neuf ! ». À la naïveté comique des légendes du dessinateur, l’éditeur préfère l’expressivité et l’émotion du texte retenu. Dans la même planche, une pointe satirique est supprimée : l’entêté est tombé dans un égout, « ne pouvant continuer sa lecture, il se met à la recherche de l’étoile polaire », « qui lui apparaît bientôt sous la forme d’un égoutier stupéfait… », « mais non gratuit ». Imprimé : « Quelle obscurité ! Par bonheur, il retrouve une allumette qui lui donne une indication. », « Puis il aperçoit un égoutier ; il lui explique son aventure et le prie de le faire sortir. », « Après un long voyage, il revoit le jour ; il n’oublie pas son guide et rentre chez lui, fourbu et trempé ». Les textes de Christophe (75) ne sont pas les seuls à être ainsi policés. Aucun contrepoint n’est conservé et c’est parfois le sens entier d’une séquence qui est modifié en fonction de sa charge critique ou grotesque. La numérotation et la mention « bonne copie » inscrite sur les différents manuscrits indiquent la présence d’un relecteur assidu, qui prend souvent le soin de réécrire le scénario, quand il n’est pas typographié sur un feuillet indépendant. Si une certaine liberté graphique semble de mise, le texte des images de cette collection semble lui, en revanche, sous le contrôle de l’éditeur.
2. Ton de conversation
À l’adresse des enfants, les feuilles de l’Imagerie artistique gomment ainsi l’humour né de la relation texte / image, préférant miser sur une narration toute en éloquence. De la traditionnelle lecture collective, effectuée par un conteur ou par le chef de famille, les récits des images populaires conservent les procédés d’expressivité qui passent par des interjections et du discours indirect libre. Conservatoire d’une idéologie bien pensante, la légende s’agrémente fréquemment de la franchise des pensées enfantines enchâssées dans le didactisme du narrateur. C’est une manière de faire vivre la narration et de la rapprocher du discours de l’enfant, ainsi mis en présence des pensées du personnage, sans toutefois interrompre le récit par un discours direct. Dans deux planches où des enfants effectuent, ou ambitionnent d’effectuer, un voyage dans les airs à l’aide de ballons de baudruche, l’enthousiasme suscité par le projet est rendu avec l’ardeur proprement enfantine : celle du petit Toto d’abord contrarié, « De retour chez lui, Toto s’aperçoit que son ballon est tout dégonflé. Hélas ! que faire ? », puis emballé, « À force de chercher, il trouve un soufflet. Quelle idée ! » (Maurice Radiguet, Ascension de Toto, s3-n7, 1886), et celle de René et Juliette émerveillés, « On court chercher les ballons. Comme ils sont beaux ! », puis échafaudant leur plan, « Il faut d’abord une nacelle. », « Et du lest ! Il en faut, du lest ! » (Félix Lacaille, Le voyage manqué, s3-n12). D’où provient l’exclamation « Quelle idée ! » ? S’agit-il de la pensée du jeune Toto se félicitant de sa trouvaille ou bien du commentaire d’un narrateur ponctuant sans cesse les récits de phrases interjectives (comme « Mais, ô surprise ! », « Vaine prière ! », « quelle confusion ! », « Mais quel affreux cri ! ») ? Le contexte et l’ajout d’adjectifs appréciatifs révèlent souvent l’origine de ces commentaires qui participent d’un discours axiologique. Exprimant l’interpellation, le vocatif « ô » manifeste une forme d’oralité qui tient au mode interlocutoire typique de la littérature pour enfants. C’est en effet dans les planches ayant trait à l’enfance que se manifestent spécifiquement des indices et opérateurs de contact : « Comme vous pensez, cette façon d’agir fit bien mal à Corentin. » (L’idée de Corentin, s3-n1). Ils se trouvent en nombre dans les albums pour la jeunesse :
Surtout, à l’opposé du livre d’auteur, œuvre individuelle, l’album promeut une forme de livre relationnelle, dont le lien affectif et amical est le fondement : de là, ses affinités immédiates avec la littérature enfantine, littérature elle aussi relationnelle et affective, comme l’indiquent d’innombrables indices ─ titres, dédicaces, préfaces, épigraphes, illustrations des couvertures, des affiches et des frontispices ─ sans oublier le statut énonciatif du texte lui-même, très souvent fondé sur la corrélation de personne et sur la communication intersubjective. (76)
Destinées à un tout jeune public, Les Malices de Plick et Plock bénéficient d’une telle narration qui s’apparente constamment à une conversation. L’introduction est adressée à « Mes petits enfants » et Christophe multiplie dans les séquences les questions de relance (elles font le sujet d’une planche intitulée Où le lecteur verra se dresser devant lui une série de « pourquoi » auxquels il sera ultérieurement répondu à la satisfaction de tous), les questions oratoires (« Plick et Plock deviendraient-ils sages ? »), les prises à partie du lecteur (« (méfions-nous) », « Rassurez-vous ! », « Pensez un peu, mes amis, que Plick et Plock se trouvaient enfermés dans la souricière ! »), et les intrusions du narrateur (« je vous assure », « si j’étais Plock je n’aurais plus qu’une confiance modérée dans les affirmations et le savoir de Plick », « Moi, je dis que c’est la curiosité. Décidez ! ») (77). Ce dernier assure en outre la « fonction de régie » (78), par le biais de formules qui rythment le récit et en soulignent les rebondissements : « Quelle était cette idée ?…Cruelle énigme ! », « Quel est donc le but mystérieux vers lequel court Cosinus ? » (Savant Cosinus, pl. 5 et 28). Cette manière de récit dialogué fait signe vers les spectacles pour enfants et notamment le théâtre de Guignol, personnage frondeur créé en 1808, à Lyon, par Laurent Mourguet, dont les farces représentées sous des castelets sont extrêmement populaires jusqu’à la fin du XIXe siècle. Dans cette forme particulière de théâtre, comme parfois au music-hall, s’organise un dialogue entre les personnages et le public. Il est toujours très simple, les jeunes spectateurs n’ayant le plus souvent qu’à répondre « Oui ! » ou « Non ! ». Sous le crayon de Christophe, le faux dialogue reproduit ce contact vivant qui tend à faire oublier la distance entre le lecteur et la scène dessinée. Il a aussi pour fonction de générer une incertitude quant à l’issue, l’évolution d’un événement partiellement prévisible (sa teneur catastrophique ne laisse que peu de doute), créant à la fois suspens et curiosité.
Sollicitant sans cesse le regard du lecteur par la référence à l’image (« La gravure le représente au moment où il cherche à dissimuler sa calvitie […], Le Savant Cosinus, pl. 15), le narrateur des histoires en images convoque également le modèle du montreur de lanterne magique. Avant que l’appareil optique ne soit fabriqué de manière industrielle et entre dans les foyers, le spectacle de lanterne magique est présenté par un manipulateur qui démontre son habileté dans l’art de commenter les images. Ordonnateur de la projection, il doit captiver son public et insuffler du dynamisme aux images fixes, en faire le récit. Il commence en ce sens par déployer un discours incitatif, à la fois impératif et complice – « Voyez », « vous allez voir ce que vous allez voir », « Admirez » –, accompagné de formules présentatives valorisantes – « Ah ! voici. Ah voilà, voici, voilà » (79). Cette suggestion d’images non plus projetées mais imprimées est très fréquente dans la bande dessinée, comme dans la caricature d’ailleurs où la légende renvoie souvent à la gravure. La mise en présence des images passe alors par le recours à des présentatifs déictiques. Dans la réédition des Des-agréments d’un voyage d’agrément, Annie Renonciat souligne que « le schème implicite qui sous-tend la narration est celui des projections de lanterne magique », spectacle auquel se livre Mr Plumet à la fin de l’ouvrage lorsqu’il procède à la « 900e projection de son voyage à ses amis et connaissances ». Certaines légendes prennent effectivement la forme de commentaires de vues : « Voici une tirelire lourde de vingt ans d’économies » (pl. 1), « Ici, Vespasie et César Plumet choisissent un harnachement de touriste » (pl. 3). Cham, de même, invite fréquemment le lecteur à voir, notamment dans Un Génie incompris où la reproduction des œuvres de l’apprenti dessinateur l’y engage particulièrement : « Ayant à raconter l’histoire d’un personnage remarquable, je montre sa maison exactement comme dans l’histoire de Napoléon par Mr Horace-Vernet » (pl. 1), « Mr Barnabé Gogo lui présente quelques minutes après, le devoir ci-dessus » (pl. 14), « (Nota) Le personnage qu’on aperçoit dans le fond est le groom de Calipso » (pl. 36). La composante graphique est également mise en relief dans d’autres albums, par la prise à témoin du lecteur qui est ainsi renvoyé à son activité de « voyeur » : « Nous pouvons le voir grandir dans cette estimable maison » (Souvenirs bachotiques, pl. 3), « Ses habitants dont on peut voir ci-dessus quelques portraits » (Voyage d’un âne dans la planète Mars, pl. 7), « Le soleil se lève sur cette scène horrible, les héros de ce récit se poursuivent pendant trois heures » (Les Mésaventures de Mr Bêton, pl. 27). Comme lors d’un décrochage de style graphique, ces appels du regard invitent à une lecture qui tienne compte de la réalité de l’œuvre, de l’organisation de ses différentes composantes. L’injonction à voir suggère bien un éloignement qui pose le récit pour ce qu’il est, une représentation fabriquée où s’établit une distance entre l’image et le texte dont il devient le commentaire. L’effet est similaire à une mise à nu du procédé, on le retrouve dans le roman excentrique, notamment lorsque le narrateur renvoie au chapitre précédent et fait prendre conscience, à rebours du principe de l’illusion réaliste, des codes du récit. Christophe explicite ainsi le fonctionnement de la bande dessinée et de ses images (« (on ne voit pas l’adjudant-major ; mais à en juger par la direction du regard du sapeur, il est à présumer qu’il est quelque part vers la droite) », Sapeur Camember, pl. 18), selon un didactisme ironique qui rappelle la portée instructive et pédagogique des spectacles de lanterne magique (80).
Le montreur de lanterne magique doit donc fasciner son auditoire en le transportant dans les scènes représentées, en soulignant les enchaînements, le rythme de la projection. Il prend en charge en les accentuant les émotions nées du récit et prévient, approuve ou encourage les réactions des spectateurs. Dans le même esprit, le narrateur du récit graphique ménage son déroulement à l’aide de commentaires emphatiques qui soulignent les temps forts et cultivent la mise en scène, la mise en tension des actions dessinées. Le narrateur des Travaux d’Hercule endosse cette fonction dans l’épisode (pl. 23-27) où le héros poursuit la biche aux cornes d’or : « Il approche !… » quand Hercule est sur le point de s’emparer de l’animal ; « Mais…ô rage, ô désespoir !! » lorsqu’il échoue ; « Touché ! » quand il parvient à la capturer ; mais « gare à lui !…c’était un saut à éviter » alors qu’il chute avec la biche. Puis, tandis qu’un « fleuve a l’esprit de recevoir les deux aéronautes », le narrateur de conclure : « tant pis pour la biche ! tant mieux pour Hercule ». Empreints de la subjectivité du locuteur, ces commentaires font partie d’une tendance générale de la bande dessinée à cultiver l’emphase et la mise en spectacle des événements. Comme les interventions du narrateur dans le roman-feuilleton pour justifier l’organisation parfois hasardeuse du récit – que Cham pastiche dans les parodies du Musée Philipon – les dessinateurs emploient des procédés d’interrogation qui doivent maintenir en alerte et actualiser l’intrigue. Dans l’album anonyme Un Ménage dans les nues, le dessinateur ajoute aux interjections, « Coup de théâtre ! » (pl. 8), « Plus d’espoir ! » (pl. 30), « Tout-à-coup…ô joie ! ô surprise ! » (pl. 31), des effets de suspens :
Joséphin, pour les châtier, abandonne son ballon, son chien et sa femme, et tombe…où ? C’est ce que nous saurons plus tard (pl. 10).
Euphémie s’évanouit.
C’est le moment de la quitter pour revenir à Joséphin (pl. 14).
L’interrogation suspensive est présente également dans la séquence de presse, où elle renvoie à l’esthétique du « à suivre », caractéristique du roman-feuilleton. Nous avons évoqué les moyens de mise en tension utilisés dans le feuilleton de M. Réac ; dans L’Éclair, Nadar emploie les interrogations explicites en guise de conclusion. En posant les questions que pourrait, ou devrait, se poser le lecteur alors que la situation semble résolue, Nadar use d’un « procédé visant à compenser cette relative clôture de la chute » (81) : il suggère les prolongements possibles de l’histoire et rappelle, par cet emploi des stratégies narratives stéréotypées du roman populaire, leur nature feuilletonesque. À propos de M. Classique, à qui la découverte de sa caricature dans L’Éclair a donné une attaque d’apoplexie, le narrateur se demande : « En reviendra-t-il ? » (24.07.1852). À la fin du voyage aérien de M. Barnichon, il interroge : « Mais qu’a pu devenir le monsieur que leur ancre avait dérangé ?…. » (En Ballon, 11.09.1852), l’image le représente suspendu à un clocher. Généralement placés à la fin d’un épisode, ces questionnements parodiques fonctionnent comme des promesses de rebondissements, ils éveillent la curiosité du lecteur et doivent le laisser dans l’attente de la prochaine livraison. Stop y recourt pour clore le second épisode des Aventures sentimentales et dramatiques de Mr Verdreau, et le regard interrogateur que le personnage adresse au lecteur renforce le mystère : « Aurait-il, génie ignoré, trouvé les sources du magnétisme animal ? » (L’Illustration, 26.01.1850). Dans ce feuilleton, le narrateur n’a de cesse de raviver la tension qui anime le personnage à la recherche de la femme au chapeau jaune, manière de nouer l’intrigue passionnelle : « Mais, hélas ! après deux heures de poursuite, le chapeau jaune disparaît comme une ombre », « Mais son cœur n’était pas là ! il volait sur les traces du chapeau jaune ». Le moment critique où Mr Verdreau est sur le point d’abandonner son idée fixe – il fait la rencontre de Nini-Fo-Leu-Ki-Tchi-Kao-Ta-Té-Ti-To-Tseu lui ayant déclaré son amour – est dramatisé par la scansion de la phrase et les points de suspension :
M. Verdreau jure de la venger, de la défendre..…le chapeau jaune…..tout allait être oublié…..
…..lorsqu’un grand bruit se fit entendre…..
…..C’était son barbare époux…
…..suivi d’un de ses amis…..
…..qui l’empêche de massacrer les coupables.
Dans le Voyage de Paris dans l’Amérique, Cham ménage également de pseudo effets de surprise : « À ce moment le bateau passait sous un pont…patatra ! la cheminée se brise… » (pl. 19), « Les voyageurs s’élancent dans les embarcations, Mr Clopinet s’embarque aussi………dans la rivière où il disparaît » (pl. 19). Les points de suspension sont fréquents dans les histoires en images où ils servent à relier les fragments de la phrase lorsque celle-ci s’étend sous plusieurs cases. La non-interruption de la légende peut, dans certains cas, accompagner une situation frappante, comme un moyen de tenir le lecteur en haleine, ainsi suspendu à l’action. Nadar en fait usage dans les Aventures de M. Barnichon l’aéronaute :
Gare là-dessous ! Le sacristain, ému de l’arrivée des voyageurs, ….
…s’enfuit au plus vite,…
….et nos voyageurs oublient un peu de le rassurer.
La spectacularisation de l’histoire, la création de « temps forts » passe ainsi par un usage expressif de la ponctuation qui cherche à traduire au plus près le naturel de l’expression, les modulations de la voix d’un narrateur mué en conteur (82). Dans l’Histoire de Mr de Vertpré, ce sont quatre points d’exclamation qui font office de légende à l’image montrant l’expression d’effroi de la ménagère, chargée de préparer un dîner sans les ingrédients nécessaires (pl. 20). Placés seuls à l’endroit du texte narratif, ils jouent le rôle d’un idéogramme marquant l’émotion du personnage : ils pourraient figurer dans la case (ou plus tardivement dans une bulle), comme dans l’exemple cité des Trente six métiers de Becdanlo. D’une manière beaucoup moins marquée que ses continuateurs, Rodolphe Töpffer use également des ressorts de la ponctuation. La consultation du manuscrit original de Mr Vieux Bois indique qu’une ponctuation suggestive est ajoutée dans la version publiée : « Rencontre de Mr Vieux Bois. » devient « Rencontre de Mr Vieux Bois….. !!!!!!!! » (pl. 1). L’exclamation fait entendre le puissant émoi du coup de foudre éprouvé par le personnage, faisant de cette case inaugurale un point d’accroche plus explicite. Le régime manuscrit permet également un regain d’expressivité puisque les points de suspension se raccourcissent au fur et à mesure, suggérant l’éloignement de l’« Objet aimé ». De même, « Monsieur Vieux Bois se tue. Heureusement l’épée porte sous son bras » est transformé en : « Monsieur Vieux Bois se tue……Heureusement l’épée porte sous son bras » (pl. 5).
En tant qu’indice d’un affect contenu, le point d’exclamation signale souvent le passage au discours indirect libre qui permet, en évitant le recours aux embrayeurs du discours citant, de reproduire les paroles et les pensées des personnages en conservant leur expressivité et leur ponctuation propres. L’album de Louis Döes, Les Prétendus de Mademoiselle Pulchérie (1884), fonctionne entièrement sur le mode polyphonique. Les légendes y prennent en charge les mouvements de pensée de l’héroïne : « Mr Croquant approche de la quarantaine, et Mlle Pulchérie ne voudrait pourtant pas d’un homme vieux ! », « Le fils Bastard se nomme Elfège ! Si jeune encore…. ! on ne sait comment il se fera une position » (pl. 1), « Ce n’est pas que mademoiselle Pulchérie veuille se vendre…..oh ! » (pl. 2). Dans cette histoire, Louis Döes semble constamment tenté par le discours direct qu’il ne s’autorise pourtant jamais. Il lui préfère le discours indirect libre qui permet de restituer le naturel langagier de la vieille fille, accentuant la caricature et le réalisme de l’histoire, tout en restant dans le cadre énonciatif posé par Töpffer – dans les séquences de presse, dans Le Bossu de Genève par exemple, il n’hésite pas à employer le discours direct. Pour les mêmes raisons, la familiarité du langage parlé est reproduite dans Pincez-moi à la campagne !! ─ le titre déjà indique le régime discursif de l’histoire ─ où la voix de Croquoison et celle du narrateur sont parfaitement confondues :
Monsieur de Croquoison s’habille vivement, ma foi ! La chasse ça va ! Voilà une distraction ! Il va en profiter. Quand on vient à la campagne, c’est pour s’amuser (pl. 13).
Fréquemment dans les albums, les interjections « Saperlotte ! » et « Ah Sapristi ! » apportent une coloration spontanée affective à la manière d’une citation. D’autres, comme « Oh ! », « Aïe ! », « Hélas ! », « Fatalité ! », « Diable ! », ont également à charge de souligner les événements en faisant passer au premier plan ce qu’ils contiennent de dramatique, de sensationnel ou de surprenant. Les interjections onomatopéiques font, elles aussi, vivre l’histoire en y faisant figurer les sons produits dans le monde référentiel. La plus conventionnelle et la plus usitée est « Patatras ! » mais Pincez-moi à la campagne !! en contient d’autres à fonction parfois didascalique (83) : « (drin !drin !drin !) » (pl. 1) donne l’idée de la sonnette actionnée, « Pan !Pan !Pan ! » (pl. 8) suggère les coups donnés à la porte de Mr de Croquoison et « Ton-ton-ton-ton-ton-taine-ton-ton » (pl. 13) rend le son du cor de chasse. En 1808, ce principe mimétique du langage est exposé par Charles Nodier dans le Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises (seconde édition en 1828), il en use également au chapitre « Invention » (pp. 377-378) de l’Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux, qui est entièrement composé d’onomatopées (les lettres de certains mots sont multipliées pour appuyer l’effet sonore, « Trrrrrrrrrrrrrr »). Lorentz emploie ce moyen, dans Fiasque, pour créer un effet de voix, d’oralité, lors des présentations du « Chef de BATTTTTAILLLLLON de la Garde nationale » (pl. 34, vol. 1) et de « MONÇIEURE et MÂDAME le Maire est très-contents » (pl. 30, vol. 1) – l’orthographe, l’italique et les majuscules mettent à distance une formulation typique.
L’aspect dialogique de l’énonciation repéré dans les albums est à relier non seulement à la tradition orale, à l’influence des spectacles populaires où l’interaction est de mise, mais à la poétique du récit excentrique (et plus largement de l’anti-roman), où la mise à l’épreuve du discours littéraire passe par l’exhibition de la parole du narrateur. Dans le récit parodique, « l’effet de mimesis sera fonction de la présence du narrateur » :
Ce dernier se fera fort de ne pas nous laisser oublier non seulement qu’il « parle », mais encore que le récit s’écrit sous nos yeux. Le récit parodique, par la monstration répétée de son geste scriptural, nous renvoie constamment à la réalité de la « personne » de « l’auteur ». (84)
Les narrateurs de Tristram Shandy ou de Jacques le fataliste adoptent en ce sens un ton de conversation rappelant que le récit est le fruit d’une autorité « auctoriale » (85) capricieuse :
Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu’il me plairait. (86)
Dans ce cadre, « écrire […] n’est rien d’autre que converser », comme l’explique le narrateur de Tristram Shandy (87). Cette modalité spécifique de l’énonciation est aussi liée aux mutations éditoriales :
Le livre jusqu’au XIXe siècle simule abusivement la communication inter-personnelle : j’écris ceci pour toi, ami lecteur, mon confident, mon reflet, mon autre moi. Le livre romantique, lui, simule la communication sociale. La lecture est acte de partage. (88)
Ainsi les auteurs de bandes dessinées marquent-ils la distance avec les albums de Töpffer en construisant la figure d’un narrateur qui s’insinue dans la fiction pour mettre en place une situation de communication. Cela commence par la suggestion d’un espace imaginaire commun que les nombreux « nous », « nos » ou « notre » ont à charge de raviver. Le narrateur et le narrataire sont ainsi englobés dans un réel fictif où ils partagent la même proximité avec les personnages qui deviennent « nos voyageurs », « nos héros », « nos amis ». L’emploi de pronoms inclusifs permet de faire entrer le lecteur dans l’histoire, créant l’effet d’une narration simultanée que le caractère collectif du rire autorise et justifie. Loin d’un discours monologique, le récit émane d’une voix engagée dans le partage, l’humour étant un phénomène fondé principalement sur l’échange. Le contact avec le lecteur est ainsi maintenu à l’aide d’éléments à « fonction phatique » (89), comme « On comprend pourquoi », « comme nous le savons » (Les Travaux d’Hercule, pl. 40 et 45), « Bon ! quand je vous disais ! », « On comprendra que » (Histoire de Mr Verjus, cases 64 et 89). L’intrusion du narrateur, visant à affirmer sa toute puissance et à briser l’illusion référentielle dans Tristram Shandy, est utilisée dans l’histoire en images pour créer une proximité, un lien de connivence avec le lecteur, à la manière des apartés dans le théâtre de boulevard, lorsque le personnage prend le spectateur à témoin pour commenter l’action. Il en va ainsi des adresses franches au lecteur, parmi lesquelles on retrouve la tournure interrogative engageant le récepteur dans l’échange fictif : « Vois-tu, cher lecteur, devant ces grands effets, l’art s’efface » (Des-agréments d’un voyage d’agrément, pl. 13), « Croirez-vous que je choisis le trône !.. » (Voyage d’un âne dans la planète Mars, pl. 18), « Connaissez-vous les tramways du Havre et le sans-gêne anglais ? », « Ces demoiselles aussi dites-vous ? Peut-être ! Pour mon compte je crois qu’encore sous l’influence de la veille elles n’ont pas une sensation bien nette des choses » (La Famille Fenouillard, pl. 16 et pl. 21). Ces interlocutions ou tournures relationnelles ont pour rôle de « fictiviser » le narrataire tout comme le narrateur (90), et de sceller ainsi l’identité des deux instances à l’œuvre dans l’acte de lecture, toujours dans la continuité des récits excentriques de l’époque :
De manière générale, on perçoit une jubilation du narrateur à multiplier les adresses au lecteur, une jouissance à le martyriser, mais aussi un plaisir tout simple à vérifier que la communication passe (91).
Comme au théâtre, où les spectateurs sont interpellés au début et à la fin de la pièce pour annoncer le jeu et y mettre fin, notamment dans la comédie, l’adresse au lecteur survient dans le texte de la préface et de manière conclusive, comme une façon amicale de prendre congé et d’assurer la liaison entre le monde de la fiction et celui de la vie. L’interpellation intervient notamment lorsque est formulée une morale ou récapitulé un procédé démontré (92).
D’autres interventions du narrateur consistent à porter un commentaire satirique, ironique à valeur de vérité générale (il est fait usage d’un présent gnomique), inséré dans le texte et légitimé par la fiction. Cham utilise néanmoins des tirets pour circonscrire de tels propos ainsi constitués en enclaves extranarratives, comme lorsque Mr Boniface croise au cours de son voyage (pl. 27) des élèves d’une école de charité (« ─ Ils sont forts bien élevés, vous parlant toujours nu-tête »), des quakers (« ─ La religion de cette secte oblige à porter des habits sans boutons, ce qui les expose à chaque instant à se trouver dans le costume écossais ») et un pleureur public (« ─ On pleure à la course ou bien à l’heure ; pour des sanglots sans larmes, c’est moitié prix ; pour pleurer d’un œil, 10 fr. ; pour pleurer des deux yeux, 20 fr. Les pelures d’oignons sont fournies par l’administration. Les pauvres ne sont jamais pleurés »).
Dans Les Trente six métiers de Becdanlo, Louis Lemercier de Neuville accompagne de même les tentatives du personnage à trouver un emploi de commentaires en forme de sentences. Dans cet album, chaque planche de deux (exceptionnellement trois) images est consacrée à un métier : dans la première case, Becdanlo essaie l’emploi, dans la seconde il échoue ou est renvoyé. Pour marquer la transition entre les deux états, le narrateur prévient : « On commence par être pion, on finit par être….mais vous allez voir ! » (pl. 4), « L’esprit coute (sic) parfois très cher ! » (pl. 11), « On ne s’improvise pas apothicaire » (pl. 16), « Mais dans tout, il faut s’y connaître ! » (pl. 25). Le narrateur recourt également aux interjections (« hélas », « patatras ») et au style oralisé (« Mais voila-t-il pas qu’un jour », pl. 21 et 22). Précisément ici se retrouve le modèle évoqué du spectacle de marionnettes où les figurines interagissent constamment avec le public : Louis Lemercier de Neuville adapte au récit graphique les tournures mises en œuvre dans ses représentations. En plus d’être un journaliste réputé et un auteur de vaudevilles, il est effectivement un marionnettiste célèbre en son temps. Il participe notamment à l’éphémère aventure du Théâtre érotique de la rue de la Santé (l’Erotikon Theatron, fondé en 1862 avec Amédée Rolland, Théodore de Banville et Henry Monnier) et ouvre, en 1863, son propre Théâtre des Pupazzi, un petit théâtre portatif, au succès immédiat. Ses premières poupées sont découpées dans de petites plaques de carton sur lesquelles sont collées des caricatures extraites du journal Le Boulevard. Il se montre remarquable imitateur et satiriste :
Il met en scène les hommes du jour et réalise une sorte de « journal parlé » littéraire et politique. Lemercier est à lui seul une troupe itinérante, et se produit à Paris, mais aussi en province, dans des salons privés, parfois même devant les plus grands personnages de l’État. […] Portées par des improvisations et non par un texte écrit, les caricatures s’adaptent spontanément au public. (93)
En plus des pièces pour adultes, Lemercier de Neuville a aussi un répertoire pour le jeune public, c’est pour lui qu’il est reçu par Napoléon III en 1869. À l’adresse des enfants, les considérations interpolées dans le récit sont aussi un moyen d’orienter la lecture. Elles sont légion sous le crayon de Christophe, l’auteur-narrateur ne manquant jamais l’occasion de gloser. L’excursus commentatif se fait aussi didactique : « l’astre pâle des nuits sereines (la lune, pour ceux qui sont comme la nuit) », Le Savant Cosinus (pl. 42), « La figure ci-dessus étant assez claire par elle-même, nous jugeons inutile de donner de plus amples explications », La Famille Fenouillard (pl. 39). S’ils procèdent d’un mode énonciatif adapté aux enfants, et s’ils convoquent les modèles du montreur de lanterne magique, du manipulateur de marionnettes ou du théâtre populaire, tous ces opérateurs de contact, nombreux dans les feuilletons du Petit Français illustré, font signe d’autre part vers le système dialogique propre au journal.
3. Discours directs
Un rapport de connivence avec le lecteur, voire de confidence, s’établit clairement dans les rubriques écrites de la presse à mesure qu’elle se popularise. Le modèle convoqué par la poétique du journal est celui, non pas de la conversation mondaine de salon, mais de la causerie familière :
Le journal de la monarchie de Juillet était réservé à une sphère limitée de la population qui se déclinait depuis l’aristocratie jusqu’à la moyenne bourgeoisie, toutes classes accessibles à l’idéal du salon aristocratique, par tradition ou par aspiration. À partir du moment où le journal se démocratise, les formes conversationnelles mobilisées se popularisent aussi. À l’idéal de la conversation succède le modèle moins élitiste et formalisé de la causerie. Les esprits les plus dénigreurs de la presse préfèrent même parler de commérage, de bavardage, de potins (94).
Ainsi le chroniqueur use-t-il de formes conversationnelles pour se rapprocher, dans une optique démagogique autant que démocratique, d’un lecteur devenu un interlocuteur à part entière. De la même façon, la bande dessinée peut s’adresser entièrement (et non à l’occasion seulement d’une prise à partie du lecteur) au vaste public que vise le journal à partir du Second Empire. Le narrateur emploie alors le « vous » et se fait proche de certains messages publicitaires. C’est notamment le mode énonciatif de la séquence de Nadar, Le Mal de dents, molaire arrachée à Cruickhank (sic), qui est l’adaptation d’une histoire de George Cruikshank intitulée The Tooth-Ache (1849) : « Vous êtes effrayé de votre changement en vous regardant au miroir le matin venu », « Et vous vous rendez chez le pharmacien », « Votre surprise en vous apercevant que cette interminable opération n’a duré qu’une minute » (Le Journal pour rire, 14.02.1851). Avec ce « vous », le narrateur s’adresse au lecteur individualisé comme à l’ensemble des acheteurs du journal : « Toute parole journalistique est, d’origine et par destination, plurielle, collective, ou du moins insérée dans un complexe et polyphonique système d’interlocution » (95).
En termes de gestion de l’écrit, le fait le plus manifeste de l’adaptation de la bande dessinée à l’évolution médiatique de la presse est la quasi disparition, à partir des années 1880, d’une narration à la troisième personne, remplacée par des discours directs. Dans les histoires en estampes, Rodolphe Töpffer ne fait qu’exceptionnellement parler ses personnages, faisant le choix du discours narrativisé ou rapporté, ce qui lui permet de conférer une charge ironique aux verbes introducteurs, autant qu’aux rares discours directs ainsi mis en valeur (par leur rareté et par leur exceptionnelle longueur, visuellement prégnante, dans le cas des discours institutionnels évoqués) (96). Les continuateurs le suivent généralement dans cette voie, jusqu’à ce que le journal et la formule du gag imposent le discours direct. Beaucoup d’articles, dans la presse, prennent la forme de retranscriptions de dialogues complets ou partiels :
Le discours direct affleure dans les journaux et prend le pas sur l’exposé théorique et le récit. La parole vive et généralement légère prédomine dans toute une presse apolitique, et les créations de journaux appelés à une longue carrière, comme Le Figaro, Le Petit Journal ou Le Gil Blas, prouvent la validité chronique de ce modèle. (97)
Il s’agit de se rapprocher de la parole populaire et de créer l’impression d’une relation familière avec le lecteur. Dans les colonnes du journal, véritable enregistreur de paroles, prennent également place des « microformes » qui se font « retranscriptions de conversations saisies sur le boulevard, happées dans les salons, les théâtres, imaginées dans les fictions » (98). Le gag en images est l’une d’elles, qui retranscrit mais également représente, met en scène la parole populaire, comme dans cette séquence de Jean Quidam, Quand le vin est tiré, il faut le boire, où l’effet de l’alcool s’illustre dans une conversation de bar : « – J’lui dirai en face, je n’crains personne. Ne m’quitte pas : tu peux l’prouver. Et je n’suis pas saoûl : tu m’connais, n’est-ce pas ? eh ben, si j’étais saoûl, le vin s’rait bon ; mais c’vin là. – Garçon, du même ! » (La Caricature, 15.05.1881).
Cet usage du discours direct, qui sert autant l’action que la caractérisation des personnages, va de paire avec la retranscription de tournures langagières populaires, d’idiolectes et de sociolectes, comme cela se généralise en littérature. Des fresques sociales d’Eugène Sue ou Walter Scott, aux romans de Zola contaminés par la langue du peuple, en passant par les romans régionalistes de George Sand et le drame romantique, l’hétérogénéité socio-linguistique est observée pour son intérêt stylistique et mentionnée au nom d’une certaine forme de pittoresque (99). Dans les parodies qu’il donne au Musée ou magasin comique de Philipon, Cham ne manque pas de railler l’écriture populaire qui contribue au formidable succès des Mystères de Paris. Il ponctue son texte d’expressions argotiques tout en pointant ce qu’elles peuvent avoir d’obscur pour un lecteur non initié :
Mais, à propos de pré, j’oubliais que vous ne devidez peut-être pas le jars…Tout le monde ne jouit pas des bienfaits de l’éducation !…
Devider le jars veut dire parler argot. – Le pré, ce sont les galères. – Pitancher, c’est boire. – Goualeuse, chanteuse. – Chourineur, donneur de coups de couteau. – Les ardents, les yeux. – Les fauchants, les ciseaux. – L’aileron, le bras. – La pelure, les vêtements. – Acheter à l’œil, acheter à crédit.
Reprenons notre récit. (100)
Sous la plume des écrivains, la parole populaire est néanmoins maintenue à distance et mise en opposition à la langue bourgeoise. Retransmise sous couvert d’une démarche qui se veut ethnologique, elle s’accompagne de commentaires critiques (101). Un appareil de citation est soigneusement mis en place et Léonce Petit nous semble adopter la même démarche dans les feuilletons des Histoires campagnardes. Se confortant fort probablement au modèle töpfferien, le dessinateur ne donne pas systématiquement la parole à ses personnages, et lorsqu’il le fait, il ne caricature pas la langue vernaculaire, seulement garde-t-il des expressions caractéristiques. Son objectif n’étant pas de faire la satire du monde rural, ses paysans s’expriment presque tous comme le narrateur. Ainsi fait-il usage de l’italique lorsqu’il mentionne à l’occasion d’un discours indirect libre un terme où s’illustre un accent régional, rustique ou une influence patoisante (« créiature », « penailleux », « galoupias », « boustifaille »).
Cette précaution tranche avec le reste des séquences de presse où se donnent à lire moult tournures argotiques, pleinement intégrées en tant que discours directs. La caricature du soldat, évoquée au sujet de La Lanterne de Boquillon d’Albert Humbert, passe notamment par la retranscription d’une parlure typiquement associée à cette profession, particulièrement tournée en ridicule après la fin de la guerre franco-allemande en 1871. Aux côtés du célèbre Sapeur Camember, d’autres représentants du corps de l’armée s’illustrent par leur accent dans les pages de L’Éclipse, de La Caricature, du Rire ou du Musée comique. Dans ce dernier titre, Le colonel Ronchonot laisse éclater son franc-parler, désappointé qu’il est devant un globe terrestre que son chat fait subrepticement tourner : « Mille millions d’gibernes en zinc ! qu’c’est qu’ça donc ? Avais l’nez su’la mer de chose de Chine, m’trouve en plein su’l’Australie ! Comprends rien à c’te mécanique-là » (G. Frison, 1885). Le rendu de toutes les particularités de la langue populaire (simplifications articulatoires, fautes syntaxiques, jurons) participe ainsi du comique troupier qui sévit dans la presse dans les dernières décennies du siècle. La formulation d’expressions populaires sert aussi la vraisemblance des séquences, où concordent ainsi les mimèsis graphique et verbale. Georges Lafosse ajoute en ce sens une parenthèse pour forcer la caricature : « De tous les commissionnaires du quartier des Martyrs, Pierre et François (ou Piarre et Franchois, si vous le préférez) étaient les plus justement réputés comme honnêteté et intelligence » (Un Jour de terme, Le Journal amusant, 07.10.1876). De même l’étranger doit-il s’exprimer dans un baragouin qui l’identifie d’emblée, comme l’Anglais qui bute sur les articles et s’égare dans la conjugaison : « Tout me était égal, pourvu que je rigolerai à Paris…Ohé, ohé !… » (Carnet de voyage, Caran d’Ache, Le Figaro, 29.11.1897). Dans cette dernière planche, Caran d’Ache dessine une bulle sortant de la bouche de l’Anglais, dans laquelle s’inscrit un gribouillis traduit par une légende exclamative placée au pied de l’image : « Aoh ! stioupide coiffeur !…Chêmeau !!… ».
Cet exemple souligne combien le texte peine à intégrer l’espace iconique, la première cause de cette résistance étant peut-être à chercher dans le manque d’espace au sein du dessin. Une séquence sans titre du Pêle-Mêle (fig. 78) le suggère : elle voit les pensées, puis les formules de politesse échangées par deux hommes, Machin et Chose (qui s’évitent en s’abritant derrière leurs journaux respectifs avant de se percuter), inscrites en dessous du cadre où se joue la scène graphique. Dans cet espace au fond grisé, de petits rectangles blancs sont disposés à côté de chacun des personnages et portent un numéro renvoyant à la réplique correspondante. Un problème de place, à l’échelle du dessin mais aussi de la page du journal, semble occasionner cette inhabituelle répartition du texte et de l’image. Il y a bien une recherche d’intégration du langage dans l’espace du dessin mais cette incorporation ne se fait pas totalement, le verbe et la figure se retranchant dans leurs espaces respectifs à l’image de Machin et de Chose – le repère donné de l’emplacement du texte produit un effet de sens puisque les deux cadres blancs se rejoignent pour ne former qu’un seul au moment de la rencontre.

Fig. 78 – L. Daisne, Le Pêle-Mêle, n° 12, 21.03.1896. Source : Coll. privée.
Pourtant, la bulle est couramment utilisée dans la caricature anglo-saxonne des XVIIIe et XIXe siècles. Des dessinateurs comme George Cruikshank et James Gillray en font un usage fréquent (102). Alors qu’il répugne à inclure l’oral dans le dessin, Rodolphe Töpffer lui-même use de phylactères dans certaines de ses caricatures. En France, quelques ballons se remarquent dans les caricatures napoléoniennes, dans les images des textes à vignettes comme dans celles des macédoines et des rébus de la presse du XIXe siècle (103). Comme le signale Danièle-Alexandre Bidon, la parole des personnages est insérée dans l’image dès le IXe siècle (104). Cependant, beaucoup de phylactères donnés en exemple par les historiens de la bande dessinée ne peuvent être apparentés à des bulles :
C’était là confondre les genres : dans la majorité des cas, il ne s’agit que de ressemblances formelles. En effet, les phylactères ne jouent que rarement le rôle des ballons de bande dessinée : il s’agit le plus souvent d’étiquettes, qui identifient le nom du personnage ou, dans le même but d’identification, qui contiennent le début du livre qui les a fait connaître. Il n’y a donc pas d’émission de paroles. (105)
Comme dans les manuscrits médiévaux ou les caricatures révolutionnaires, les dessinateurs au XIXe siècle inscrivent parfois le son à proximité des sujets qui l’émettent. Gustave Doré le fait une première fois dans l’album Des-agréments d’un voyage d’agrément (pl. 20), à l’occasion d’une large vignette où des lettres manuscrites s’échappent de la bouche des Bernois, du museau des vaches et des cors des Alpes. Sortes d’onomatopées, les nombreux « la la hou hou » (chant de bonheur des Bernois) sont ainsi soumis à la logique visuelle par leur inscription dans tous les sens voulus par la position des êtres chantant. La seconde fois, il fait sortir des lettres du bec d’un perroquet qui répète « PROTECTORRRRRAT », dans l’Histoire de la Sainte Russie (pl. 90) (106). À la même période dans la presse, Stop offre la représentation stylisée et fantaisiste de la voix et de ses modulations. Il s’agit d’une vignette des Aventures sentimentales et dramatiques de Mr Verdreau (fig. 79) où le personnage découvre grâce à son mystérieux chat qu’il a un don pour le chant – « Ce fut une révélation, et M. Verdreau se mit à roucouler comme le premier serin venu ». Une portée sort alors de sa bouche indiquant une mélodie impossible à chanter, les notes les plus hautes, soutenues par des points d’orgues, étant proches d’ultrasons ; le fil qui forme la partition dessine progressivement comme des arrêtes de poisson offertes au félin.

Fig. 79 – Stop, Aventures sentimentales et dramatiques de Mr Verdreau, L’Illustration, n° 359, 12.01.1850. Source : Coll. Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse.
L’autonomie de la voix des personnages, qui se détache de celle du narrateur, passe ensuite par l’usage de la bulle qui reste toutefois confinée à un usage spécifique, à savoir la citation d’une expression, d’un discours typique ou populaire. La plus ancienne que nous ayons relevée se trouve dans la séquence citée de Nadar, Le Mal de dents. Elle apparaît lorsque le personnage souffrant d’une rage de dents se rend chez le pharmacien. À la vue de sa joue enflée, un passant lui crie : « Oh ! c’te balle !!! » (107). Comme dans cet exemple, les bulles encerclent souvent des paroles argotiques ou familières, qui viennent appuyer ou confirmer la légende. Cet usage prolonge celui de la caricature anglaise satirique : « Si on étudie un peu attentivement l’ensemble des caricatures à bulles, on se rend compte que, la plupart du temps, celles-ci sont de fait l’occasion de transcrire au plus près les traits oraux que la littérature répugne à intégrer » (108). Aussi les bulles fin-de-siècle s’emploient-elles pour des expressions figées, usuelles, typiques d’un groupe social, d’une époque ou d’une situation : « Ré-sul-tat » / « complet des » / « cou-ou-ou-ou-oursss’s » pour le vendeur de Paris sport (Le Pêle-Mêle, 18.04.1896) ; « Vive l’Empereur !!! » dans Voilà comme nous étions en 1808 ! (Le Chat noir, 06.02.1892) ; « Citoyen, ne portez que des flanelles Colpsonn », slogan de réclame inscrit sur le vêtement des personnages (Un duel original, La Caricature, 24.09.1898) ; « Nous n’avons rien à déclarer » au passage de la douane (Instantané Rœntgen servant à découvrir la fraude, Le Rire, 10.07.1897), etc. La parole est également donnée aux animaux, qu’il s’agisse, dans la caricature isolée ou la séquence d’images, d’un cheval, d’un perroquet, d’un poisson ou même d’un éléphant : « Allez et ne recommencez plus ! » (Une leçon, Le Rire, 07.08.1897). L’unique phylactère que nous relevons dans le fonds Quantin provient d’un poisson s’exclamant « Gloire à l’amiral », à la vue d’un mémorial abandonné en mer (Le commandant la Fureur-des-Flots, M. Monnier, s17-n7, 1902). Enfin, l’alarme d’un réveil peut également faire l’objet d’une bulle (« Drrrinnnn !!! Drrrriiinnnnnn !!! », Un subtil philosophe ou un mode d’emploi inédit du réveil-matin, Le Rire, 09.10.1897).
La bulle vient aussi apporter une coloration affective, comme dans cette séquence de Maurice Radiguet où un homme offre son vêtement à de pauvres gens, le cadet de la famille lui disant « Le bon Dieu vous l’rendra » (Cinmartin, le bon cocher, Le Rire, 06.11.1897). Lorsqu’elle cohabite avec une légende narrative, elle est une manière d’exemplification, comme dans les bulles dessinées par Christophe. Il y a trois phylactères, en effet, dans le dernier épisode du Savant Cosinus (PFI, 25.11.1899). Le premier matérialise « le son harmonieux de la seule chanson qu’il connaisse, son éducation ayant été très négligée » – « pour fair’ de l’hydrogêêêêne on prend un tube en porcelai…..ne […] » –, les deux autres contiennent les lamentations de la famille Fenouillard qui voit, à la naissance des jumelles de Cosinus, s’évanouir l’espoir d’un héritage – « Ça faisait partie des espérances ». Une case des Malices de Plick et Plock (PFI, 26.12.1903) se distingue également par six bulles délivrant le « tonnerre d’applaudissements et de vivats [qui] s’échappent de l’armoire », après que les lutins se soient souvenus du mot magique « RÉFLÉCHIR AVANT D’AGIR » – « Victoire !!! ils ont trouvé le mot magique », « Bravissimo ! », « Vive Plock !!! », etc. En complément de la légende, ces bulles viennent donc dynamiser la case et lui confèrent un léger surplus d’information. Dans un dessin (sans légende) conservé au Musée de la bande dessinée (fig. 80), Christophe ajoute également un sens, précise la figure abattue du mari à l’écoute de sa femme en donnant à la pointe de la bulle la forme d’un bec de cane.

Fig. 80 – Christophe, dessin original. Source : Coll. Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.
Ainsi, la bulle peut donner lieu à des effets comiques, comme lorsqu’elle exhibe son « effet de dissimulation » (109) en servant à masquer les parties intimes d’un Félix Faivre représenté nu : elle enferme le mot « Shocking !!! » (F. Fau, Le Rire, 19.09.1896). Le recouvrement est d’autant plus souligné que la plume ayant servi à tracer la bulle est elle aussi figurée. Étrangère à l’illusion représentative, la bulle ouvre ici la porte au jeu sur la tension entre la surface d’inscription et l’espace diégétique. Elle offre également au dessinateur l’opportunité de jouer sur la position hors-champ de l’émetteur. Dans une courte séquence anonyme (fig. 81), un personnage peu gracieux lit son journal à travers une loupe, le bas de son visage est grossi par le verre, tandis qu’à sa droite une bulle lance cette invective : « Oh ! Que t’es laid !! ». Le personnage tourne son visage en direction du cri, la lentille agrandit alors son oreille.

Fig. 81 – Singuliers effets de la loupe, La Caricature, n° 975, 03.09.1898. Source : Gallica.bnf.fr.
Cette anecdote semble dire qu’aux jeux optiques présents dès les premières histoires en images s’ajoutent à la fin du siècle des effets de voix pour faire de la séquence graphique une sorte de medium audiovisuel, du moins compris comme tel dans le jeu du faire-semblant (110). Que la séquence soit muette ou non, la bulle fonctionne donc comme une exhibition ponctuelle de l’oralité et du son, comme un renfort de l’expressivité et non comme le véhicule d’un sens fondamental à la compréhension de l’histoire, de l’anecdote. Faisant référence à la langue plus qu’à la parole, elle n’implique pas d’échanges verbaux, elle n’est pas autonome et reste enchâssée dans le réseau narratif construit par l’enchaînement des images.
Il y a des exceptions, naturellement, et en feuilletant Le Papillon (Ascension libre et…descente forcée de M. Marius Richepanse, O. Vide Riche, 02.12.1896), La Caricature (Un coiffeur coiffé ou l’infortune vient en dormant, Jehan Testevuide, 04.06.1898) ou le Gil Blas illustré (Tartarinade, A. Falco, 25.02.1898) on découvre des séquences où l’énonciation est intégralement inscrite dans des bulles, ainsi mises au premier plan. Elles illustrent combien la bulle est de plus en plus populaire, son emploi étant encouragé, à partir des années 1890, par les avancées technologiques en matière d’enregistrement et de restitution du son. Aux États-Unis, en 1877, l’inventeur Thomas Edison dépose, en effet, le brevet du premier phonographe. À la même date en France, le 30 avril 1877, le poète Charles Cros rédige une note qu’il envoie à l’Académie des sciences sur le « Procédé d’enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par l’ouïe », dans laquelle il expose le principe de ce qu’il nomme le paléophone, « voix du passé » (111). Cette invention (112) est l’objet d’une planche d’Albert Guillaume, Les Perfidies du téléphone, publiée dans Le Journal pour tous (03.01.1894). Elle montre d’un côté une femme en compagnie de son amant, de l’autre son mari, le couple dialoguant par le biais de postes téléphoniques. Les paroles échangées sont écrites manuellement, elles observent des mouvements ondulatoires imitant les inflexions de la voix, et trouvent à se placer dans des cases blanches centrales, espace spécialement dédié. La voix, non pas humaine mais téléphonique, est ici au premier plan de la narration, elle est inscrite non au cœur des images mais dans un entre-deux, à considérer comme un « lieu teinté de magie moderne où prendrait corps le miracle de la technologie de la télécommunication » (113), à moins de voir dans ce gag, où l’appareil est complice de l’adultère, une « mise à l’épreuve ironique de ce nouveau mode de citation » (114).
> Page suivante : Partie II. – Chapitre III. La vocation parodique. A. Le voyage en images
> Page précédende : Partie II. – Chapitre I. L’art de faire des images. – C. Les possibles de l’image narrative
- G. Blanchard, « Esartinuloc ou les alphabets de la bande dessinée », Communication et langages, n° 26, 1975, p. 26.[↩]
- R. Töpffer, « Réflexions à propos d’un programme », Bibliothèque universelle de Genève, n° 4, avril 1836, p. 315.[↩]
- Dans les premières années du XIXe siècle, Firmin Didot réussit à graver les caractères cursifs de l’écriture dite « anglaise », qu’il emploie notamment dans l’épître dédicatoire des Bucoliques de Virgile (1806), où il souligne les difficultés rencontrées dans la fonte du caractère. Dans les Albums Jabot, la diversité dans la forme et la taille des lettres, et les différentes inclinaisons de l’écriture, sont l’indice de la main du calligraphe. Dans le Catalogue complet de l’œuvre de Gustave Doré, Henri Leblanc indique en ce sens, pour Les Travaux d’Hercule : « Cet album comprend 46 planches encadrées d’un filet noir, renfermant ensemble 104 dessins lithographiés à la plume, tous accompagnés d’une légende également lithographiée », 1931, p. 350.[↩]
- « Histoire de M. Jabot », Bibliothèque universelle de Genève, tome XX, avril 1839, p. 342.[↩]
- À la planche 16, à l’évocation du docteur homéopathe, une parenthèse précise « (Connu par son procédé d’engraisser les malades) », en rapport au dépérissement de Mr Jobard sous l’effet de cette médecine.[↩]
- À la planche 22 : « Or ceci a lieu le 24 février 1848… Mr Guizot le ministre est chez le roi, on lui remet la nouvelle que la province se révolte…..le soir même le roi abdiquait. (Telle est la véritable cause de la révolution de 1848) ».[↩]
- Planche 2 : « + Mr. Plumet n’est pas fort sur le latin (Note de l’éditeur) ». Le procédé est toutefois inverse, les légendes de cet album étant composées en caractères typographiques, ce sont des rondes calligraphiques à la manière des Albums Jabot, ainsi que le saut de ligne et la petite croix, qui viennent souligner le décrochage commentatif.[↩]
- J. Dürrenmatt, « Quand typographie rime avec cacographie (1800-1850) », Romantisme, n° 146, 2009, p. 53.[↩]
- Après le style graphique enfantin, cette signature est évoquée par la recension du journal Tout-Paris, reproduite dans Le Gaulois : « Et puis, pigez-moi un peu c’te signature de Bob. Est-elle drôle, hein ? », Le Gaulois, 16.02.1890.[↩]
- Dont on ne connaît pas le nom, conformément au modèle que représente l’album des Amours de Mr Vieux Bois, histoire de la conquête de l’« objet aimé ». On retrouve notamment l’expression dans Fiasque de Lorentz (« M. Quadrature rêve le triomphe de l’objet aimé », vol. 2, pl. 1), dans La Civilisation à la Porte (« L’objet aimé remercie son bienfaiteur….. », pl. 16) et les Aventures de Monsieur Beaucoq (« Ô bonheur ! Beaucoq reçoit une lettre de l’objet aimé ! », pl. 8) de Cham, ainsi que dans les Aventures de Nestor Camard où Quillenbois en propose une variante (« Il supplie l’objet adoré de ne pas le juger à vue de nez », pl. 12).[↩]
- « Le n° 12 de L’Éclipse, contenant la Lettre du fusilier Boquillon à Simone, qu’on nous demande de tous côtés, est entièrement épuisé. Mais, dans quelques jours, on pourra se procurer, au prix de 5 centimes, chez tous nos correspondants et dépositaires, la Lettre tirée à part, sur beau papier », L’Éclipse, 28.04.1868. Fort de ce plébiscite, Albert Humbert fait paraître sur le modèle de La Lanterne d’Henri Rochefort, La Lanterne de Boquillon, fascicule au format de poche hebdomadaire à partir de 1876 : « Lorsqu’il voulut ensuite, à l’instar de Rochefort, publier sa propre Lanterne, il eut la chance de ne trouver aucun éditeur qui crût en son projet : par économie, il fut contraint de se passer de la composition typographique et dut encore autographier la totalité des seize pages de son texte. Il pouvait ainsi mêler de façon foisonnante le texte et l’image », F. Caradec, « La Lanterne de Boquillon », Romantisme, n° 75, 1992, p. 22.[↩]
- Dans ce journal se trouve d’ailleurs, en 1894, une résurgence du « style Boquillon », sans les fautes d’orthographe mais avec les ratures, à travers des lettres adressées au directeur du Rire, ponctuées de rapides dessins et signées par Dépaquit, « futur ex fusilier au 9e chasseur à pied, 2e compagnie, 6e escouade ».[↩]
- Pratiqué dans de nombreux manuscrits carolingiens, il prend sa source dans les traditions de la lettre zoomorphe et enluminée au moyen d’arabesques abstraites qui remontent aux premiers âges chrétiens ; A. Massin, La Lettre et l’image, Paris : Gallimard, 1993, p. 27.[↩]
- La première publication de la maison est un Abécédaire en action (1829) signé des initiales de Charles Philipon. Voir les travaux de S. Le Men, Les Abécédaires français illustrés du XIX e siècle, 1984 et l’article, « De l’image au livre : l’éditeur Aubert et l’abécédaire en estampe », Nouvelles de l’estampe, 1986.[↩]
- « Les peintres faisaient poser leurs modèles à l’atelier, sous une lumière latérale, et obtenaient l’illusion du relief et de la solidité par des passages nuancés de la lumière à l’ombre. Dès le début, on habituait les élèves de l’académie à baser leurs tableaux sur ce jeu conventionnel du clair et de l’obscur. On commençait par leur faire dessiner des moulages de statues antiques qu’ils devaient s’appliquer à modeler soigneusement par des jeux d’ombres plus ou moins denses », E.H. Gombrich, Histoire de l’art, 2001, p. 512.[↩]
- Précisons qu’Ingres ne se montre pas toujours académique dans le dessin de ses sujets, il peut sciemment faire preuve d’incorrections anatomiques comme dans La Grande Odalisque (1814) dont le dos est pourvu de vertèbres supplémentaires.[↩]
- P. Hamon, Imageries, 2001, p. 36.[↩]
- Le relief est une notion de style indispensable pour Gustave Flaubert. Dans une lettre à Louise Colet, du 7-8 juillet 1853, il écrit par exemple : « Le relief vient d’une vue profonde, d’une pénétration de l’objectif ; car il faut que la réalité extérieure entre en nous, à nous en faire presque crier pour la bien reproduire », Gustave Flaubert, préface à la vie d’un écrivain ou extraits de la correspondance, présentation et choix de G. Bollème, Paris : Seuil, 1963, p. 134.[↩]
- Découvert peu avant la photographie, en 1838, il permet par la superposition de deux images, reflétées par des miroirs puis des prismes, de faire apparaître les objets en relief, comme s’ils étaient des corps solides.[↩]
- A. Massin, Azerty, l’alphabet du monde, Paris : Gallimard, 2004, p. 40. [↩]
- L’un des trois niveaux de communication – avec l’objectivité et l’intégration – proposés par Pierre Duplan sur le modèle des registres existants en arts graphiques. Le jaillissement correspond à la « typographie expressive », l’objectivité à la « typographie fonctionnelle » et l’intégration à la « typographie invisible » ; P. Duplan, « Pour une sémiologie de la lettre », L’Espace de la lettre, Paris : UGE, 1977, pp. 295-347.[↩]
- La page de titre de cette historiette contenue dans le recueil Feuilles d’hiver présente, en grand format, la signature St Trucard donnée pour un fac-similé.[↩]
- J. Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », CEEI – Centre d’Étude de l’Écriture et de l’Image, communication au colloque « Écriture de la voix au XIXe siècle » organisé par José-Louis Diaz – UFR LAC, vendredi 19 janvier 2007, [en ligne], http://www.ceei.univ-paris7.fr/07_ressource/01/document/06.html (consulté le 15.05.2016).[↩]
- D. Sangsue, Le Récit excentrique, 1987, p. 24.[↩]
- « On ne saurait terminer cette revue rapide et superficielle de l’alphabet typographique sans dire un mot des nouvelles capitales qu’a depuis quelques temps introduit le charlatanisme effronté des annonces ; lettres figurées, lettres fleuries, lettres étroites, grêles, passées à la filière, lettres gonflées, hydropiques, rabougries ; lettres ciselées, cannelées, denticulées, torses, obliques, anguleuses ; lettres de toutes formes et de toutes couleurs ; il y en a pour tous les goûts, et tout cela est si difficile à lire qu’on s’en plaindrait si tout cela valait la peine d’être lu. […] La littérature que ces temps de décadence nous ont faite achèverait par là de donner son triste secret. Il est assez naturel qu’après avoir pitoyablement torturé la langue dans sa prose et dans ses vers, elle la poursuive pour la mutiler jusque dans ses formes les plus matérielles, dans les figures traditionnelles de l’alphabet », « De l’alphabet typographique », Bulletin du bibliophile, septembre 1836, n° 9, pp. 291-295 ; cité dans Critiques de l’imprimerie par le Docteur Néophobus, C. Nodier, textes choisis et présentés par D. Barrière, Paris : éd. des Cendres, 1989, p. 73.[↩]
- L’Amour, venu au château déguisé en M. Quadrature, rend une visite discrète, dans la nuit, à Mme de Charnueshanches : le chien Boubouche et le chat Minet sont transpercés de la flèche de l’Amour (pl. 67, vol. 1). L’épisode n’est qu’un rêve fait par M. Quadrature et l’allégorie romantique une image, sans doute, de la manière dont il fait taire les animaux lui barrant l’entrée du château.[↩]
- J. Dürrenmatt, Bien coupé mal cousu, 1998, p. 55.[↩]
- Un autre usage spécifique de la ponctuation, servant la parodie des vers de Lamartine, se remarque dans Patric et Patrac d’Henri Hébert, voir chap. III.B.3. Poésie romantique et littérature pastorale.[↩]
- Exceptionnellement, la phrase ne s’interrompt pas lorsque Craniose expose son projet de Société modèle fondée sur les bosses : elle continue en une case entièrement noircie d’explications (pl. 57-60). Sur les rapports de Rodolphe Töpffer à la théorie de la physiognomonie, voir B. Peeters, Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, chap. « La physiognomonie réinventée », pp. 2-19.[↩]
- Une large case exclusivement dédiée aux supputations de la « voix publique », après que Robinson ait « polké » avec mademoiselle de Monboson, déroule un texte construit à partir de trois « On dit », suivis de parenthèses citant les paroles pleines de propositions relatives et de conditionnelles, abrégées par « etc etc etc…… » et conclues par un banal « et puis voilà » (pl. 15).[↩]
- Dans ces différentes scènes, le déclamateur est caricaturé par la même posture, debout corps penché vers le public, la main levée et le doigt pointé en avant.[↩]
- P. Hamon, L’Ironie littéraire : essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris : Hachette, 1996, p. 24.[↩]
- Chaque invité à la soirée de la baronne est présenté par un portrait en pied, celui du « Parisien venu revoir sa Normandie » est accompagné d’une petite partition musicale (Ma Normandie, chanson de Frédéric Bérat écrite en 1836), celui de Charles de la Sierra-Morena, sous-lieutenant de houzards, inscrite dans un écusson.[↩]
- « Pendant l’espace de 15 jours, Mme de Poupernicle ne fit qu’engager le Gentleman à dîner, et le mener le soir à l’Opéra, ce qui procura au Gentleman l’avantage de connaître : – La Mouette de Portici, les Huguenots, le Bœuf Enragé, etc. etc.
[Pour bien faire, il faudrait que le lecteur eut à tourner des feuilles de papier blanc pendant l’espace de 15 jours, avant d’arriver à la planche qui va suivre] Tournez s’il vous plait », pl. 48.[↩] - Voir chap. III.C.2. Moyen Âge et discours savant.[↩]
- Elle ajoute : « mais il est vrai que ce phénomène accompagne la multiplication des histoires en images au détriment de la part rédactionnelle », A. Renonciat, « Les magazines d’Arthème Fayard et la promotion de l’histoire en images “à la française” », 9e Art, 2002, p. 42.[↩]
- Lorsqu’il crée Les Pieds Nickelés en 1908, Louis Forton (1879-1934) recourt à la bulle, en plus des paragraphes typographiés sous les images, pour placer des exclamations directement dans la bouche de Croquignol, Ribouldingue ou Filochard ; le dispositif exclusif de la bulle et du « texte off » placé dans un cartouche est, quant à lui, adopté dans les années 1950.[↩]
- R. Töpffer, Essai de physiognomonie, 2003, p. 6.[↩]
- « Réflexions à propos d’un programme », Bibliothèque universelle de Genève, n° 4, avril 1836, p. 315.[↩]
- Ibidem, p. 336.[↩]
- Chap. II.A.2. Polyphonie et unité thématique : Le Journal pour rire, Le Journal amusant.[↩]
- B. Peeters, Case, Planche, Récit, 1998, p. 101.[↩]
- T. Groensteen, Système de la bande dessinée, 1999, p. 134. [↩]
- J. Dürrenmatt, « Töpffer et le trait ironique », Les Lieux du réalisme : pour Philippe Hamon, études réunies et présentées par V. Jouve et A. Pagès, Paris : éd. de l’Improviste, Presses Sorbonne Nouvelle, 2005, p. 322.[↩]
- Idem.[↩]
- H. Bergson, Le Rire, essai sur la signification du comique, Paris : Presses Universitaires de France, 1940, p. 25.[↩]
- « Et tandis qu’ils sont le plus souvent incapables de comprendre un principe et d’en tirer, au moyen d’une suite de déductions, des conséquences pratiques, ils le sont beaucoup plus de remonter, d’un fait mis sous leur yeux, à un principe d’une application utile et directe », Réflexions à propos d’un programme, cité par A. Renonciat, « Rodolphe Töpffer et l’image populaire », Le Vieux papier, 1993, p. 172.[↩]
- T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 2009, p. 47.[↩]
- Philippe Kaenel, de même, souligne combien la gestuelle de personnages comme M. Jabot ou M. Vieux Bois puise dans l’art de la pantomime. Il rappelle, également, qu’une partie des dessins manuscrits du Genevois, légendés par lui-même, adoptent le modèle du monologue, du dialogue et plus généralement de la saynète ; voir « Paradoxe sur le comédien : Rodolphe Töpffer, la physiognomonie et le théâtre », De la rhétorique et des passions à l’expression du sentiment, 2003, pp. 134-135.[↩]
- Notice « Légende » du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, troisième acception : « Explications jointes à un plan ou à un dessin figuratif quelconque, pour en faciliter l’intelligence : La Légende d’un plan, d’une carte », P. Larousse, Paris : Administration du Grand Dictionnaire universel, tome X, 1873, p. 322.[↩]
- T. Groensteen, Système de la bande dessinée, 1999, p. 156.[↩]
- G. Serbat, « La place du présent de l’indicatif dans le système des temps », L’Information grammaticale, n° 7, 1980, pp. 36-39. Parmi les albums de Töpffer, seule l’histoire de Mr Crépin, la plus verbeuse, contient des indicateurs temporels : dans les dernières planches, le narrateur précise que « Madame Crépin boudant depuis huit mois, Mr Crépin entre un jeudi dans sa chambre », puis qu’« au bout de onze mois Craniose meurt un jeudi matin », et enfin qu’« au bout de cinq ans Fadet meurt un samedi matin ». Pour la conclusion accélérée de l’histoire, Töpffer recourt donc au présent qui n’a plus exceptionnellement valeur d’actuel.[↩]
- Dans le sens où l’énoncé, en modifiant l’ordre archétypal de la phrase simple, ordinaire, tire sa portée sémantique et expressive de sa forme et de son organisation esthétique, desquelles il reste indissociable : « Dès lors qu’il y a effort pour bien dire, il y a effort littéraire », M. Mauss, Manuel d’ethnographie, Paris : Éditions sociales, 1967, p. 97.[↩]
- F. Caradec, Christophe, 1981, p. 111.[↩]
- « Ces dames visitent avec intérêt le promenoir des moines ; elles contemplent avec émotion l’énorme roue que faisaient tourner les prisonniers ; elles considèrent avec stupeur la place qu’occupait jadis la cage de fer en bois, et sondent avec horreur les sombres profondeurs des in-pace !!! », La Famille Fenouillard, pl. 15, est souligné ce qui est ajouté.[↩]
- Dans l’épisode où la famille Fenouillard est recueillie par Œil-de-Lynx, Christophe ajoute en conclusion de quatre cases un commentaire à propos du trappeur qui considére le couple Fenouillard : « Œil-de-Lynx en est tout attendri et regrette d’être célibataire », « Quant à Œil-de-Lynx, il songe aux moyens à employer pour ne plus rester célibataire », « Les idées d’Œil-de-Lynx, concernant le célibat, passent par une phase nouvelle », « Œil-de-Lynx se félicite d’être resté célibataire », pl. 36.[↩]
- La comparaison détaillée entre l’édition de 1893 et celle de 1895 reste à faire.[↩]
- M. Liouville, Les Rires de la poésie romantique (1830-1856), thèse de Doctorat : Université Lille 3 : 2005, p. 39.[↩]
- D. Escarpit, L’Humour, Paris : Presses Universitaires de France, 1980, p. 88.[↩]
- Une case (fig. 76) donne la reproduction d’une lettre, authentifiée par l’écriture cursive, que Nestor Camard adresse à sa voisine : « Mon nez mable Voisine. Mon nez tonnement à votre vue nez gala que mon amour subit !….nez cartez pas mon nez spoir…… Oh mon nez mable voisine, soie mon nez pouse adorée, et je serai ton nez poux pour la vie, ton nez Sclave. Nez Sotr Camard. Minuit », pl. 11. Texte : « Camard se livre à une déclaration écrite. » / « Aussi remplie d’amour que de fautes d’orthographe. » / « N’obtenant aucune réponse. Camard découragé est sur le point d’accuser les femmes de légèreté. » / « Mais ayant réfléchi que l’objet adoré ne sait peut-être ni lire ni écrire, il se décide à une déclaration écrite. »[↩]
- Expression employée par Jules Laforgue à propos de Baudelaire : « [Il] a le premier trouvé, après les hardiesses de romantisme, ces comparaisons crues, qui soudain dans l’harmonie d’une période mettent en passant les pieds dans le plat ; comparaisons palpables, trop premier plan, en un mot américaines semble-t-il », cité par P. Hamon, « Images à lire et images à voir : “images américaines” et crise de l’image au XIXe siècle (1850-1880) », Usages de l’image au XIXe siècle, sous la direction de S. Michaux, J.-Y. Mollier et N. Savy, Paris : Créaphis, 1992, p. 243.[↩]
- Idem, p. 246.[↩]
- P. Hamon, Imageries, 2001, p. 280.[↩]
- Dans ses pièces de théâtre les plus fantaisistes, Rodolphe Töpffer n’hésite pas à non plus à aligner les jeux de mots.[↩]
- J. Dürrenmatt, « Töpffer et le trait ironique », Les Lieux du réalisme, 2005, p. 324.[↩]
- Voir B. Toussaint, « Idéographie et bande dessinée », Communications, n° 24, 1976, pp. 81-93.[↩]
- Dans ses Souvenirs littéraires (1882-1883), Maxime Du Camp rapporte l’idée que Flaubert aurait eue de transposer littéralement des métaphores, dans une féerie, afin de créer « un comique inconnu jusqu’ici » : « Il avait inventé un nouveau système qui lui seul condamnait sa pièce à n’être jamais représentée, car la mise en scène eût ruiné la direction. C’était l’image même contenue dans le dialogue qui devenait visible et se formulait matériellement aux yeux des spectateurs. Ainsi, le père cherche son fils, le trouve dans un café, buvant et fumant ; il s’irrite et lui dit : “Tu n’es qu’un pilier d’estaminet” ; à l’instant le jeune homme devient un pilier et forme un des linteaux de la porte » ; cité par P. Hamon, L’Ironie littéraire, 1996, p. 106.[↩]
- Paul Ricœur, La Métaphore vive, Paris : Seuil, 1975, p. 10.[↩]
- F. Cornilliat, « Christophe : le texte, l’image et la chute des corps », Littérature, n° 87, 1992, pp. 45-64.[↩]
- Idem, p. 47.[↩]
- Voir l’analyse d’une séquence de l’Histoire d’Albert par Thierry Groensteen, « Rodolphe Töpffer scénariste », Töpffer, 1996, p. 209.[↩]
- D. Grojnowski, « Le calembour visuel », La Licorne, n° 23, 1992, pp. 194-195 pour les deux citations.[↩]
- B. Bosredon, Les titres de tableaux : une pragmatique de l’identification, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. 191.[↩]
- Groupe Mu, « Ironique et iconique », Poétique, n° 36, 1978, p. 437.[↩]
- Dans une autre de ses planches (L’omelette, s4-n7, 1890) on note que les tournures familières « – Pondus d’à c’matin, mon beau Seigneur » et « – Si fait Monsieur ! » sont elles aussi remplacées par les plus correctes « – Pondus de ce matin » et « – Mais oui, Monsieur ».[↩]
- S. Le Men, « Le romantisme et l’invention de l’album pour enfants », Revue française d’histoire du livre, numéro spécial Le Livre d’enfance et de jeunesse en France, n° 82-83, 1994, p. 158.[↩]
- Cette série de farces et d’espiègleries est d’ailleurs formidablement transposée au théâtre par Laurent Pelly (Théâtre de Sartrouville – CDN, 2007) qui en souligne « la jubilante sauvagerie intéressante à travailler pour les enfants » (dossier de presse). Sur scène, le narrateur tient un rôle à part entière.[↩]
- G. Genette, Figures III, Paris : Seuil, 1972, p. 261-262 : « la “fonction de régie” se remarque lorsque le narrateur se réfère au texte narratif dans un discours en quelque sorte métalinguistique (métanarratif en l’occurrence) pour en marquer les articulations, les connexions, les inter-relations, bref l’organisation interne ».[↩]
- J.-J. Tatin-Gourier, « L’effet d’images projetées dans les Lanternes magiques révolutionnaires », La Licorne, n° 23, 1992, p. 125.[↩]
- À noter, par ailleurs, que des histoires en images sont proposées dans les suppléments de la revue Après l’école, fondée par René Leblanc en 1895, comme des planches de « vues pelliculaires pour projections lumineuses », N. Kuntzmann, « La Lanterne magique », Revue des livres pour enfants, n° 130, 1989, pp. 61-64.[↩]
- R. Baroni, La Tension narrative, 2007, p. 331.[↩]
- « Qu’est-ce qu’un conteur, sinon un écrivain qui improvise un récit que d’autres font passer, au coin du feu, dans une conversation animée ? Si depuis cent ans le roman, qui n’est qu’un conte développé, a pris des allures plus ambitieuses, que peut-on demander au conteur ? D’exprimer clairement sa pensée, d’essayer de se faire comprendre des petits et des grands, de ne pas froisser les esprits simples et d’une éducation médiocre, par une phraséologie ambitieuse, souvent incompréhensible sans l’aide d’un dictionnaire », Champfleury, Le Réalisme, Paris : Michel Lévy frères, 1857, p. 112. Les points de suspension sont utilisés sans modération à la fin du XIXe siècle par les écrivains qui veulent rendre au plus près les difficultés de la communication, voir J. Dürrenmatt, Bien coupé mal cousu, 1998, p. 42.[↩]
- Le « drelin, drelin, drelin » que Molière multiplie dans Le Malade imaginaire (acte I, scène 1) est d’ailleurs placé en épigraphe du chapitre XCI des Impressions de voyage de Mr Boniface.[↩]
- D. Sangsue, Le Récit excentrique, 1987, p. 79.[↩]
- Comme l’explique Gérard Genette, ce terme emprunté aux critiques de langue allemande « indique à la fois la présence de l’auteur (réel ou fictif) et l’autorité souveraine de cette présence dans son œuvre », Figures III, 1972, p. 264.[↩]
- D. Diderot, Jacques le fataliste et son maître, Paris : Librairie Générale Française, 2000, p. 45.[↩]
- L. Sterne, Vie et opinions de Tristram Shandy, 1998, p. 112.[↩]
- A.-M. Bassy, « Le livre mis en pièce(s). Pensées détachées sur le livre romantique », Romantisme, n° 43, 1984, p. 21.[↩]
- « Fonction de contact dans le célèbre tableau des six fonctions de la communication selon Jakobson ; opérateur d’ouverture et de mise en relation des partenaires d’une interlocution (“Allô, vous m’entendez ?… ”) », D. Bougnoux, La Communication par la bande : introduction aux sciences de l’information et de la communication, Paris : éd. La Découverte, 1998, p. 266 (glossaire).[↩]
- « Le lecteur aussi doit accomplir une sorte d’acte de fictivisation. […] Plus précisément, il doit faire semblant de se trouver aussi dans le monde fictionnel à côté de l’auteur fictivisé. La fictivisation du récepteur revient essentiellement à accepter le discours fictionnel comme discours vrai à l’intérieur du monde fictionnel construit par le texte », L. Bonoli, « Fiction et connaissance : de la représentation à la construction », Poétique, n° 124, 2000, p. 491. Le narrateur est même homodiégétique dans La Famille Fenouillard où il apparaît comme un proche de la famille : « Convaincus que nos amis Fenouillard servaient de pâture aux poissons du Pacifique, nous songions à leur élever un mausolée de marbre et d’or. Mais voici que nous recevons de Yeddo, par le pantélégraphe Caselli (qui permet, comme chacun sait, d’expédier les dessins les plus compliqués), nous recevons, dis-je, une dépêche et des portraits dont nous donnons le fac-similé. […] ─ Un vague espoir fait palpiter nos cœurs…serait-ce eux ? » (pl. 40).[↩]
- D. Sangsue, Le Récit excentrique, 1987, p. 99.[↩]
- « MORALITÉ. Ceci doit vous apprendre, amis lecteurs et aimables lectrices, que les grandes passions font faire beaucoup de malles, sans beaucoup d’effets. Il faut les fuir avec une grande diligence et se renfermer dans son intérieur ; car, une fois lâché, vous voilà en train de faire……..des bêtises. Dieu vous en garde ! et moi aussi ! », Stop, Aventures sentimentales et dramatiques de M. Verdreau, L’Illustration, 1850. « Vous avez compris ?…Les cartons, habilement truqués, délestés de leurs chapeaux, je m’y étais commodément ( ?) installé. Avouez que l’aventure était drôle et dénote, de ma part, une belle imagination… Hélas ! je fus honteusement chassé. Cette femme ne méritait pas un homme d’esprit », Moyen ingénieux pour s’introduire chez les dames récalcitrantes, La Caricature, 26.11.1898.[↩]
- De cette activité sont issus plusieurs recueils d’imitations, dont le premier est intitulé Pastiches critiques des poètes contemporains (1856) : « Pour la première fois, le terme de “pastiche” est appliqué à un ouvrage entier qui prend pour cible les tics d’écriture d’auteurs contemporains » ; P. Aron, Histoire du pastiche : le pastiche littéraire français, de la Renaissance à nos jours, Paris : Presses Universitaires de France, 2008, p. 132.[↩]
- M.-È. Thérenty, La Littérature au quotidien, 2007, p. 177.[↩]
- M.-È. Thérenty, A. Vaillant, 1836 : l’An I de l’ère médiatique, 2001, p. 11.[↩]
- J. Dürrenmatt propose ainsi plusieurs hypothèses concernant l’absence de bulles chez Töpffer comme chez Nadar : peur d’une désorganisation de l’image en tant qu’espace plastiquement organisé, importance des verbes introducteurs qui orientent et modalisent le discours, défiance à l’égard du discours direct en tant qu’il peut produire des effets de dissonance stylistique dans un type d’œuvre pensée comme déjà composite, volonté de mettre en relief une distance à garder face aux discours d’autorité ; « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », Centre d’Étude de l’Écriture et de l’Image, [en ligne], http://www.ceei.univ-paris7.fr/07_ressource/01/document/06.html (consulté le 15.05.2016).[↩]
- M.-È. Thérenty, La Littérature au quotidien, 2007, p. 123.[↩]
- Ibidem, p. 181.[↩]
- « Chaque homme, dans sa conversation habituelle, n’a-t-il pas ses formules favorites, ses mots coutumiers nés de son éducation, de sa profession, de ses goûts, appris en famille, inspirés par ses amours et ses aversions naturelles, par son tempérament bilieux, sanguin ou nerveux ; dictés par un esprit passionné ou froid, calculateur ou candide ; n’a-t-il pas des comparaisons de prédilection et tout un vocabulaire journalier auquel un ami le reconnaîtrait, sans entendre sa voix, à la tournure seule d’une phrase qu’on lui redirait ? Faut-il donc toujours que chaque personnage se serve des mêmes mots, des mêmes images, que tous les autres emploient aussi ? Non, il doit être concis ou diffus, négligé ou calculé, prodigue ou avare d’ornements selon son caractère, son âge, ses penchants », A. de Vigny, Lettres à Lord***, cité par A. Ubersfeld, Le Drame romantique, Paris : Belin, 1993, p. 81.[↩]
- Paris dévoilé ou les Mystères sus, 1ère partie, Musée ou magasin comique de Philipon, 25ème livraison, 1842.[↩]
- « L’insertion des langues parlées dans le roman n’étant pas une pratique aisée, les premiers écrivains qui s’y sont risqués ont dû montrer patte blanche. C’est pourquoi, au commencement, ils ont eu soin de justifier leurs dérogations à la norme linguistique et littéraire, en les accompagnant de gloses pseudo-scientifiques plus ou moins longues. Ainsi le Hugo des Misérables escorte-t-il ses dialogues en argot de nombreux commentaires ponctuels, de véritables dissertations et de forces notes en bas de page », S. Durrer, Le Dialogue dans le roman, Paris : Nathan Université, 1999, p. 24.[↩]
- Voir T. Smolderen, « Ceci n’est pas une bulle ! Structures énonciatives du phylactère », Université de Poitiers, [en ligne], http://rhrt.edel.univ-poitiers.fr/document.php?id=555 (consulté le 15.05.2016).[↩]
- En couverture de La Caricature (19.11.1881), Albert Robida commence notamment une série sur le Code sentimental, essai de réglementation des affaires de cœur par une image où de « longues et minutieuses discussions » s’incarnent dans de multiples phylactères, d’une façon beaucoup plus graphique que scripturale. Capable de rotation dans le plan bidimensionnel de l’image, comme dans les caricatures de Gillray, le texte va jusqu’à s’inscrire verticalement dans des bulles contorsionnées.[↩]
- « Tiretés, lignes ondulées ou droites, portées musicales, sortent qui de la bouche des héros, qui du pavillon des instruments de musique. L’odeur, à l’occasion, peut également être matérialisée par de tels pictogrammes. L’onomatopée animale – couac pour le canard ou cra cra pour le corbeau – surgit des becs ouverts des oiseaux. Les hommes s’expriment de manière plus subtile, en toutes lettres, même si c’est pour s’injurier. En règle générale, ce sont des lignes de textes sous forme de lettrage en liberté dans l’espace de l’image, et non enfermées dans un phylactère, qui marquent les monologues et dialogues à voix haute », D.-A. Bidon, « La bande dessinée avant la bande dessinée », Le Collectionneur de bandes dessinées, n° 79, 1996, p. 18.[↩]
- Ibidem, p. 11.[↩]
- C’est également un perroquet que fait parler le dessinateur américain Richard F. Outcault, dans The Yellow kid and his new phonograph publié le 25 octobre 1896 dans The New York Journal. Parce qu’elle donne à voir des bulles sortant d’un phonographe, dans lequel se cache le perroquet, cette histoire est considérée par les théoriciens américains comme le point de départ de la bande dessinée. La bulle est donc pour eux un critère de définition du genre ; sur le sujet, voir notamment H. Morgan, Principes des littératures dessinées, 2003, chap. « Les critères traditionnels de la BD », pp. 70-81 : « Mais le comble est que le personnage censé incarner le point de départ de la bande dessinée avec bulles n’en émet aucune pendant toute son existence, en dehors de l’unique exemple précité, où il parle littéralement comme un phonographe ».[↩]
- La même exclamation est l’objet de l’un des rares discours directs inclus dans le feuilleton de M. Réac. En argot, la « balle » désigne un visage en faisant allusion à sa forme arrondie.[↩]
- J. Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », Centre d’Étude de l’Écriture et de l’Image, [en ligne], http://www.ceei.univ-paris7.fr/07_ressource/01/document/06.html (consulté le 15.05.2016).[↩]
- T. Groensteen, Système de la bande dessinée, 1999, chap. « Un espace additionnel : la bulle », pp. 79-100.[↩]
- Évidemment, le bruit, les sons, les voix ne sont pas reproduits tels qu’en eux-mêmes, ils sont des éléments graphiques au même titre que le dessin.[↩]
- Le 10 octobre 1877, la Semaine du clergé publie une chronique consacrée à l’invention de Charles Cros ; elle explique le fonctionnement de cet appareil « que nous appellerions, si nous étions appelé à en être le parrain, le phonographe ». Quelques mois plus tard, sans que l’on sache s’il avait eu connaissance des travaux du poète, Edison dépose le brevet de son invention, dont Charles Cros tente vainement de revendiquer la paternité.[↩]
- « En 1889, à la grande foire internationale de Paris, des dizaines de milliers de personnes étaient venues écouter vingt-cinq phonographes parlant dans des douzaines de langues. […] Les spécialistes de l’histoire des médias qui se sont intéressés à l’impact culturel du phonographe décrivent l’expérience de la machine parlante comme une “nouvelle forme de citation”, combinant l’expérience auditive avec une forme inédite d’inscription. Cette nouvelle façon de mettre la parole humaine entre guillemets avait émerveillé les premiers témoins, dans la mesure où le dispositif “se lisait de lui-même” : comme s’il suffisait d’insérer un livre dans la machine pour que la voix de l’auteur se fasse entendre », T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 2009, p. 125.[↩]
- A. Sausverd, « “Les Perfidies du Téléphone” par Albert Guillaume », Töpfferiana, [en ligne], http://www.topfferiana.fr/2009/01/les-perfidies-du-telephone/ (consulté le 15.05.2016).[↩]
- C’est ainsi que Thierry Smolderen envisage la fameuse planche du Yellow Kid et son nouveau phonographe, Naissances de la bande dessinée, 2009, p. 125.[↩]


